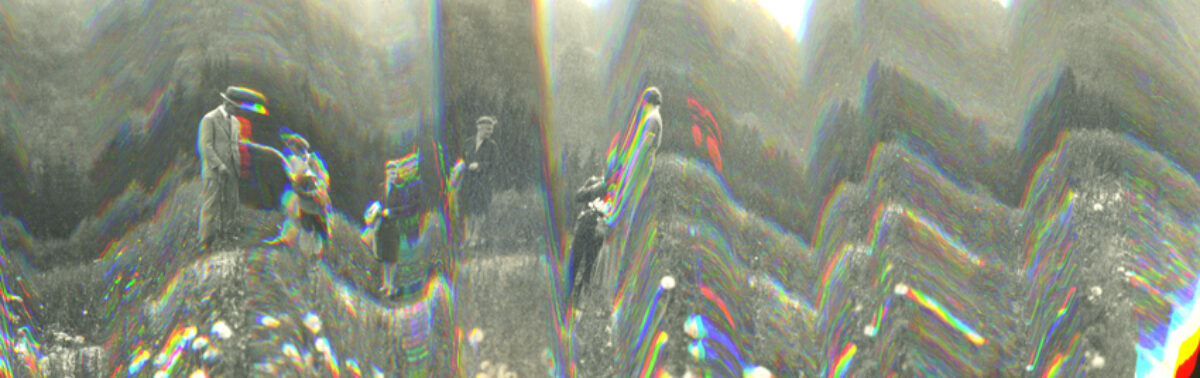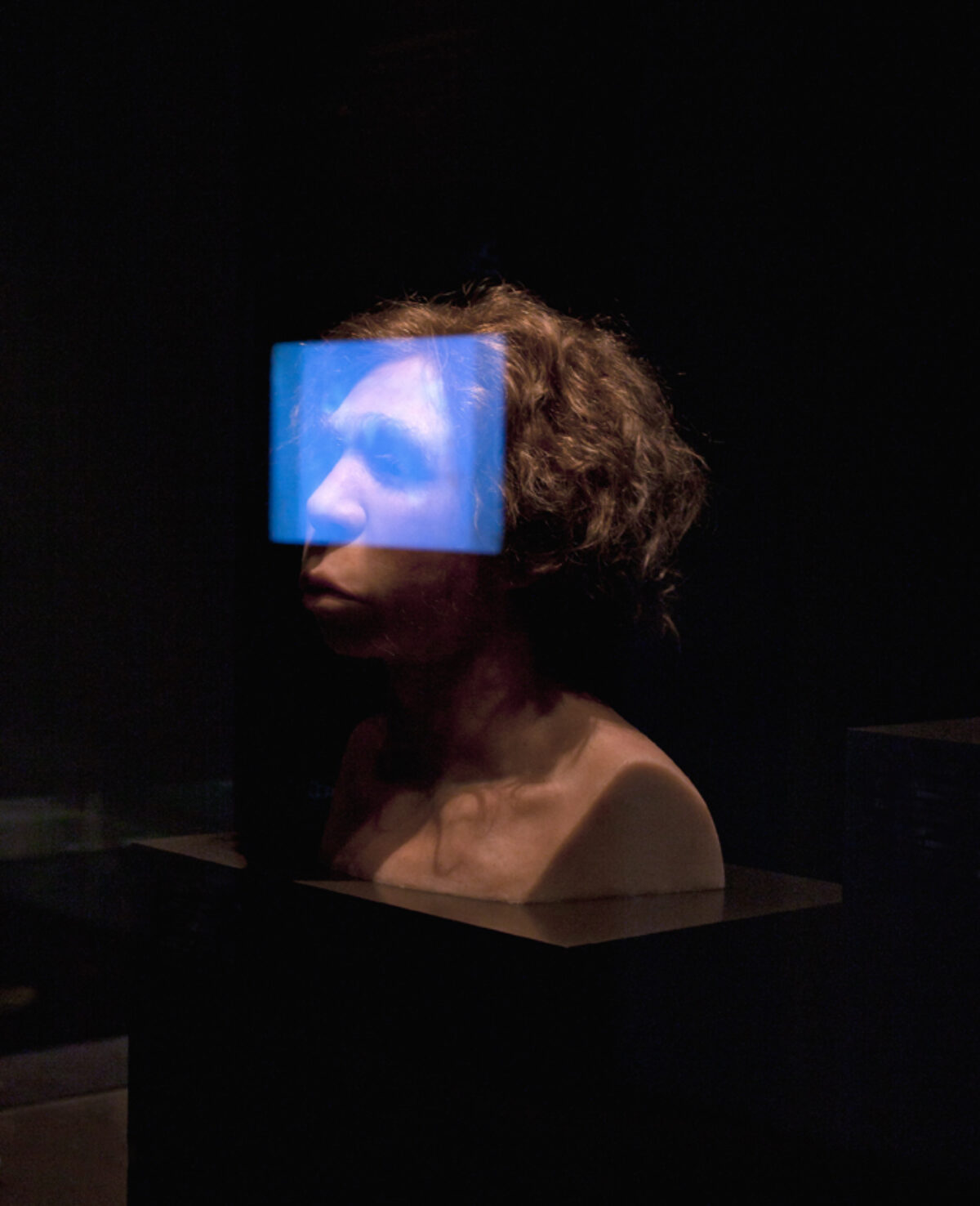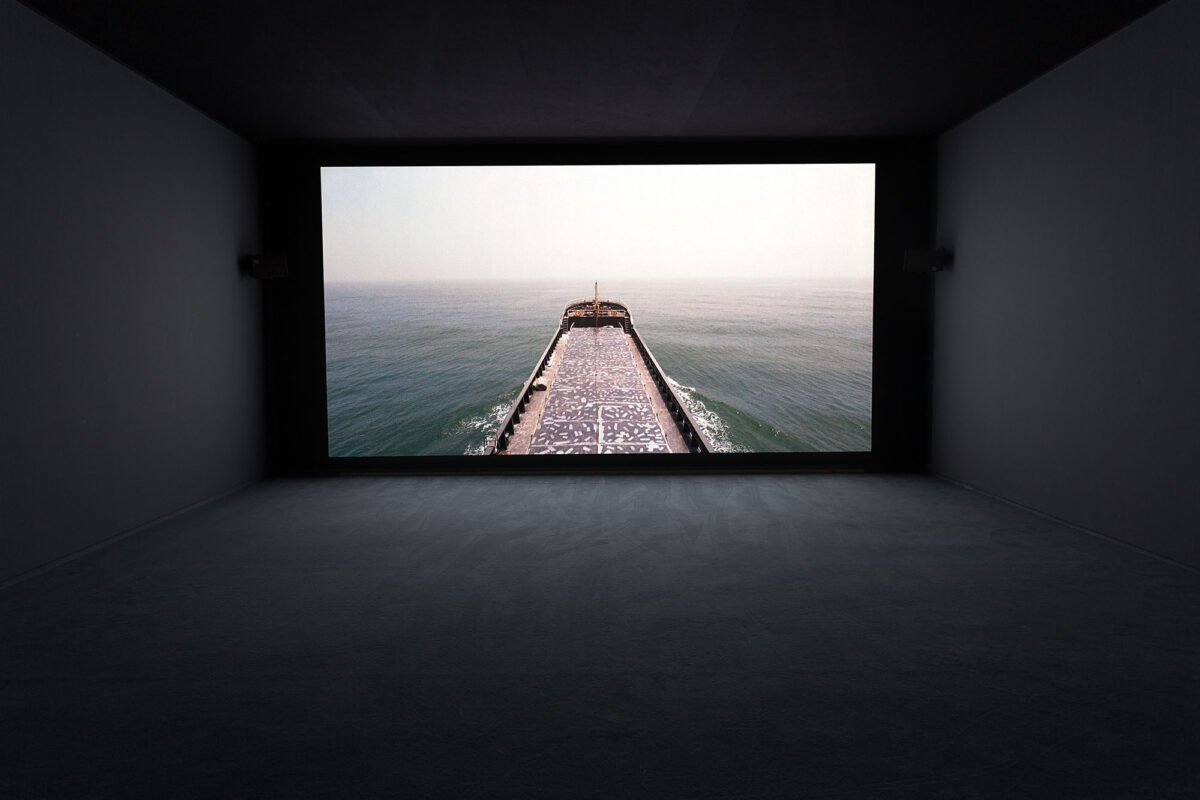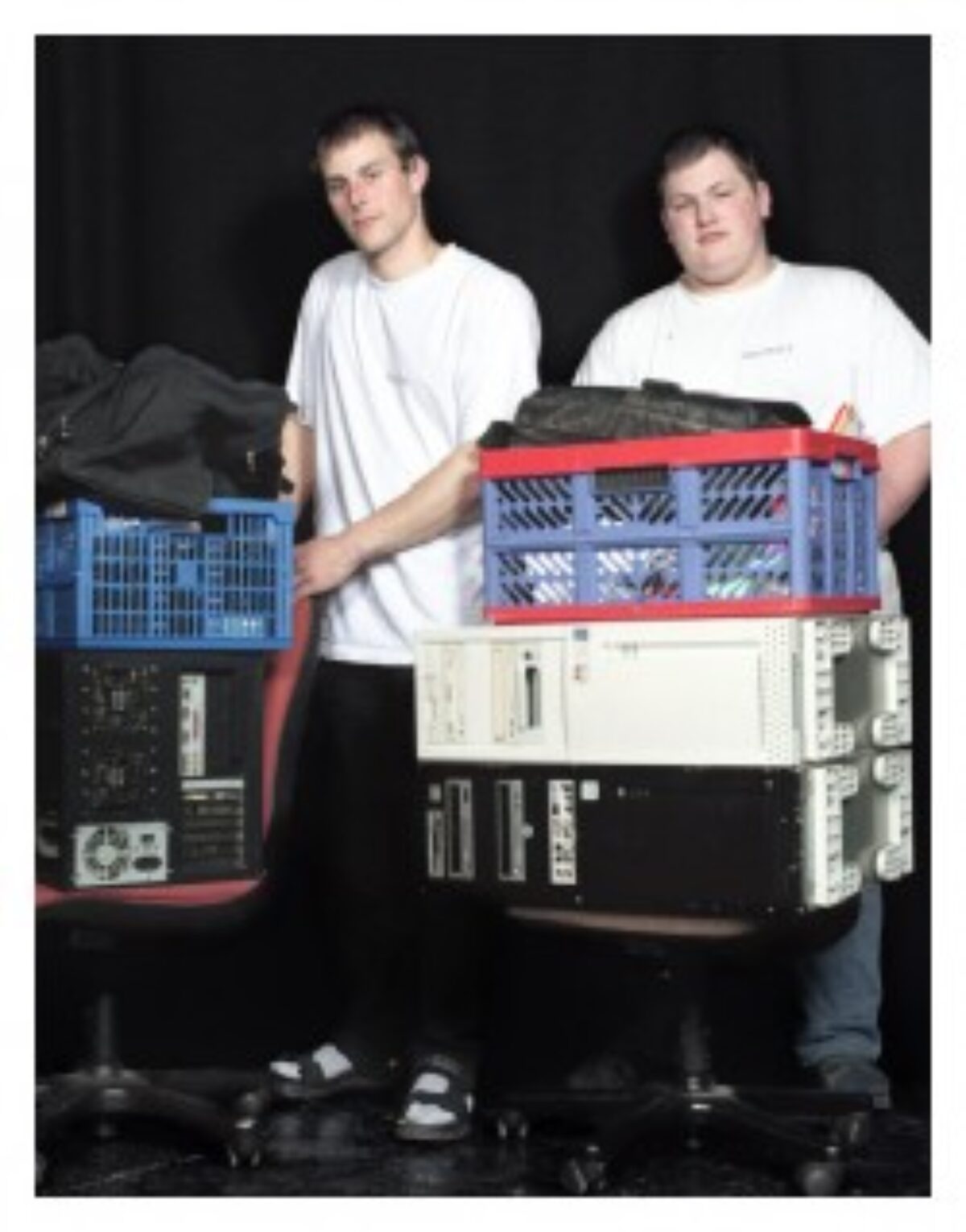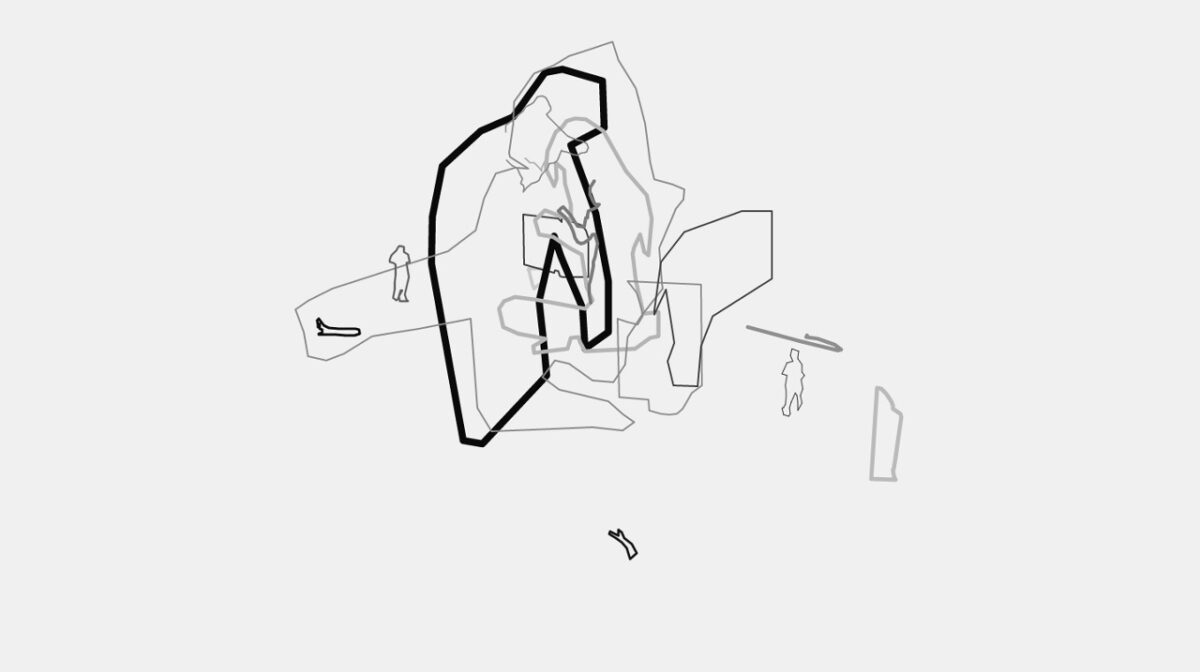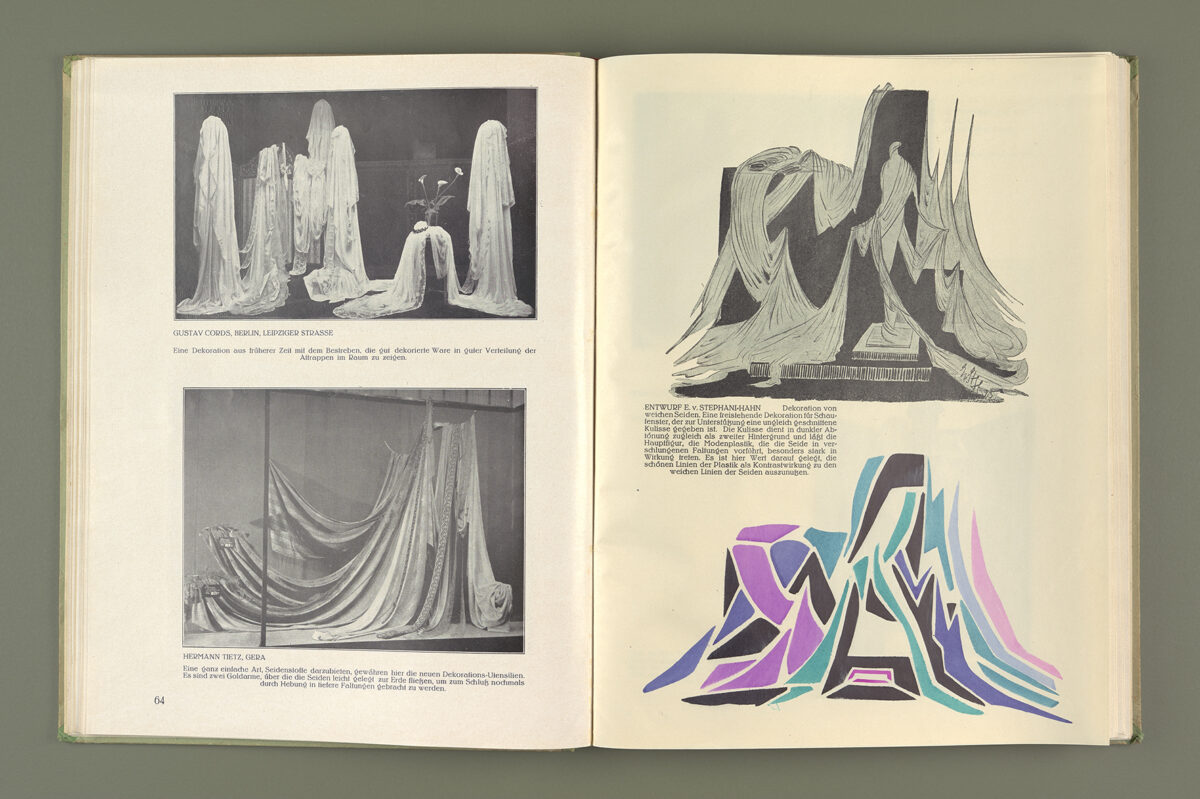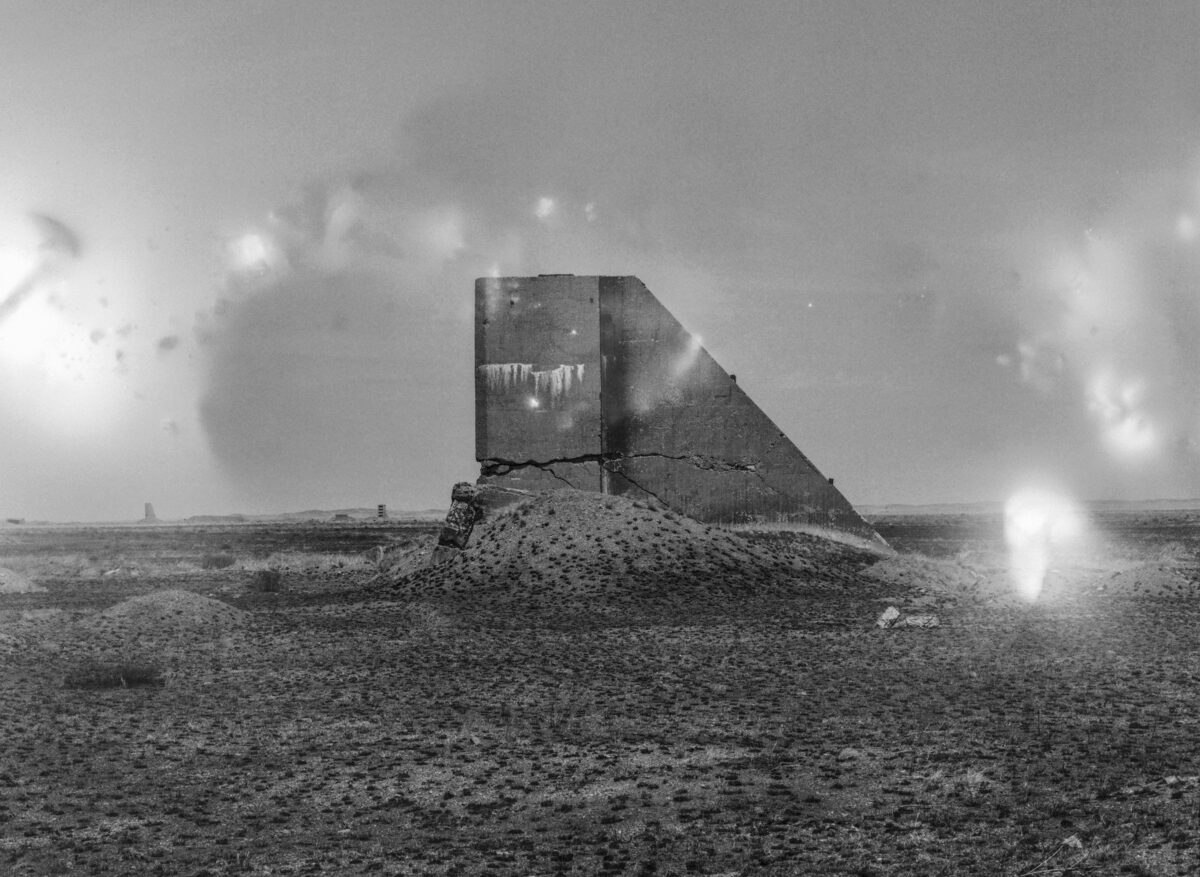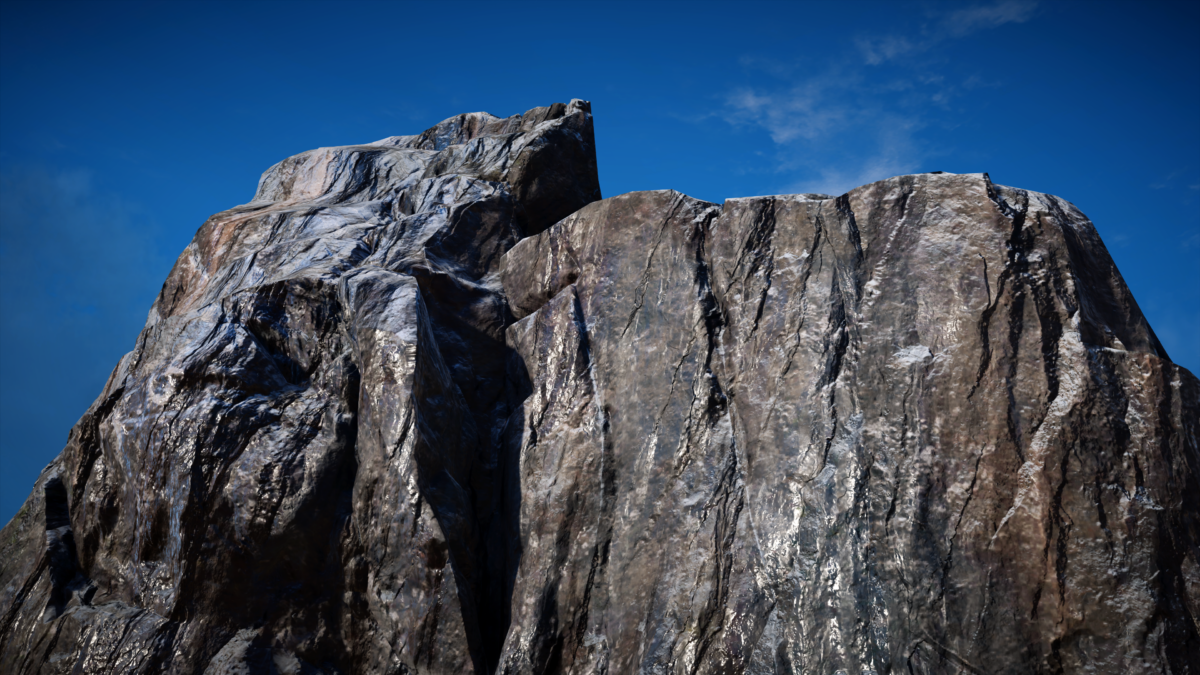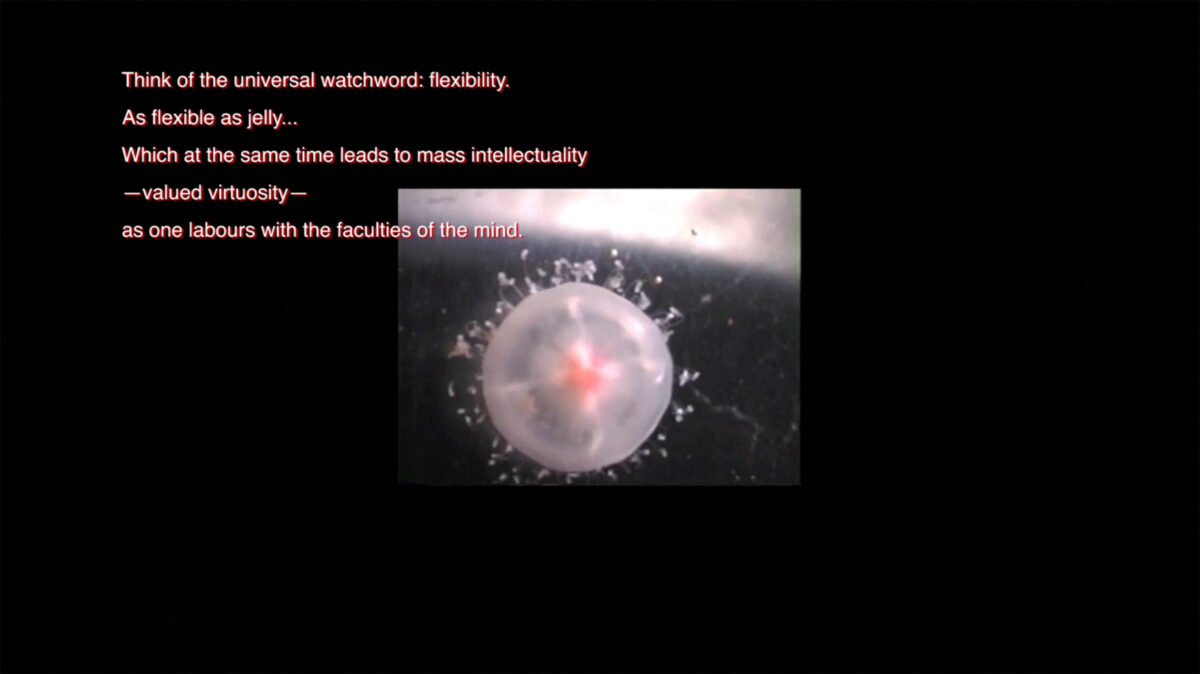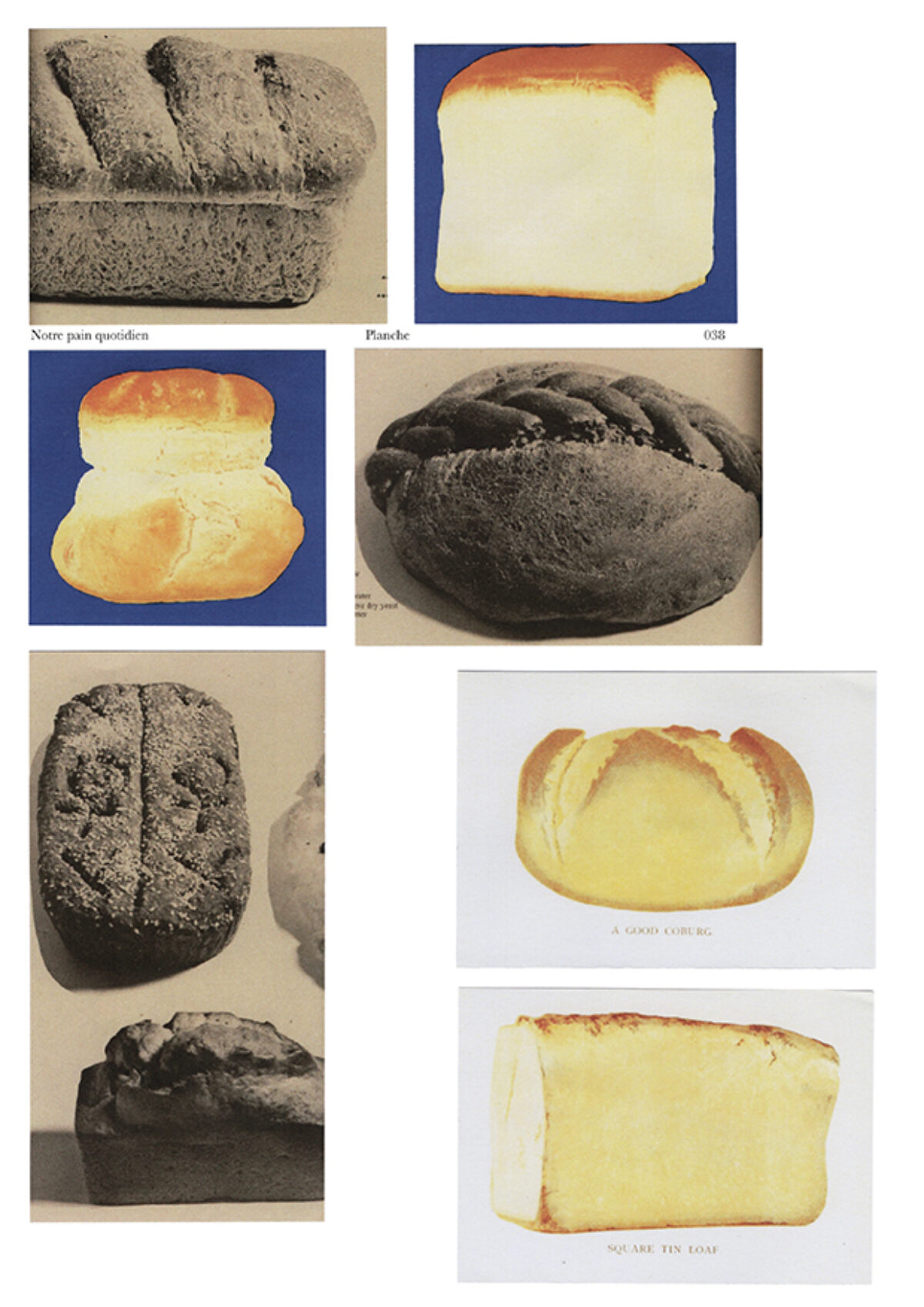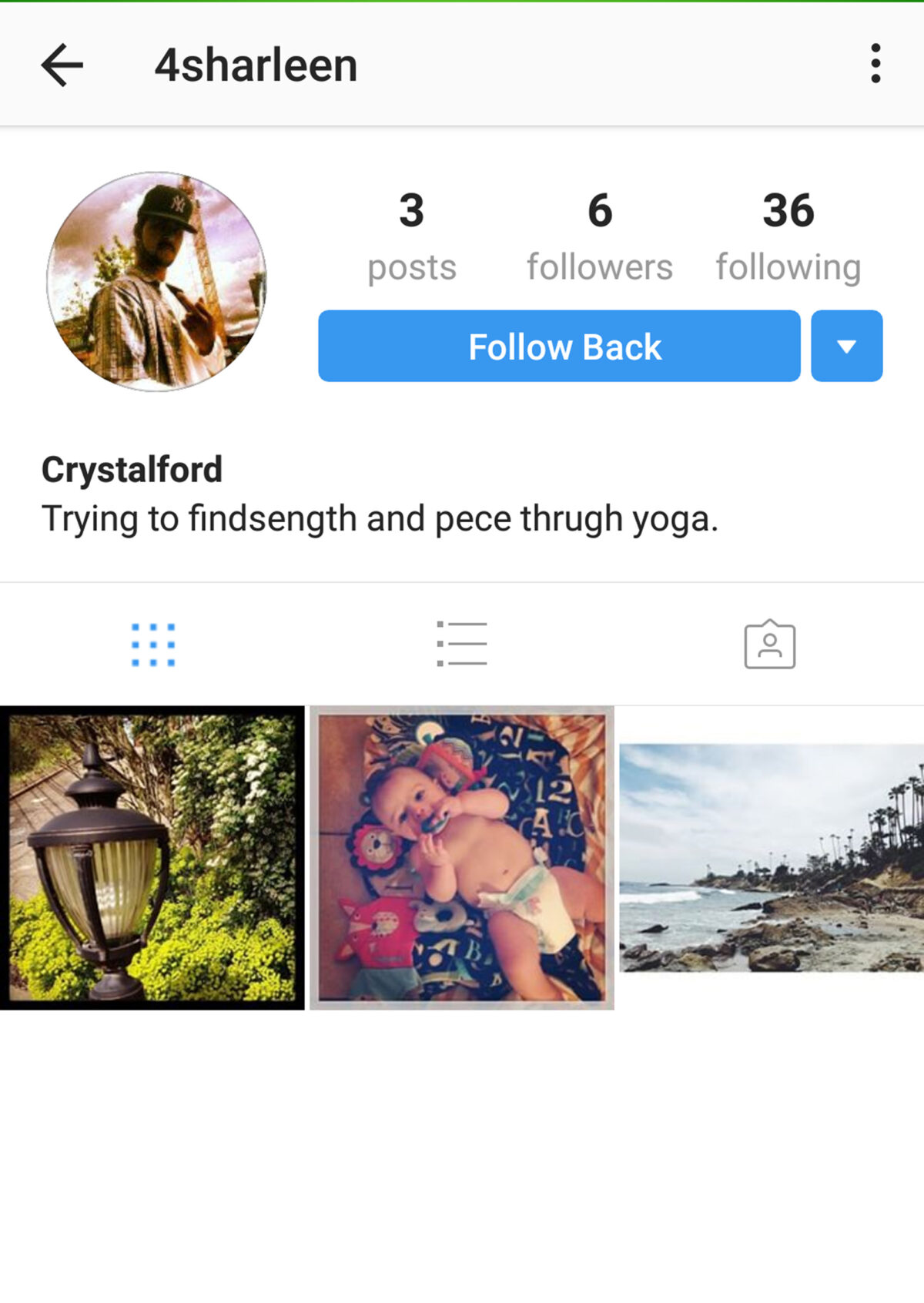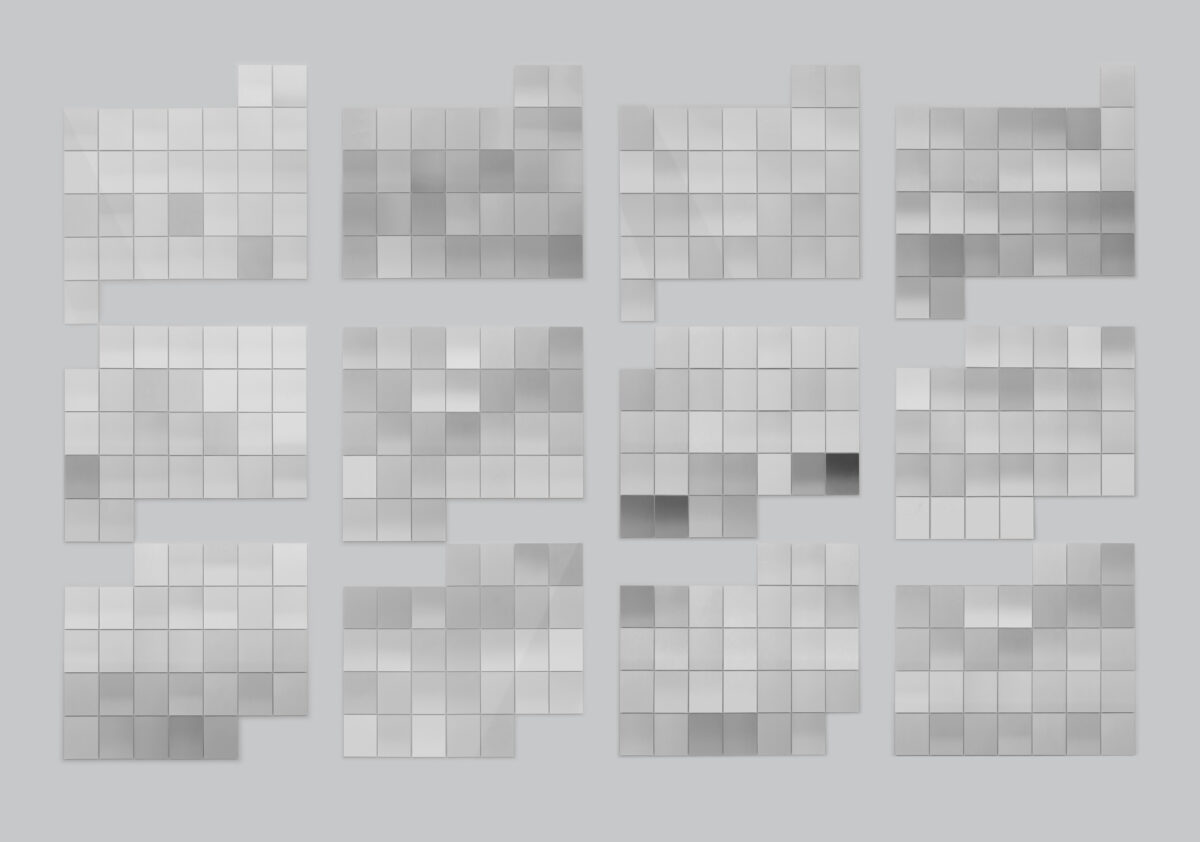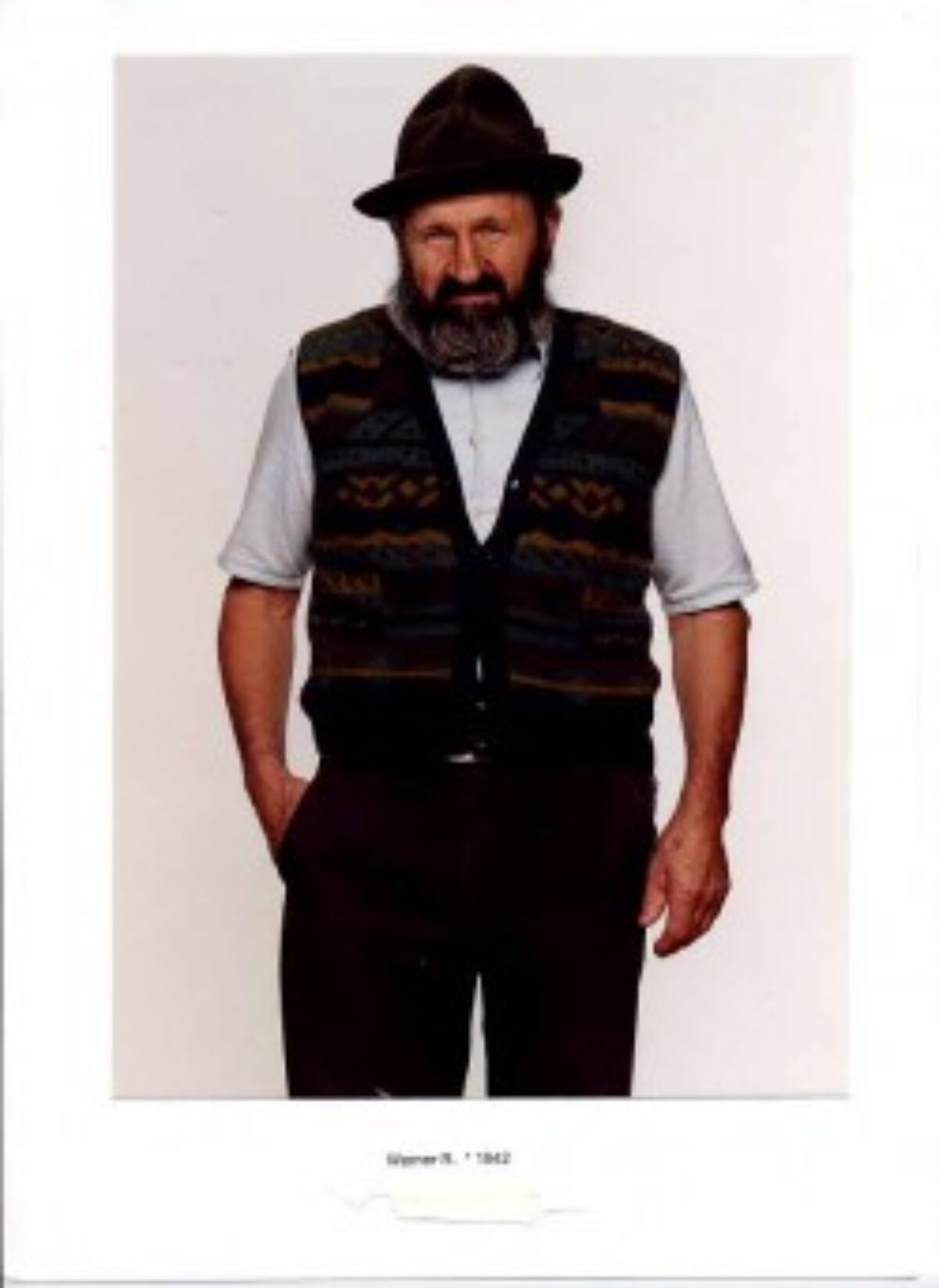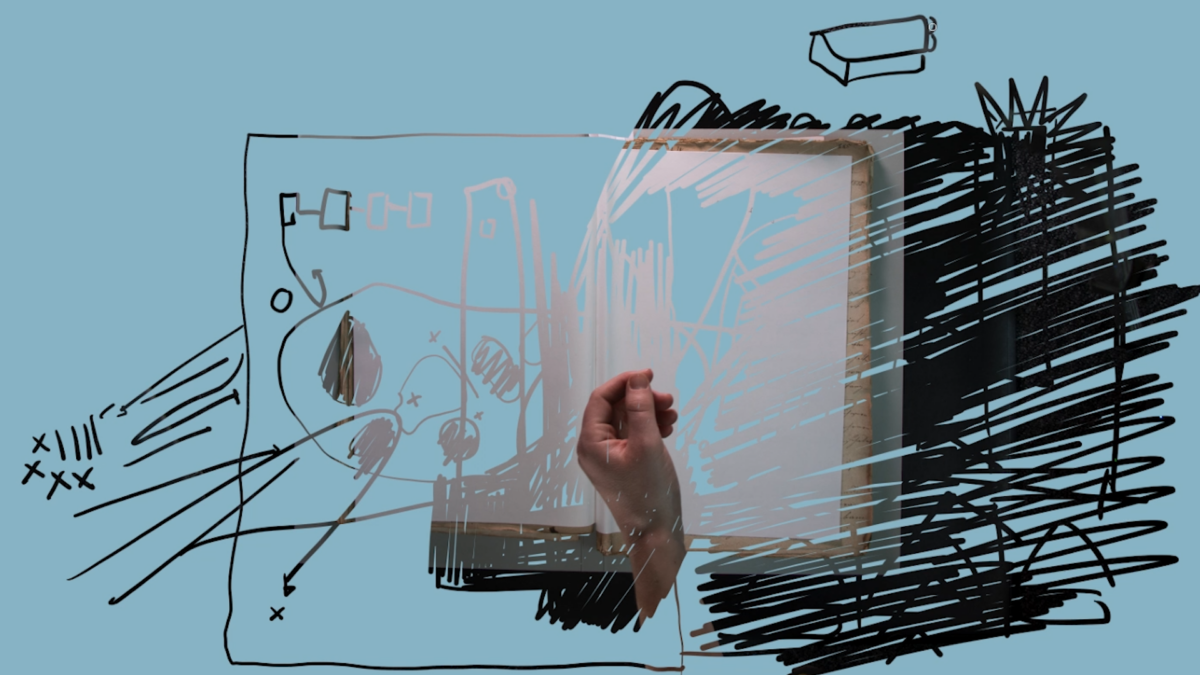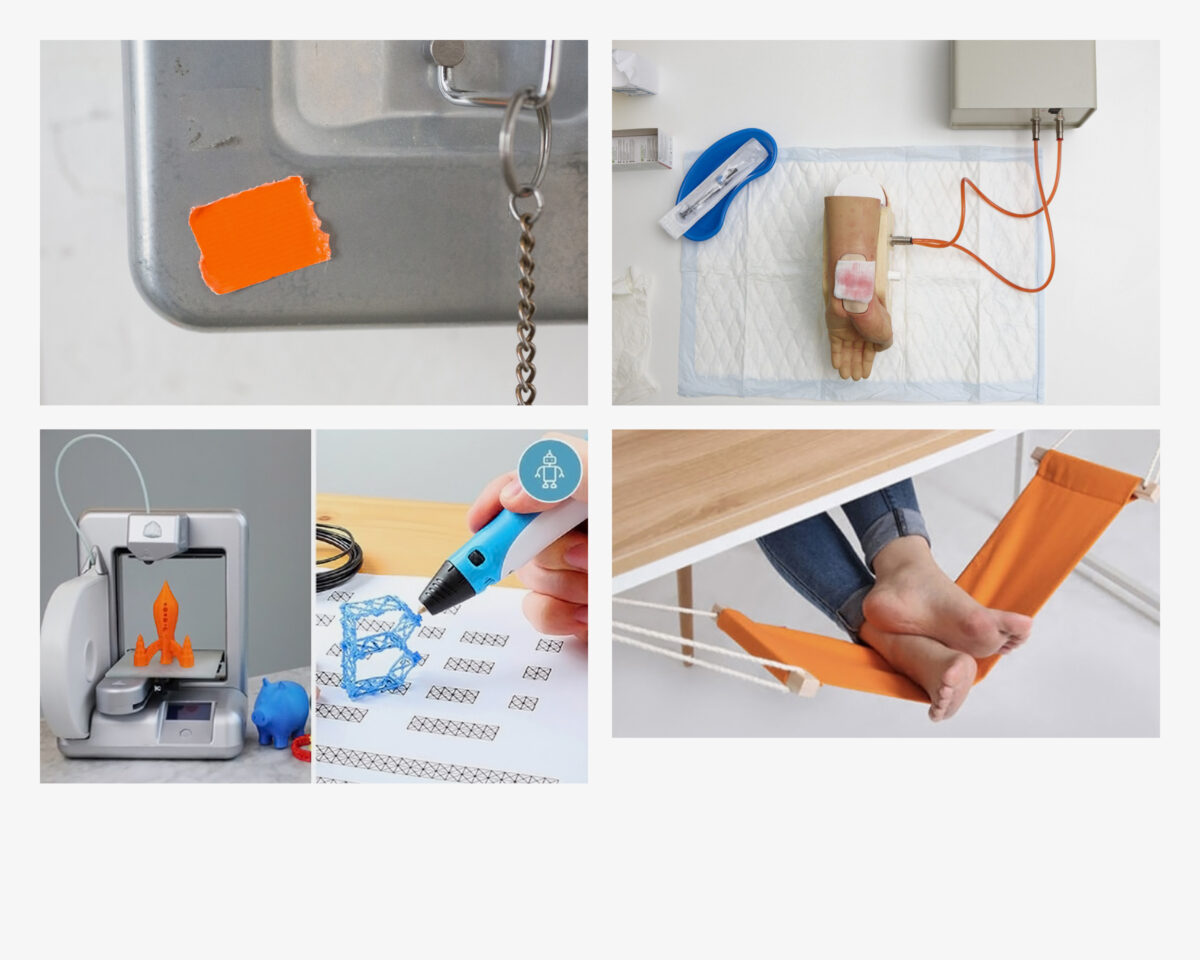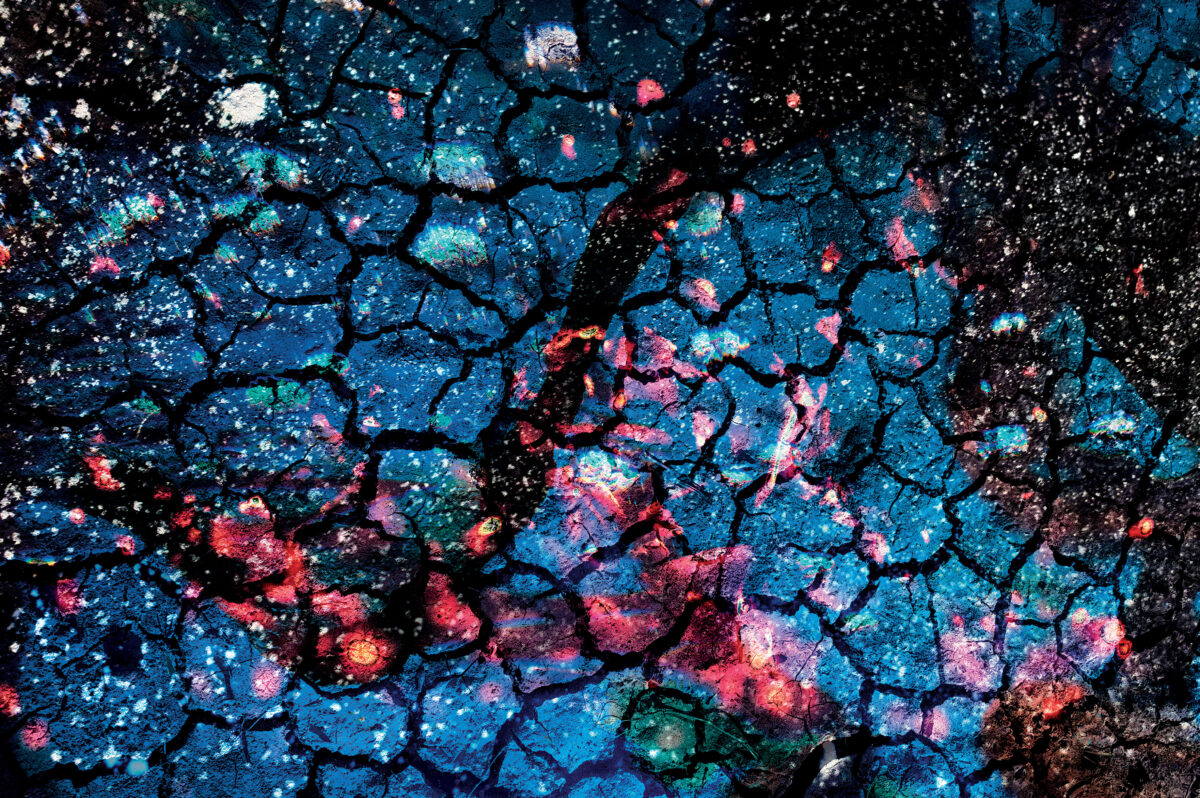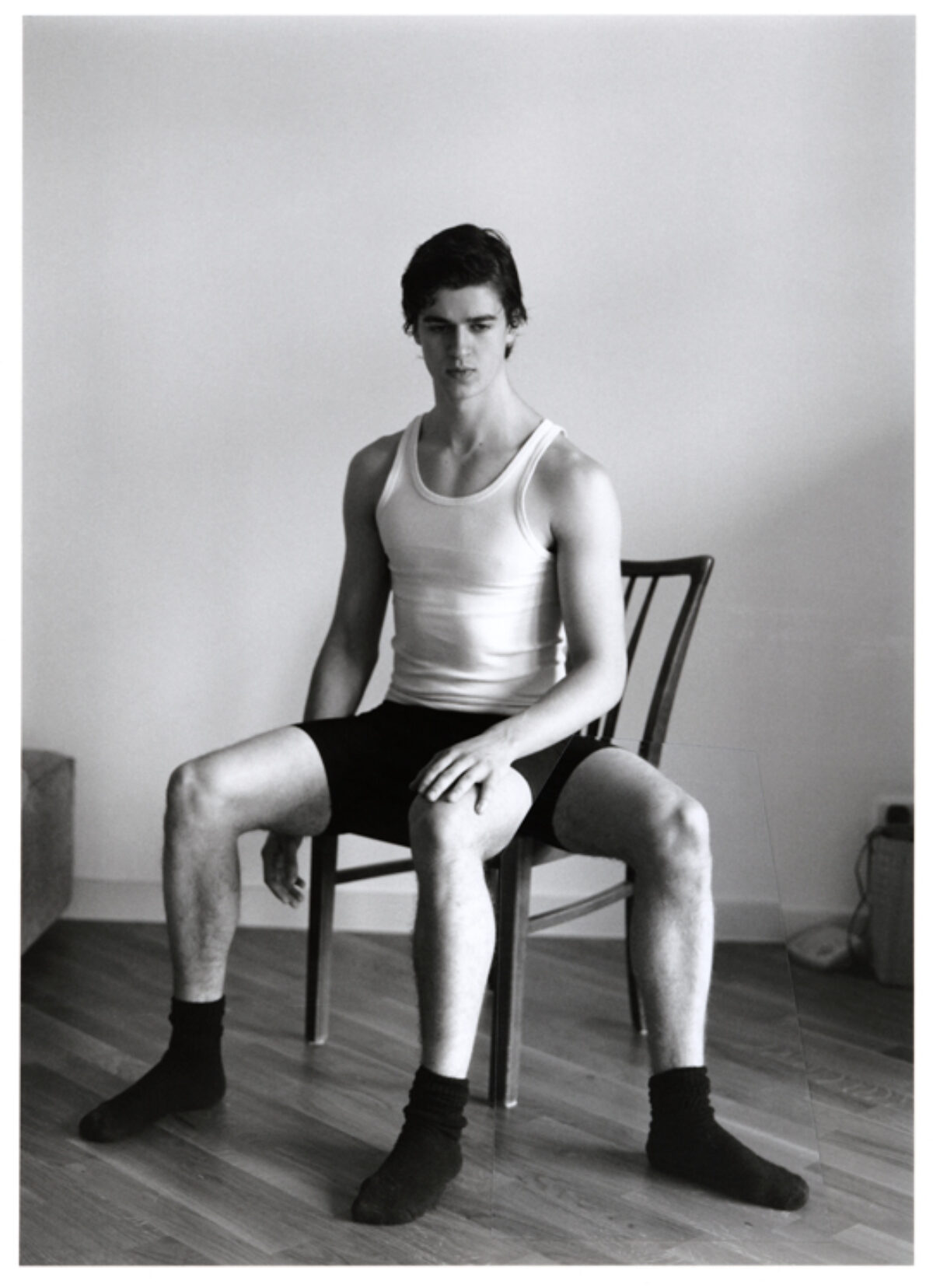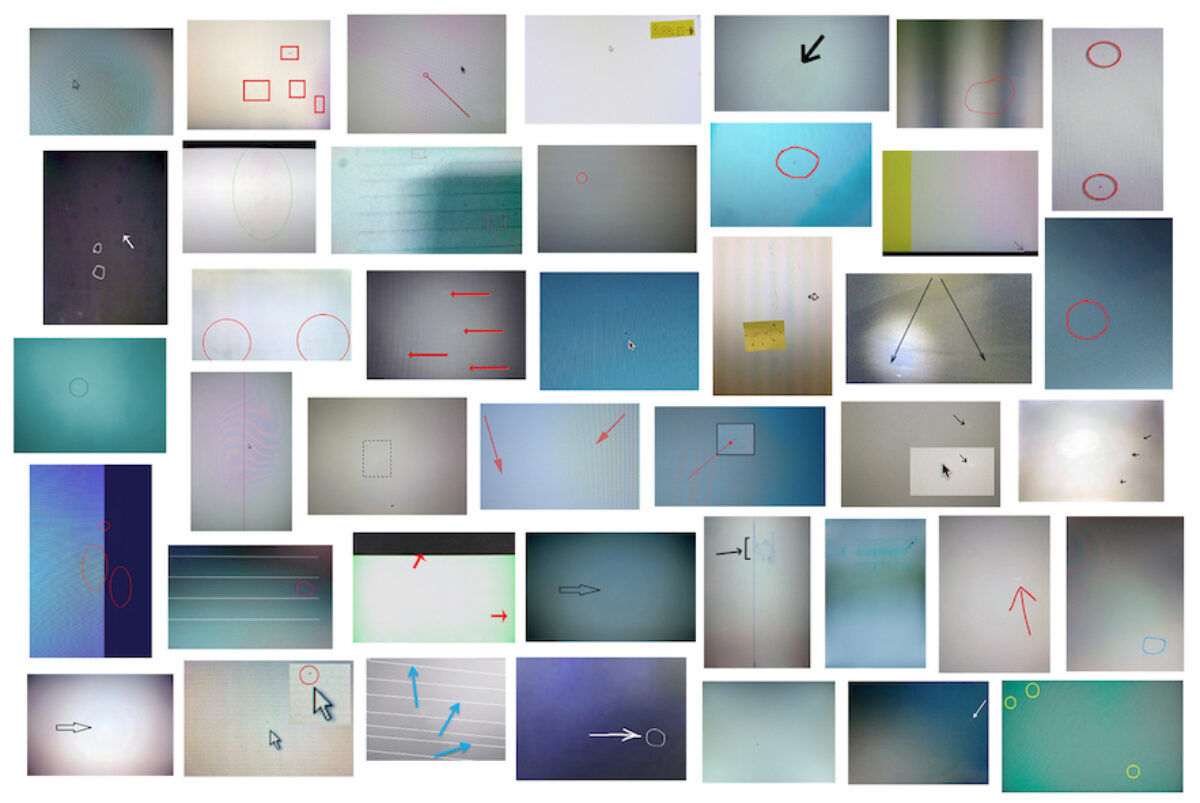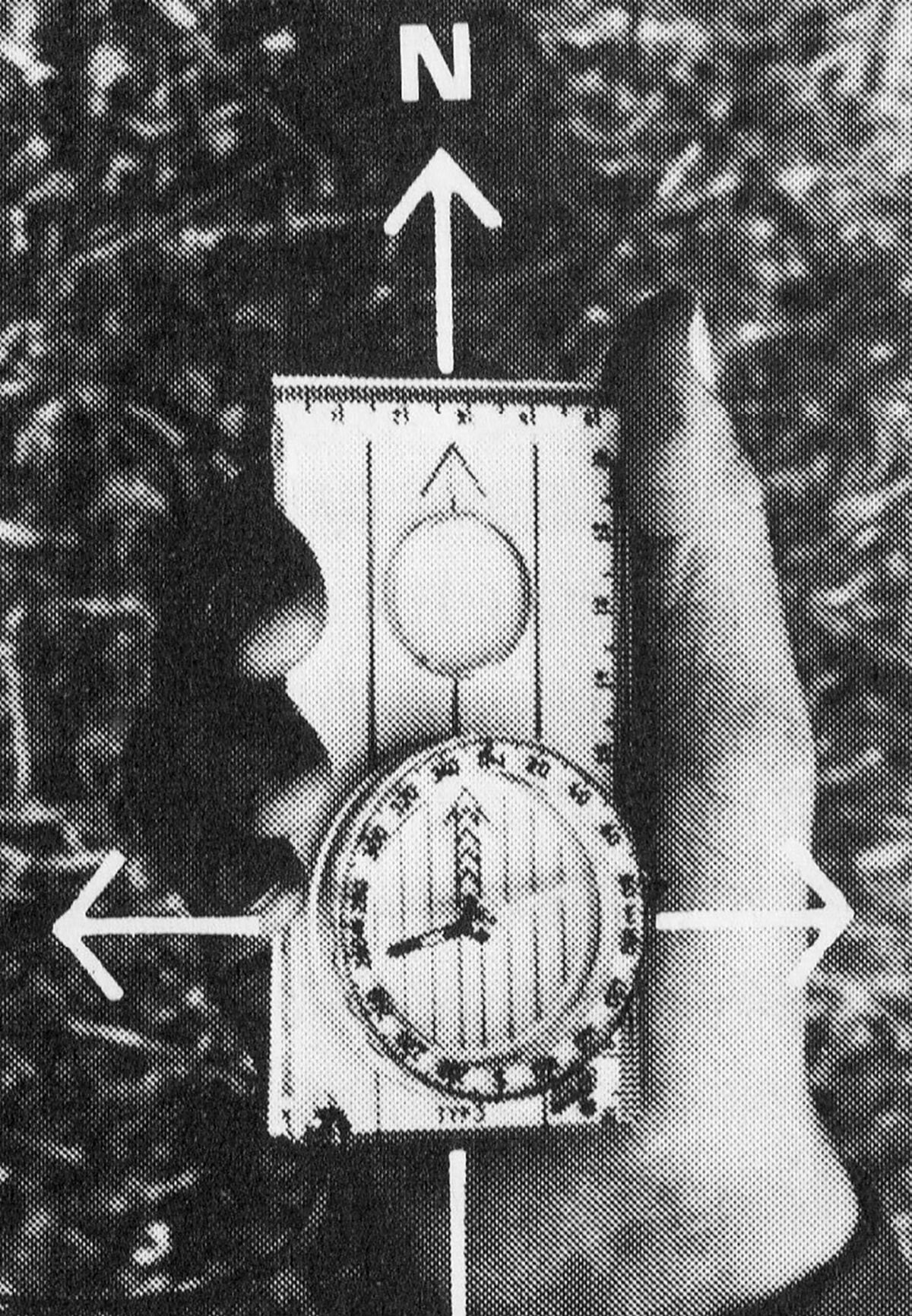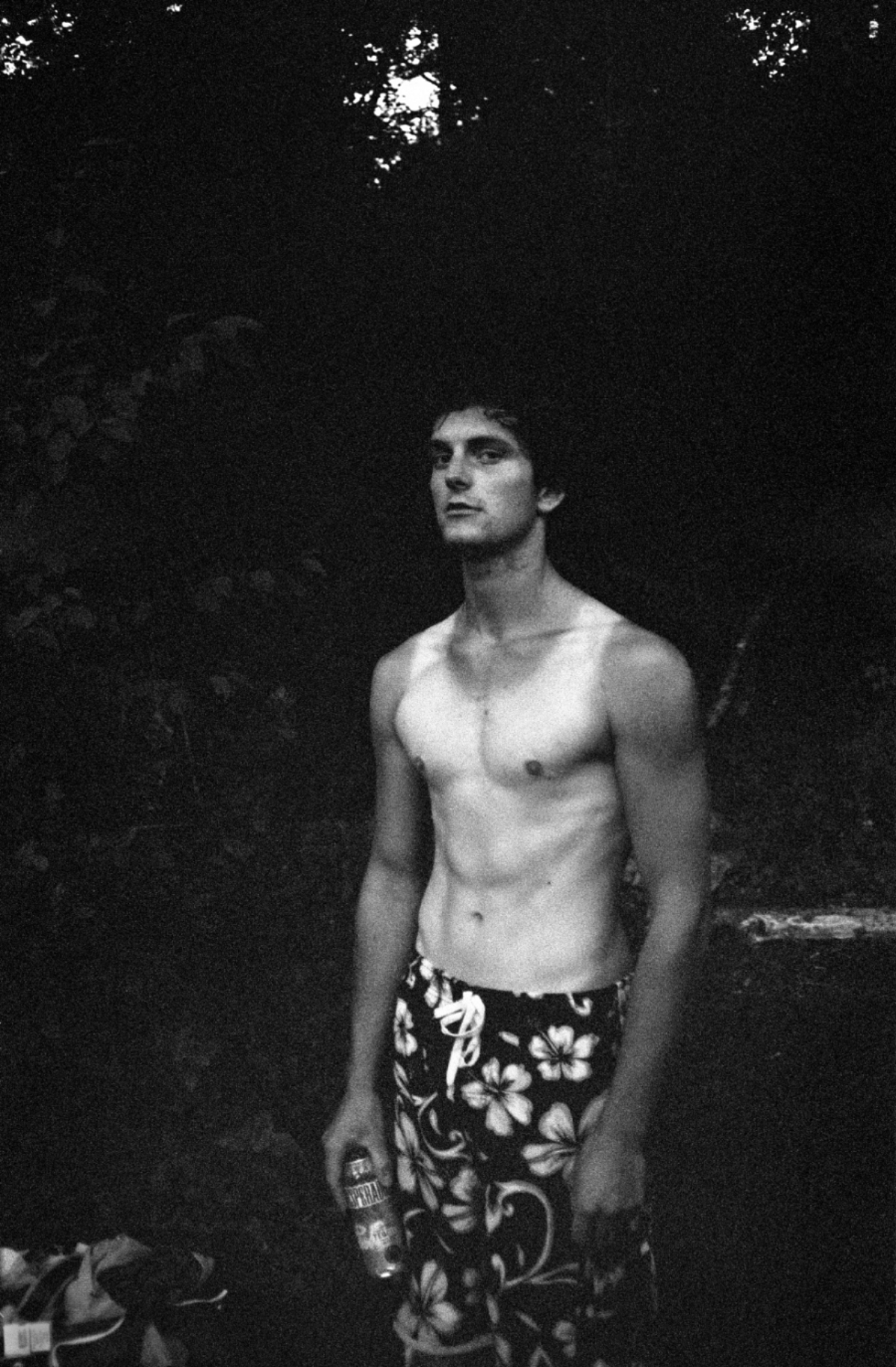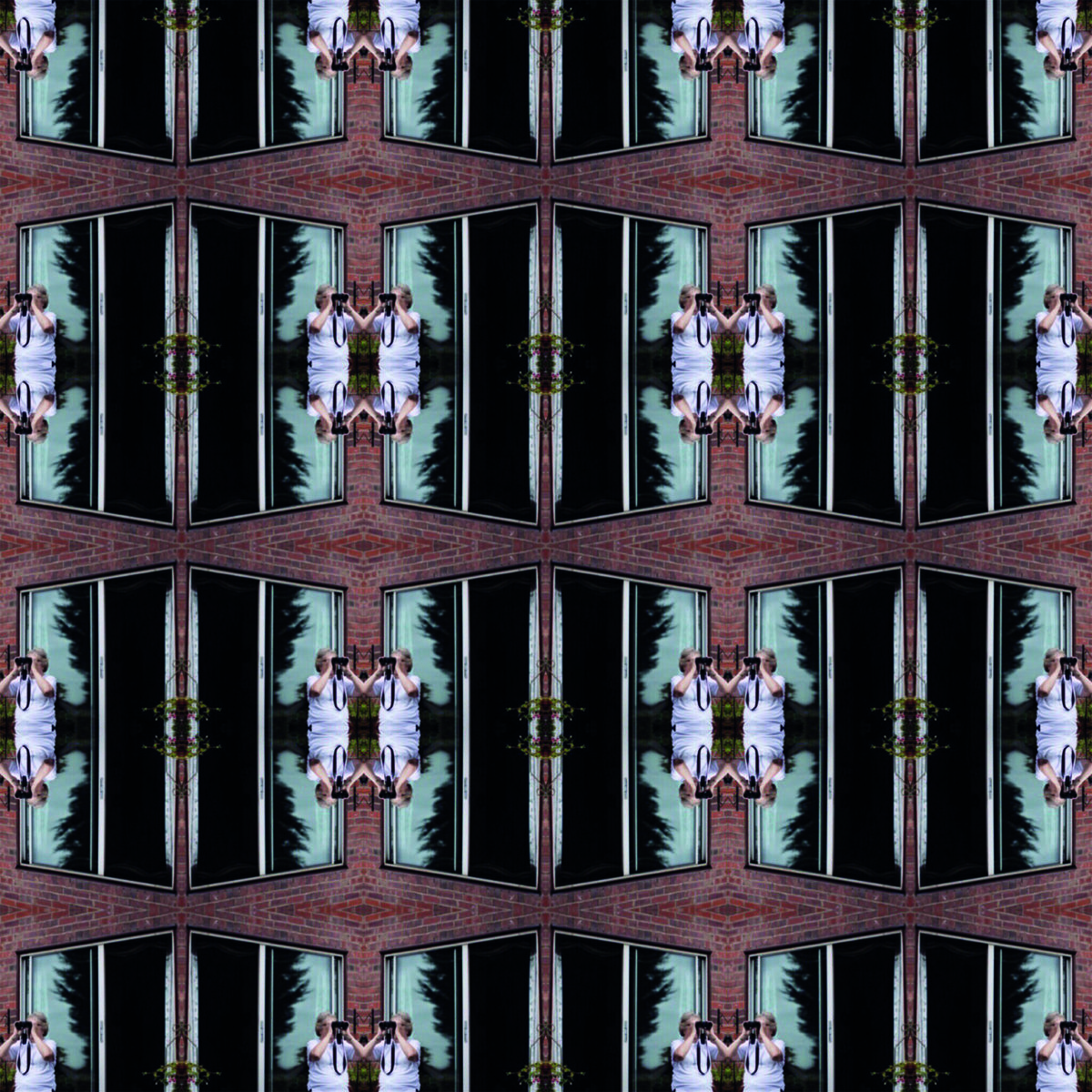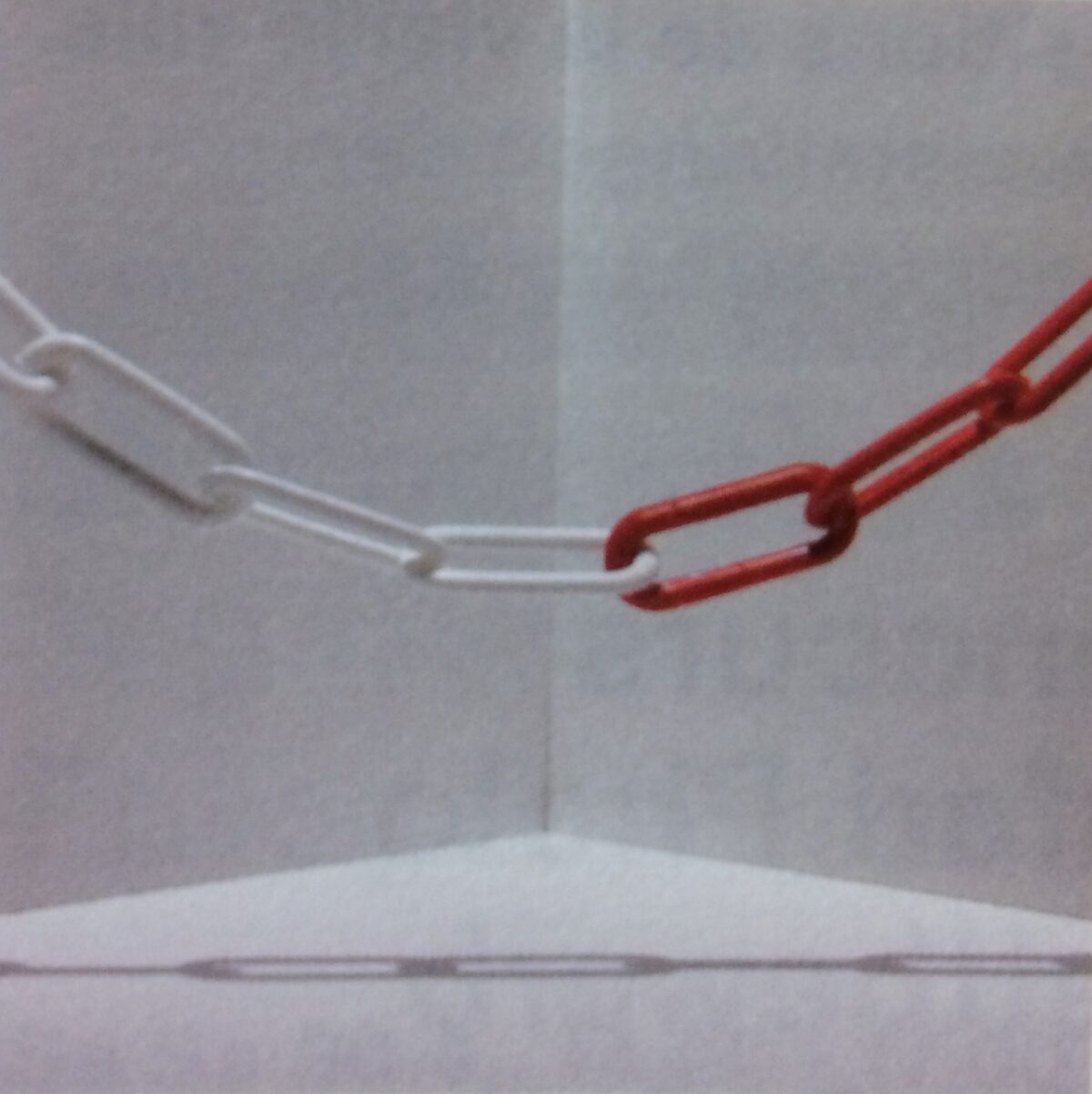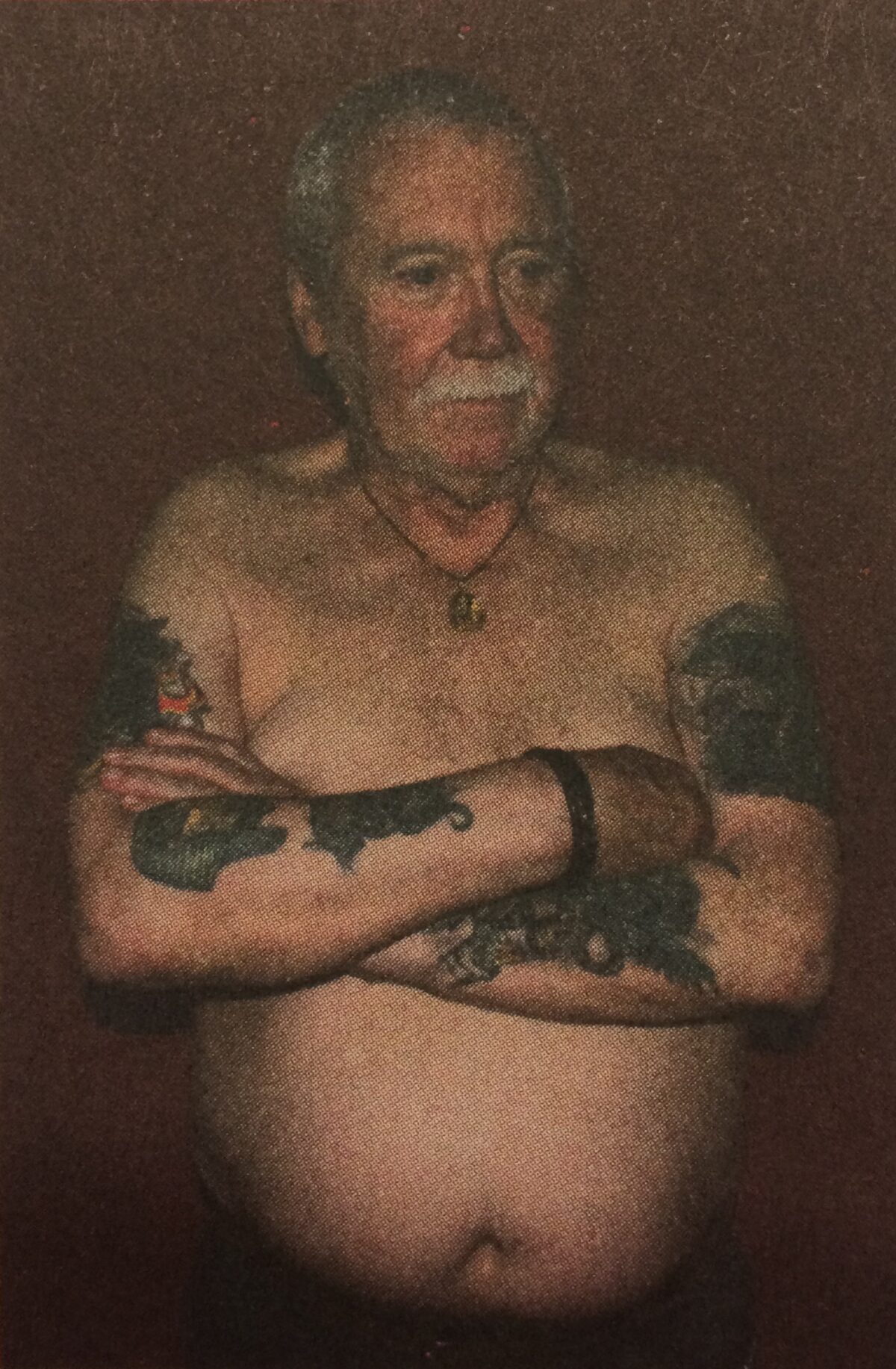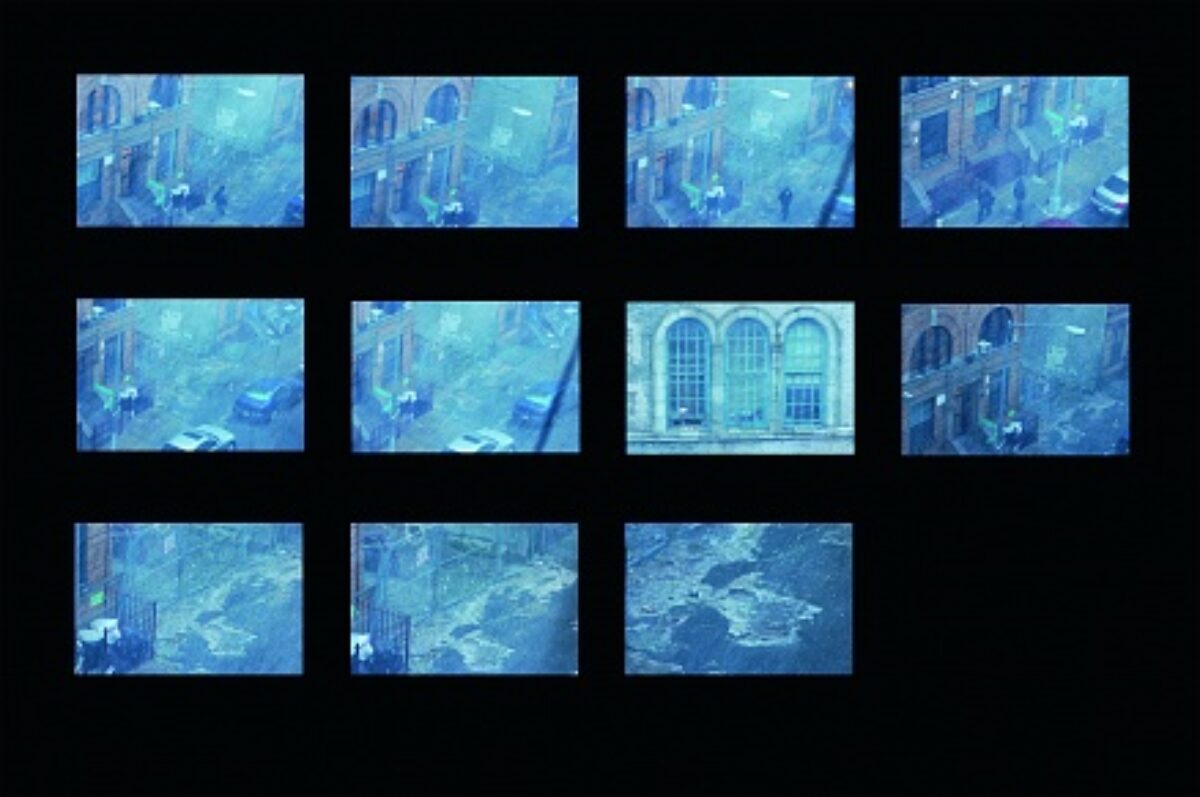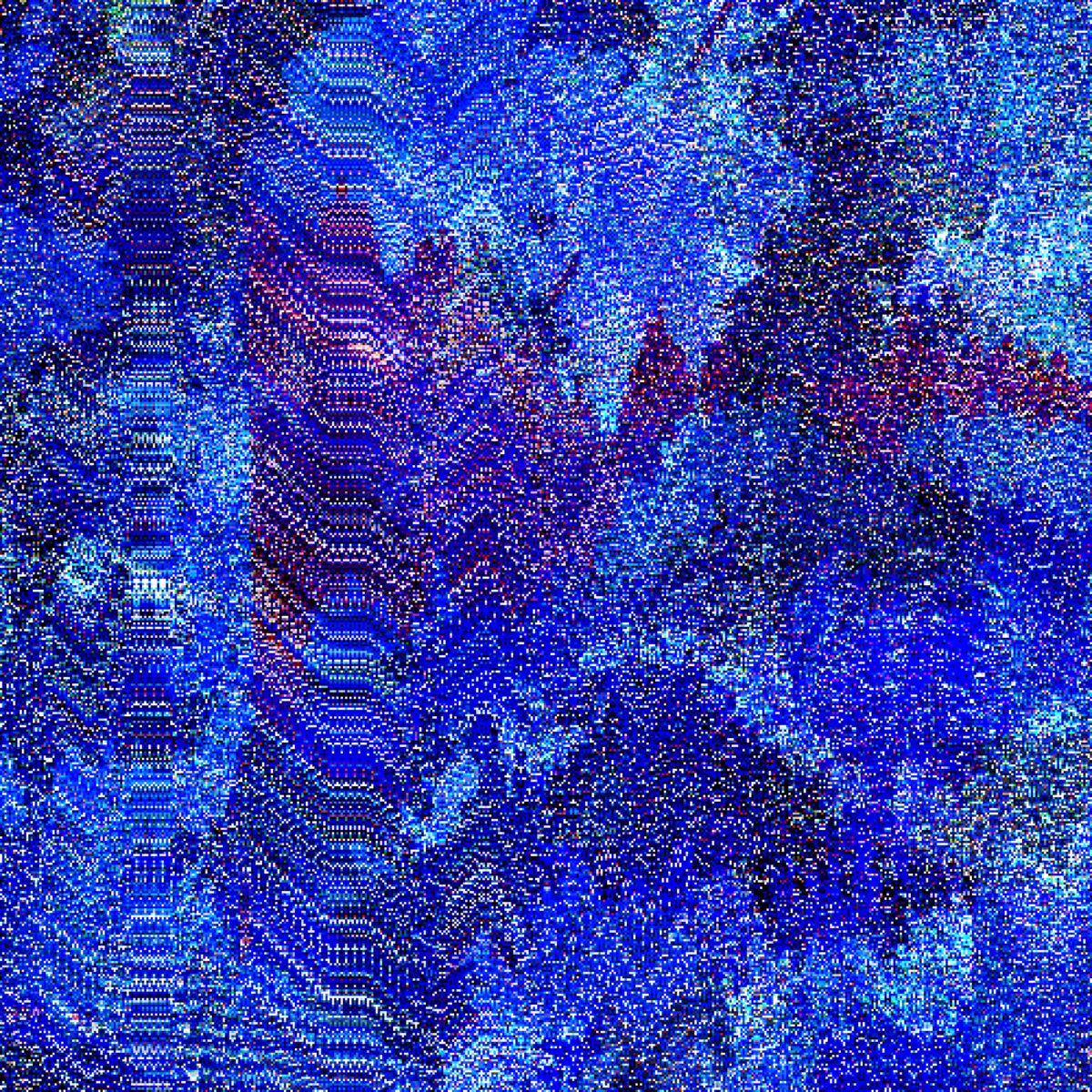Véritable work in progress, «Zapping» est le fruit de trois ans d’un travail de collection de séquences filmées à l’aide de la caméra du téléphone portable de l’artiste. La bande son proposée est le résultat d’un mixage de cinq chaînes télévisées sélectionnées par le photographe. Enrique Muñoz García s’intéresse dans ce travail à un moment intime de la vie quotidienne de tout un chacun, à savoir le zapping effréné devant le poste de télévision. Pour ce faire, il s’est filmé lui-même, ainsi que des connaissances établies à l’étranger, de la Suisse au Chili en passant par l’Espagne. L’intimité des séquences est exacerbée dans la mesure où les protagonistes sont nus, laissant ainsi la peau refléter les couleurs projetées par l’écran. Dans une volonté d’esthétisme et d’authenticité, le photographe s’est également refusé à retoucher la résolution des images filmées. En effet, il s’agit avant tout pour l’artiste de trouver une magie dans la réalité. Selon Enrique Muñoz García, «Zapping» se comprend comme le portrait d’une seule personne, représentée à travers une multiplicité d’individus. Nous assistons alors à un moment d’extrême intimité de cette entité unique – intimité qui tend au tragique, du fait de la solitude qui l’accompagne. «Zapping» réunit ainsi les thèmes de prédilection du photographe: son intérêt central pour la personne, l’intimité qui entoure cette dernière, le souci d’une recherche esthétique du réel. La thématique temporelle s’y rencontre également: la réalisation de l’oeuvre s’étend sur plusieurs années. De même, Enrique Muñoz García évoque le temps que l’on passe – qu’on le perde ou qu’on le gagne – devant l’écran de télévision. (Emily Fayet)
Année de production : 2008-2011
 Enrique Muñoz García
Enrique Muñoz García


S’intéressant aux nouvelles technologies et aux modes de représentations individuels et collectifs, Eva-Maria Raab a invité les « facebookers » du monde entier à lui envoyer un cliché de leur visage de profil pour son projet « YOUNIC / faceBOOK». Elle a ensuite transformé 100 portraits selon les visuels types des photographies génériques féminines ou masculines de Facebook qui apparaissent lorsqu’on n’en charge pas une soi-même. Ou comment individualiser un symbole homogène et bouleverser le quotidien. (cv)
faceBOOK goes Journées photographiques de Bienne
Eva-Maria Raab hybride votre portrait à la manière de l’image standard sur Facebook.
– Profil numérique: 40.- CHF
– Profil imprimé et signé (21 x 30 cm, c-Print), exemplaire unique: 300.- CHF, envoi compris
– Profil imprimé et signé (21 x 30 cm, c-Print), exemplaire unique avec cadre en bois de qualité supérieure et passe-partout (fait main): 600.- CHF, envoi compris. Le profil imprimé inclut également la version numérique.
Pour envoyer votre photo : info@evamariaraab.com
Année de production : 2012


L’exposition Women with Binoculars présente une sélection insolite d’images des sept photographes Magnum Carolyn Drake, Diana Markosian, Peter Marlow, Martin Parr, Mark Power, Peter van Agtmael et Alex Webb, dans l’espace public. Assemblage inédit réalisé par le curateur Enrique Muñoz García, cette série d’images représente des femmes en train d’observer un sujet «hors-champ», une scène qui se déroule en dehors du cadre de l’image à travers des jumelles. La présence des jumelles dans les images tend à rendre les femmes photographiées anonymes et leur permet d’être à la fois sujets et actrices de l’image. Alors que l’action de braquer ses jumelles sur un objet et de traquer visuellement une proie évoque la surveillance, le contrôle visuel, l’espionnage militaire, c’est-à-dire des actions souvent associées à la gente masculine, cet assemblage de photographies inédit nous invite à repenser le rôle social et politique de la femme dans notre système de représentation.
An Answer to Women with Binoculars est la réponse des étudiant-e-s de la classe professionnelle de graphisme de 2e année de l’Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne aux images assemblées par Enrique Muñoz García. Chaque élève, encadré par leurs enseignants, Dominik Müller et Roland Aellig, a réalisé un travail qui répond à une image. Les réalisations sont présentées dans l’espace d’exposition de l’Ecole d’Arts Visuels.
Réalisez-vous aussi une réponse en images à l’exposition Women with Binoculars et participez à notre concours photo en envoyant votre image sur Instagram avec le hashtag #Womenwithbinocularsbiel19 ou à l’adresse mail suivante: nermina.serifovic@jouph.ch jusqu’au 31 mai. Les gagnant-e-s du concours seront dévoilée- s lors de la remise des prix, le dimanche 2 juin à 16 heures, à la DISPO Halle, puis averti-e-s par courrier.


Globalement, la situation politique et économique actuelle démontre à quel point les conditions de vie peuvent basculer du jour au lendemain. Pour les artistes travaillant dans les régions frappées par les conflits, de tels chamboulements entraînent souvent une interruption du soutien financier, de l’accès aux partenaires et aux réseaux, ainsi que des opportunités pour produire et partager leur travail. En septembre 2022, des vidéastes et réalisateur·trice·s séjournant dans des zones de guerre ont été invité·e·s à répondre à l’appel à candidatures What are you working on?, leur offrant l’occasion de continuer à créer et partager leur travail avec un public international.
En décembre 2022, un jury international a désigné sept lauréat·e·s :
Ameen Abo Kaseem (Syrie)
Khin Thethtar Latt (Myanmar)
Moe Myat May Zarchi (Myanmar)
Olena Siyatovska (Ukraine)
Simon Mozgovyi & Tabor LTD (Alina Gorlova, Maksym Nakonnechnyi et Yelizaveta Smith) (Ukraine)
Usama Benyaala (Libye)
Vasyl Lyah (Ukraine)
Grâce à la bourse qui leur a été remise, les vidéastes et réalisateur·trice·s ont produit des œuvres qui ont été présentées pour la première fois aux Journées photographiques de Bienne en 2023. La projection a été suivie d’une table ronde, consacrée au soutien de la création artistique durant un conflit armé, en présence d’Anastasia Alexandrova, cheffe de projets chez Artlink, Annette Amberg, directrice de Coalmine et membre du jury, Sarah Girard, directrice et membre du jury, Reda Hamdy, artiste, curateur et membre du jury, Alexandra Talman, co-responsable Cultureloop Network. Rahel Leupin, directrice Artlink, a modéré cette discussion qui s’est tenue à la Bibliothèque de la Ville de Bienne.
L’appel à candidatures a été organisé par Artlink sur mandat du Fonds culturel Sud et a été réalisé en collaboration avec les partenaires suivants :
Journées photographiques de Bienne, www.bielerfototage.ch
Coalmine, Winterthur, www.coalmine.ch
FIT festival, Lugano, www.fitfestival.ch
Kaserne Basel, Bâle, www.kaserne-basel.ch


De prime abord, les photographies de la série «Weekend» évoquent le décor de certaines cartes postales, avec leur paysage grandiose et leurs couleurs vives, échos de nos propres souvenirs. Mais en y regardant de plus près, le spectateur est séduit à la fois par le cadre somptueux et par ce qui s’y déroule. Il est pris au piège, attiré et intrigué par ces individus affairés à être heureux en communauté avec eux-mêmes et la nature. L’harmonie de ces instants est palpable, les protagonistes ont parfois même l’air de poser. Il s’agit là d’un aspect central du travail d’Oliver Lang, cette recherche à partir d’un cadre choisi et une mise en scène entièrement due au hasard. Ses images dégagent une impression forte. On y devine une réflexion plus profonde et significative sur le sentiment d’appartenance et la place de l’individu dans la communauté. On a l’impression d’assister à un cérémonial du week-end, avec ses rites spécifiques. Oliver Lang s’intéresse au comportement des gens pendant leur temps libre, à leur conception de la nature et aux schémas qu’ils produisent. Par exemple, le rituel d’occupation d’une aire de repos, qui devient un modèle de représentation en soi. “Un modèle, et donc une façon de penser” selon le photographe. Dans les faits, il part d’abord en repérage sans son matériel. Puis, en général le week-end, il retourne sur place avec son Linhof Technika, appareil qu’il utilise toujours dans le cadre de ses projets personnels, muni d’un trépied et d’une bonne dose de patience. “Je cherche des lieux, des instants où quelque chose se met en place tout seul. Pour certaines images, j’interviens très peu, afin justement d’atteindre ce moment où l’on se demande s’il y a mise en scène ou pas. Cela prend du temps”. Le résultat est une collection étonnante marquée par la rencontre entre le hasard et une composition savamment orchestrée. Chaque être semble à sa place, fait part d’une communauté qui aspire, à travers des codes et rituels précis, aux mêmes petits bonheurs, dans un décor si suisse, si parfait. La série exposée ici fait partie d’un projet plus important entamé en 1999 et sur lequel Oliver Lang compte travailler durant plusieurs étés encore. (Michelle Joyce)
Année de production : 1999-
 Oliver Lang
Oliver Lang


La personne qui attend ne le fait généralement pas volontairement. Dans la série Waiting (2006), Iselin montre un vide de fait (une situation dénudée et en suspens) mais aussi un vide de contenu (des personnes au regard perdu dans le vide). Les lieux d’attente symbolisent les impasses de la pensée, de l’action et de l’être, qu’elles soient individuelles ou collectives. L’étroitesse d’esprit laisse les individus sans voix, l’échange – et précisément l’échange au sens artistique que Paul Nizon réclamait dans Der Diskurs in der Enge (1970) – reste absent. L’attente ne tend plus vers quelque chose de réjouissant et de porteur d’espoir. Au contraire, il s’agit d’une attente à laquelle nous sommes condamnés. Le tragique de la situation culmine dans le regard baissé et fixé par les feux des projecteurs. L’absence d’issue dans ces espaces claustrophobiques est bien plus qu’une métaphore de la vie comme salle d’attente. Ici, l’attente annonce déjà le terminus. Telle une invisible tumeur cancéreuse, elle répand ses métastases dans chaque recoin de notre être. Désillusions relationnelles, rupture de communication, perspectives refusées, même plus de conflit possible, tabula rasa : voilà les ingrédients de la désolante solitude qui nous retient prisonniers malgré tous les bavardages sans fil. Dans ses images, Iselin nous renvoie notre propre esprit du temps ; en tout cas, nous sommes bien loin du confort domestique auquel la série du même nom (Domestic Comfort, 2005) tente de nous rendre sensible.
Fritz Franz Vogel
 Roland Iselin
Roland Iselin


Nous sommes aux Etats-Unis. Chaque matin, les stations-service et les sorties d’autoroute sont les scènes du même bal. Des hommes attendent qu’une voiture vienne les embarquer pour un travail d’une journée. Si l’on veut avoir toutes les chances de son côté, il faut arriver tôt le matin et attendre. Attendre que quelqu’un daigne vous embaucher afin d’effectuer une besogne pour un maigre salaire qui peut atteindre cinq à dix dollars de l’heure. Sans papiers, ces travailleurs, souvent issus du domaine de la construction, sont contraints de se livrer à ce jeu pour nourrir leur famille. Le défilé des voitures et les heures se ressemblent. Les autorités ne viennent que très rarement interrompre cette routine. Jour après jour, Dom Smaz partage le quotidien des ces immigrés clandestins mexicains qui ont franchi la frontière dans l’espoir d’une vie meilleure. Avec la série « Wait Workers », le photographe nous livre les images de ces heures d’attente. L’exploitation de la main d’oeuvre clandestine est un phénomène qui ne touche pas uniquement le continent nord américain. En Suisse, ce sont des sans-papiers pour la plupart originaires des pays de l’Est qui guettent les voitures aux stations-service. Le domaine de prédilection de Dom Smaz est le reportage. Il s’intéresse au quotidien, au temps qui passe et à ses traces. Avec la série « Identités Clandestines » (2010), le photographe s’intéresse cette fois à la condition des milliers de sans-papiers établis à Lausanne. En floutant les signes distinctifs de ses modèles, Dom Smaz nie la fonction première du portrait : capter l’identité du sujet. Les traits de leurs visages sont indistincts, en mouvement, tout comme leur situation irrégulière aux yeux de la loi. (Noémie Richard)
Année de production : 2009
 Dom Smaz
Dom Smaz


Sous le titre « Wait and See » se dissimule un projet antécédent intitulé « A-venir. Le temps d’être suisse » (1998). Ce travail interrogeait le rapport de la Confédération helvétique au temps qui passe, au travers d’un agencement photographique évolutif, permettant au couple d’artistes de réfuter l’assimilation répandue de la photographie à une simple nature morte. La performance aujourd’hui réactualisée au Musée Neuhaus (Bienne) place au centre de la démarche le papier photosensible noir/blanc et la lumière, deux fondamentaux de la discipline. Dans ce retour aux sources qui confirme la tendance minimaliste empruntée par le duo de photographes, l’accrochage élaboré propose de faire revivre d’anciens papiers photographiques de qualités diverses, en les exposant à la lumière présente dans le lieu d’exposition. En un jeu subtil avec l’espace, la transformation chromatique des papiers peut alors débuter : selon leurs composants et la nature de l’impact lumineux, les surfaces planes se colorent de manière aléatoire au fil du temps. Afin de percevoir la progressive saturation des papiers, le spectateur est ainsi appelé à faire preuve de patience, à se figer quelques instants pour observer un processus latent, auquel le regard ponctuel contribue à donner du sens. Par cette mise en scène audacieuse, f&d cartier parviennent avec force et simplicité à élaborer un dispositif révélateur d’un temps vécu, dont seuls les médiums exposés, dès lors couverts de nuances abstraites, peuvent encore témoigner. (Pamella Guerdat)
Année de production : 2011
 F&D Cartier
F&D Cartier


Des hommes et des animaux dans des milieux urbains ou en pleine nature : avec sa série “Und die Tiere…”, Stefanie Becker capte des scènes quotidiennes auxquelles nous ne faisons plus attention. Les frontières qui séparent la nature et la ville peuvent nous sembler bien établies : il y aurait la nature sauvage d’un côté et la ville humaine de l’autre, deux territoires bien distincts. L’homme semble avoir investi la nature, créant des espaces urbains, dans lesquels il peut évoluer.
Mais avec la série “Und die Tiere…” il semblerait que la nature ait aussi envahi la ville, qu’elle soit présente sans que nous nous en rendions compte. La photographe cherche des instants qui lient ces deux mondes, créant alors des associations d’idées. Le tout forme un récit bigarré et poétique, mettant ces deux mondes au même niveau et cassant ainsi une certaine hiérarchie. Un récit qui interroge la distinction entre l’homme et l’animal. Serait-elle arbitraire ? Comme dit le dicton : chassez le naturel, il revient au galop. (Antoine Tille)
Année de production : 2008-2009
 Stefanie Becker
Stefanie Becker


Devant leur poste de télévision, en même temps à la même heure, à visionner le même programme ? Hong Kong, 9 heures du soir, décembre de l’an 2000. Repérant les transformations soudaines d’éclairage venant des bâtiments lors de ses balades nocturnes à Hong Kong, le photographe Georg Aerni réalise sa série « TV Time ». Elle nous présente une succession de façades illuminées par une multitude de petits carrés, comme des motifs qui se répètent. Mais une série de détails permet de les différencier ; tels que les tubes fluorescents qui donnent une lumière bleutée et concurrencent la luminosité orangée se dégageant d’autres appartements. Des éléments qui indiquent une diversité référant aussi bien à l’esthétique qu’au statut social de ses habitants et des quartiers où ils vivent.Ces tours semblent s’étendre à l’infini dans le ciel et matérialisent une ligne spécifique du paysage urbain s’exprimant par une répétition de verticalité qui s’étend à l’horizon. Des centaines de présences humaines sont ainsi suggérées sans jamais être rendues visibles sur les images. La vue frontale de ces buildings nous permet presque de pénétrer dans les appartements, dévoilant une intériorité construite par notre imagination. Une tension surgit entre l’impression de devenir des « voyeurs », tout en conservant une extériorité qui se situe au-dessus de la scène qui se joue devant nous. La structure architecturale de la ville contemporaine questionne Georg Aerni. Ici, il nous dévoile, en partie, sa réponse photographique de Hong Kong. Avec cette ville où l’accéleration d’une urbanité nouvelle se joue dans un contexte économique en plein essor, l’artiste nous permet de nous interroger tant sur nos propres images de la ville que de repenser nos activités quotidiennes face à la multitude d’individus qui nous entourent près de nous et ailleurs. (Julie Dorner)
Année de production: 1999–2000
 Georg Aerni
Georg Aerni


Les protagonistes de mon histoire sont les toreros, leur théâtre la corrida. Je n’avais eu que très peu de contacts avec le monde taurin, ayant assisté tout au plus il y a longtemps à une corrida lors d’un séjour en Espagne et gardé le souvenir de quelques photographies de Meyer et de Isabel Muñoz. Dans le Yucatán (Mexique), j’ai tout de suite été attiré par la poésie de la corrida populaire, par ses textures brutes ainsi que par la théâtralité de son déroulement. J’ai décidé de photographier les coulisses de cette tradition, l’attente, la préparation des toreros, les moments-clés précédant l’entrée du taureau, sans rien dévoiler au spectateur de ce qui se joue à l’intérieur de ces arènes éphémères. Les images de l’habillage du torero, apparentées au monde de la danse, dialoguent avec celles dévoilant sa vulnérabilité, ses blessures ; portraits posés laissant libre cours à sa fierté ou encore jeux de miroirs, reflets, morceaux de ciel, autant de petites touches impressionnistes nécessaires pour restituer le côté magico-réaliste de cette tradition. Au fil des semaines et des rencontres, je me suis mis à aimer et à respecter ces toreros mayas, leurs habits de lumière troués et leurs capes fatiguées. (François Schaer)
Année de production : 2006
 François Schaer
François Schaer


«Monter au grenier» se présente comme une métaphore de l’exploration de nouveaux mondes, de choses perdues ou oubliées, de disputes et de conflits quant à ce qui est à venir: il s’avère donc nécessaire de parler de positions et d’étiquettes. Nous savourons le fait que nos compétences respectives, en tant que partie constitutive de notre pratique individuelle, mutent à travers le développement de ce qui se réalise par la collaboration. Avec des objectifs indéfinis, des pépins, des malentendus et des différences d’opinion qui deviennent des souvenirs du temps passé à rechercher ce chemin indescriptible. Désireux de démasquer l’origine du sens de vs, nous sommes tombés par hasard sur VS comme terme standard utilisé en aviation pour parler de la vitesse de décrochage d’un avion ou de la vitesse minimale de vol à partir de laquelle l’avion est contrôlable. Ces deux origines semblent décrire assez justement notre collaboration à bien des égards.
Année de production : 2011
 Raphael Hefti & Alex Rich
Raphael Hefti & Alex Rich


Dans la série « Theatrical Suggestions (After Brouillet) », Balogh s’inspire d’une peinture d’André Brouillet (1857-1914), « Une Leçon Clinique à la Salpêtrière » (1887), qui montre comment le neurologue Jean-Marie Charcot (1825-1893) traite une patiente devant un parterre de collègues. On y voit une femme hypnotisée, renversée en arrière et retenue par l’assistant de Charcot qui la présente au collège des médecins.
Des comédiens célèbres ont étudié cette position particulière sur place, à la Salpêtrière. En 1928, les surréalistes ont même fêté les 50 ans de l’hystérie en se référant à Charcot. En s’intéressant aux études menées par Charcot sur les femmes hystériques, le photographe tisse un lien avec le discours qui affirme que l’hystérie se rapproche de la mise en scène théâtrale. Charcot lui-même décrivait dans ses documents photographiques des exemples spectaculaires de patients qui se comportaient comme s’ils jouaient le rôle de leur vie. La médecine moderne confirme que les symptômes apparaissent le plus souvent lorsque la personne se retrouve face à face avec un autre individu. Ce n’est donc pas un hasard si l’interaction hystérique apparaît comme l’archétype du rapport de force entre l’homme et la femme ; mais cette première interprétation s’inverse en seconde lecture de l’image.Avec ses « constructions théâtrales », Balogh thématise une interaction qui incarne à elle seule un jeu de scène. L’accent n’est pas mis sur la déviance, mais plutôt sur cet instant théâtral du laisser-aller qui ne donne d’autre choix que de conjuguer avec ce qui arrive. Comme dans l’interaction hystérique, la personne en train de tomber se présente sans aucune protection, molle et lascive. La comédie tendancieuse de l’hystérique confronte la personne lui servant de soutien à la question inéluctable de savoir comment réagir. Le visage éclairé, cette figure joue un rôle où se mêlent la sensation de protection et l’insécurité dégagée par l’opportunité. Ces personnages ambigus sont fiers, mais semblent comme pris au piège de leur propre instinct de protection. Ces images mettent en scène cet instant trouble, proche de l’impact symbolique généré par le jeu de scène, instant par rapport auquel le spectateur devra se situer.
Pascal Kaegi
 Istvan Balogh
Istvan Balogh


La Rockstar quitte la scène, trempée de sueur et droguée à l’adrénaline. Le glapissement des fans se fait sourd, relayé à l’arrière-fond. Matthias Willi documente à plusieurs reprises ce moment intime, la transformation d’une personne publique en une personne privée. Pour leurs fans ces êtres sont des demi-dieux. Il subsiste la tentation de croire que dans ces moments d’épuisement se manifeste un authentique, “vrai” visage. Juliette Lewis que Matthias Willi a portraituré dit : “C’est le seul moyen de montrer comment nous sommes réellement”. Pourtant, le sentiment qui nous gagne est que cette prétendue “tombée du masque” fait partie de la mise en scène. La musique rock vit du mythe de l’authenticité: des types extraordinaires, qui font leur truc sans broncher. Individualisme. Consistance. Authenticité.
La série d’images de Matthias Willi comprend encore un autre aspect: les stars sont les représentants d’un système complexe de fondation et de construction de l’identité. Ils incarnent un style de vie qui a été envisageable de cette façon à notre époque seulement. Malgré tout individualisme, ils sont aussi le rouage d’un système commercial. Le quotidien “on Tour” apparaît de façon prosaïque : cigarettes, serviette éponge, bière dans un gobelet en plastique. Derrière la scène, la machinerie de l’illusion se grippe: une moquette mal posée, des panneaux de fibres peints en noir, un monte-charge. A première vue, Willi semble y avoir posé son appareil et appuyé sur le bouton pour réaliser ses images. Pourtant, quand on regarde de plus près la lumière (provenant de la direction de l’appareil), elle est trop douce pour être un flash pop-up bon marché. Derrière l’esthétique tragique se cache professionnalisme et contrôle. Même la composition des couleurs et des images est d’un raffinement appréciable. (Simon Stähli)
Année de production : 2008
 Matthias Willi
Matthias Willi


Pour réaliser la série d’images The Mathematics of Regression, Clément Lambelet a récolté plus de cinquante-cinq mille images qui proviennent d’une base de données photographique d’identité judiciaire américaine (mugshots). Ces données, utilisées à créer des intelligences artificielles pour la reconnaissance faciale, sont construites selon des normes systémiques discriminatoires du système judiciaire. Afin de détourner ces portraits de leur but originel et de mettre à jour les dangers de leur usage, l’artiste a créé une intelligence artificielle qui assemble ces images par genre et âge. Les portraits qui en résultent sont les stéréotypes de cette banque de données. Les suspects algorithmiques sont dévoilés de manière anonyme grâce à une superposition d’images et des impressions lenticulaires qui permettent aux sujets de rester non-identifiables. Dans une société de contrôle, ce travail met en lumière les dangers que l’utilisation abusive de l’image peut avoir sur notre liberté individuelle.
La vidéo Reassuring White Noises, réalisée en duo avec l’artiste Valentin Woeffray, accompagne la série de portraits. En résonance avec le pouvoir technologique et ses dérives racistes, cette œuvre se concentre sur le pouvoir politique et médiatique. La vidéo interroge les excuses publiques suite à un acte ou un propos raciste: les gestes, mots et non-dits de politicien·ne·s, d’influenceur·euse·s ou de comédien·ne·s sont décomposés pour relever le caractère performatif et vide de sens de ces discours.
Grâce à une collaboration avec Belgrade Photo Month, le travail The Mathematics of Regression de Clément Lambelet sera présenté du 30.3.-12.4.23 à Belgrade, en Serbie.
Soutenu par : Pro Helvetia / Ville de Genève – Département de la culture et de la transition numérique / Polygravia
Année de production : 2019-2023


Catherine Leutenegger enquête, depuis quelques années déjà, sur le médium photographique et sur son contexte de production. A l’automne 2005, elle entame un projet sur les studios de photographes, avec en tête la volonté de sonder la réaction de ses collègues face à l’ère du numérique. La série “Hors-champ” en livre un reflet brillant. Le lieu de création d’images, espace intime, discret voire secret est ici percé et mis à jour. Pour cette série en couleur, la technique est irréprochable. Au choix de la lumière et du cadrage impeccables s’ajoute la finesse du détail ; cette maîtrise technique associée à l’originalité du sujet lui permet d’ailleurs de remporter le prix Manor 2007 du Canton de Vaud (Suisse). Après avoir écumé les studios de la région romande et grâce à l’obtention d’un atelier, elle poursuit son enquête à New York City. Cette fois, en plus de s’intéresser à ses comparses, elle développe une approche plus phénoménologique de son sujet. Elle quitte quelque temps New York et embarque pour Rochester, capitale du film photographique, aussi surnommée : “The Kodak City” ; ici, la focale se ressert, change de point de vue et passe de l’étude du lieu de production, à sa composante industrielle, soit la manufacture du film, du support-même. “The Kodak City” garde la couleur mais change de forme. Après les tirages en grand format de “Hors-champ “, l’artiste réalise un petit ouvrage agrémenté d’un texte expliquant ses intentions et sa méthode. Ce cahier (de bord), publié à compte d’auteur, propose une entrée en matière fertile sur le sujet épineux de la pellicule photo. Catherine Leutenegger présente en effet un commentaire personnel de la plus fameuse usine liée au monde de la photographie et de ses environs. Le constat est glaçant. Une succession de rues désertées, de magasins sur le déclin, de maisons en voie docude décomposition imminente ou avancée, un ciel triste et gris et enfin quelques entretiens pour venir achever ce tableau. Il n’y a plus qu’un pas à faire pour associer cette morosité à celle du marché de la pellicule. L’usine en elle-même garde une certaine superbe, de loin. A son approche, on découvre les immenses parkings vides, les intérieurs fleurent le désuet et les modes passées. Le processus de métamorphose est lancé et oscille entre abandon progressif ou obsolescence accélérée, par la révolution numérique. Si Rochester accueille les “quartiers généraux du groupe Eastman Kodak”, “leader mondial de l’image”, ce leadership semble désormais compromis. En tant que digne héritière de la tradition des cités ouvrières de Pennsylvanie ou du Michigan, cette ville s’organise et dépend en partie de la santé de cette entreprise. Cependant, n’ayant pas saisi l’ampleur et la radicalité de la révolution numérique, Kodak vit une situation de crise sérieuse depuis 1994. Ainsi, l’usine a démoli plus d’un tiers de ses bâtiments et procédé au licenciement de 30’000 personnes. L’enquête de la photographie sur les modalités de création d’une épreuve et sur des préoccupations d’ordre formelles et spatiales, aborde désormais l’impact de la révolution numérique de manière plus sociologique en touchant à des sujets aussi vastes que la crise économique et ses suites logiques : le chômage, le dépeuplement et l’augmentation de la criminalité vus à travers le regard de certains collaborateurs de Kodak. En outre, ce contexte dépressif a fortement inspiré le format et l’association texte image. Dans la solitude de ce voyage et le décalage de cette ville, Catherine Leutenegger s’est spontanément mise à écrire, pour se livrer, se sonder et tromper l’ennui. Le besoin d’explication de ses émotions, de celles des personnes rencontrées, est venu petit à petit se rassembler dans un carnet pour se cristalliser autour d’un récit : “Un livre fonctionne aussi très bien comme trace historique, il permet de mettre en boîte des instants à l’image d’un bocal de formol”. Cependant le livre permet aussi de souligner la notion d’usage et, pour un temps, de délaisser les exigences de l’oeuvre autonome et ses implications esthétiques, à savoir les dissensions entre art et document. Le monde moderne se renouvelle en permanence. L’oeuvre porte sur un pan du patrimoine industriel américain menacé par la destruction. Toutefois l’artiste ne se bat pas elle-même pour intervenir dans ce processus de disparition, mais tient à représenter le quotidien de son métier, de son art. En effet, Catherine Leutenegger ne prend pas parti et ne compte pas agir sur le sort de la pellicule. Elle procède à un travail d’enregistrement plutôt qu’à une volonté de changer le monde. La photographie se fait trace historique, avec comme résultante esthétique un rapprochement avec le “style documentaire” ou les vues de Stephen Shore. Si la firme Kodak, grâce à sa manufacture de pellicule, a joué un rôle prépondérant dans l’archivage de docuMetaments, elle ne semble pas vouloir faire l’objet d’une telle activité. En ouvrant ses portes, elle guide le visiteur le long d’un parcours prédéfini, sous haute surveillance. Catherine Leutenegger voudrait désormais continuer son enquête, mais se trouve pour l’instant confrontée à un mur de refus. La direction ne souhaite pas que l’on s’intéresse de près au démembrement de ses locaux et à l’avenir incertain de son développement. On peut s’imaginer les raisons tant émotionnelles que stratégiques qui motivent une telle réaction ; l’image de l’entreprise est en jeu. La tentative d’autopsie est donc momentanément gelée et la vocation documentaire de ce projet en suspens. La question du choix de l’appareil vient en abîme. Ne serait-il pas ironique de voir ce témoignage sur le destin de la pellicule être retranscrit en numérique? Or les deux sont venus se compléter. Un argentique (moyen format) était nécessaire lorsque la lumière se faisait rare et que le temps le permettait. Tandis que son appareil numérique reflex est venu prendre le relais dans les moments de photos à la volée. C’est donc avec un hybride que l’artiste a réalisé ce magnifique ouvrage. (Ariane Pollet)
Année de production : 2007
 Catherine Leutenegger
Catherine Leutenegger


Le titre de la série le laisse deviner, les travaux d’Alexander Odermatt s’inscrivent dans une continuité. A ce jour, il existe quatre séries intitulées “System Research”, qui interrogent toutes la problématique de la politique des flux migratoires. “System Research #1 Oder / Neisse” (2003) et “System Research #3 Bodycount” (2005) s’intéressent à la frontière entre l’Allemagne, la Tchéquie et la Pologne, et à ceux qui tentent de pénétrer illégalement dans l’espace Schengen. Toujours dans une démarche proche du documentaire, pour “System Research #4 Maroc” (2005–2007) Alexander Odermatt a travaillé dans des zones de passage entre le Maroc et l’Espagne afin de saisir la réalité et le quotidien des migrants des régions subsahariennes. La série présentée ici porte le titre “System Research #2 Intimacy”. Dès le premier regard, ces photographies sèment le trouble ; faisant inévitablement référence au genre du portrait par un cadrage rapproché, frontal et vertical et un arrière-plan neutre, elles sont pourtant dépourvues de leur constituant principal, le sujet. Restent des objets, un décor. On pourrait être tenté d’y voir une sorte de portait par les objets, devenus ainsi attributs et dont le rôle serait d’évoquer le modèle en son absence. Mais on perçoit tout aussi rapidement que l’omission du sujet est ici plus qu’un exercice de style : elle marque l’image d’une tension dramatique. Ces plans serrés sur les tables de nuit d’un centre de refoulement de requérants d’asile nous projettent dans l’intimité des migrants qui y séjournent. Une intimité toute relative – dans ces dortoirs qu’on devine sans âme – qui se résume à quelques effets personnels posés à côté d’un lit. Une brosse à cheveux, un livre saint, une bouteille d’eau, des icônes, de la nourriture, un tube de dentifrice ; toutes les possessions de ces migrants doivent tenir sur une table de nuit. Par l’absence du sujet, Alexander Odermatt attire notre attention sur la nature de ces objets, qui deviennent ainsi l’expression ultime de la condition humaine, de la culture et de l’identité : l’hygiène, la nourriture, la religion et la volonté de s’adapter. Par leur petit nombre, ils évoquent encore tout ce qui a été abandonné ou perdu dans le pays d’origine, les biens matériels mais aussi les biens immatériels. Ces objets ne sont pourtant au centre de l’attention que par défaut et mettent en évidence l’absence du sujet. En omettant l’élément principal de la composition, Alexander Odermatt parvient à concentrer notre intérêt sur l’individu et sur sa condition de requérant d’asile. Invisible parce qu’il se cache, parce qu’il ne correspond pas à la norme mais aussi et surtout parce qu’on ne veut pas le voir, parce qu’aux yeux des lois et des frontières il n’existe pas. Le photographe dit ainsi toute la difficulté d’être, d’exister, d’exprimer son identité dans la situation transitoire et déchirante qu’est la migration. Le décor dans lequel sont prélevés ces portraits, tout comme les objets, trahissent le dénuement des conditions de vie des requérants d’asile. Le dépouillement du mobilier, la froideur du métal et la blancheur des murs trahissent un lieu purement fonctionnel, neutre et froid, fait pour loger provisoirement et non pour accueillir, pour s’installer. Le confort minimum qu’on accorde aux requérants d’asile ne tolère pas l’expression de l’identité ni de la culture. Pourtant, à y regarder de plus près, ce qu’on aurait pu prendre pour des murs défraîchis ou tâchés, sont en réalité des restes de posters ou des photos, qu’on a affichés puis tenté de décoller ; des écritures plaquées sur la paroi – ce réflexe tellement humain de laisser une trace, si dérisoire soit-elle, de dire qui on est et qu’on est passé par là. D’exprimer son identité. (Anne Froidevaux)
Année de production : 2004
 Alexander Odermatt
Alexander Odermatt
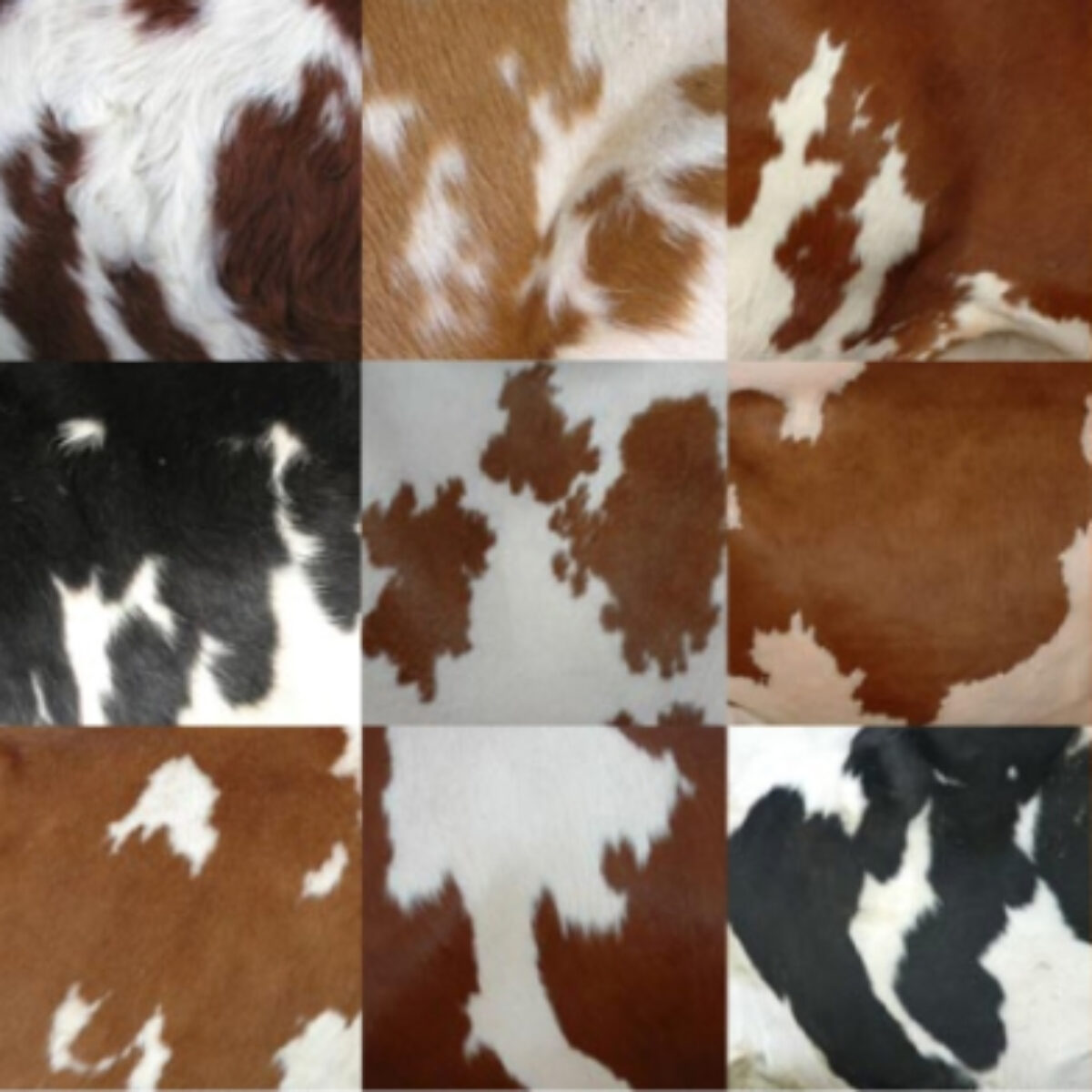
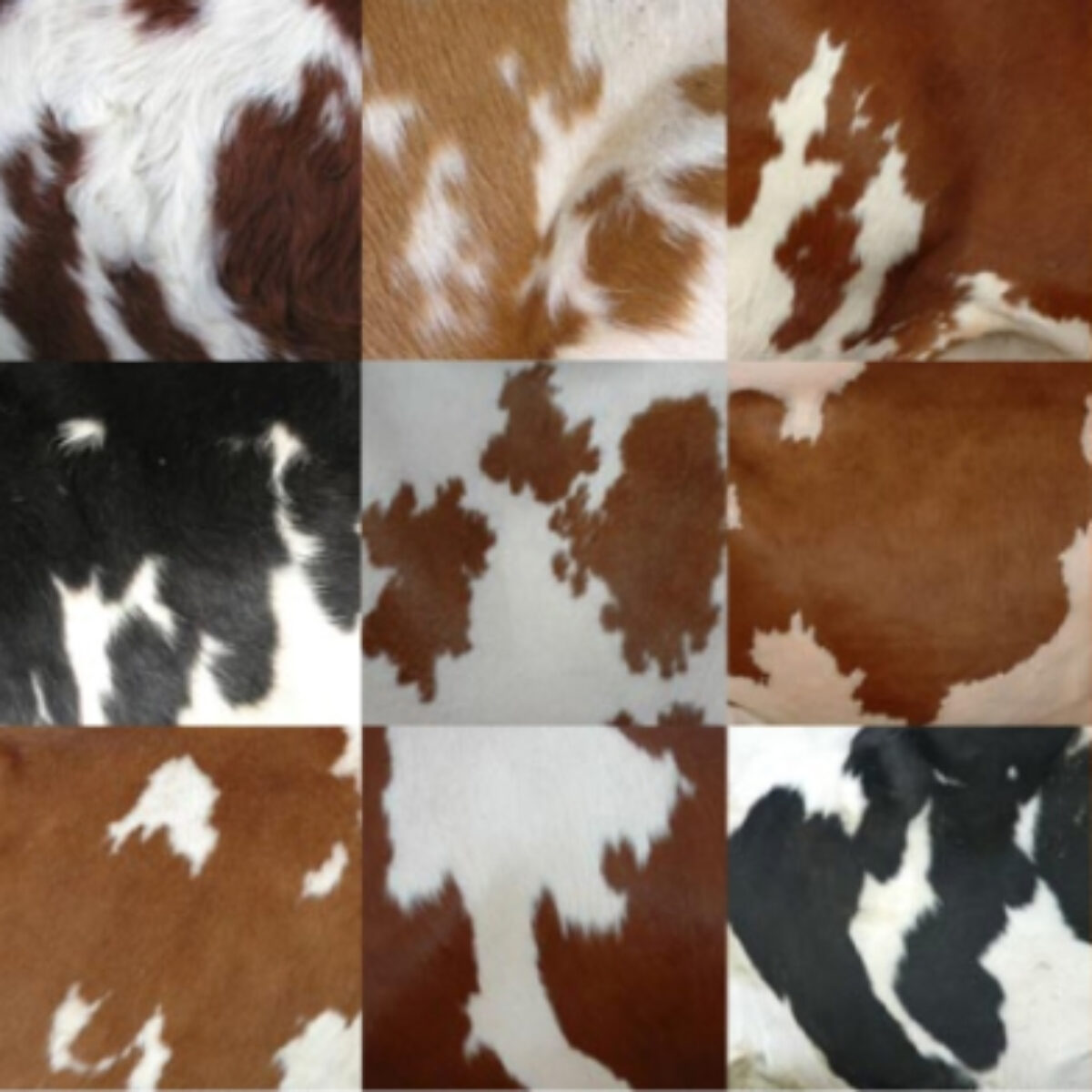
La Suisse contre le monde : une déclaration de guerre osée, disputée dans une confrontation de séries photographiques tout aussi affirmées, qu’une joute oratoire désarmante. Des photographies de motifs helvétiques font face à ces mêmes motifs pris dans des pays géographiquement et culturellement lointains – : Texas, Iran, Pôle Nord, Afghanistan, Chine. Ce ne sont pas seulement les traditions et les valeurs suisses qui sont questionnées, relativisées et poussées à l’absurde dans ces comparaisons directes. Dans un mouvement de combat extrême, des rois de la lutte bien accrochés, le visage déformé par l’effort, semblent être autant d’animaux, tels des taureaux de rodéo écumants, leurs efforts de combat réduits à néant dans le sable. La très actuelle burqa s’érige en monument contre le manteau de fourrure suisse antédiluvien. L’observateur est guidé par ce principe de confrontation entre un regard esthétisé et un regard naïf, qui enterre tout sérieux ou toute connotation politique avec charme et humour. La perspective frontale, la netteté remarquable et la qualité de couleur de toute les photographies, associées à une concept sériel, reflètent les valeurs démasquées des thématiques éclatantes des motifs photographiés. La Suisse gagne finalement, dans un modeste mais triomphal oh oh ! (Katja Willi)
Année de production : 2001-2010
 Riverboom
Riverboom


Le projet « Surveillance Panorama » rassemble des photographies panoramiques obtenues par la mise en commun d’une multitude d’images, réalisées par une webcaméra programmée par ordinateur, assemblées sous la forme d’une suite chronologique. Dans « Temporary Discomfort » et « Fabre n’est pas venu », Jules Spinatsch s’intéresse à la politique: le World Economic Forum de Davos, les sommets du G8 et une séance du Conseil Municipal de Toulouse. Dans chaque cas, la caméra enregistre des images à intervalles réguliers, entre trois et quatre secondes. Les seules données définies a préalable par l’artiste sont la durée de prise de vue et l’endroit où est fixé l’appareil. Dans les puzzles spatio-temporels ainsi obtenus, la densité d’informations visuelles ne parvient pas à restituer l’événement dans son entièreté. Le moment fort laisse place à un rendu global réalisé grâce à l’assemblage de moments arbitraires. Le photographe se distancie du spectaculaire et de l’image contrôlée que le spectateur reçoit passivement de la part des médias. Tous les éléments de l’action sont traités de la même façon, sont placés au même niveau, ce qui pousse le spectateur à véritablement regarder l’image et l’interpréter. Dans son deuxième panorama (« Heisenberg’s Offside ») l’artiste relie sa manière de traiter le fait, l’information au principe d’incertitude découvert par le physicien Werner Heisenberg, stipulant que lors du calcul de l’emplacement précis d’une particule, sa vitesse ne peut être mesurée qu’approximativement. Ainsi, dans l’image créée par Spinatsch n’apparaît jamais l’acteur principal du match sur lequel focalisent les caméras, le ballon rond, celui-ci est hors-jeu (offside). Son absence de l’espace est due au morcellement temporel qui, contrairement aux images des médias, n’est pas gommé du résultat final, une perte de contrôle est acceptée pour rendre compte de la dimension spéculative de l’enregistrement d’un événement. (Melissa Rérat)
TEMPORARY DISCOMFORT, CHAPTER IV – PULVER GUT, 2001–2003; HEISENBERG’S OFFSIDE, 2005–2008; FABRE N’EST PAS VENU, 2006
 Jules Spinatsch
Jules Spinatsch


La série Stand-ins convainc d’emblée par sa perfection formelle. Chaque personne représentée est positionnée au centre de l’image et intégrée dans son propre environnement. Le cadrage est soigneusement choisi, le tout apparaît propre, calme et clair. Nous pourrions penser qu’il s’agit d’une série de portraits classiques, mais un certain nombre de détails emplis d’humour viennent contrecarrer l’aspect sérieux de la composition. Il y a indéniablement une part de spontanéité, d’inachevé et de provisoire dans ces images. Il est habituellement impensable qu’une personne sur un portrait représentatif ait les yeux grands ouverts ou totalement fermés, ou qu’un ballon lui masque la tête. Ceci devient justement possible dans la série Stand-ins de Bertschi. Les photographies oscillent entre mise en scène parfaite et prise sur le vif, laissant le spectateur dans un doute constant. Le caractère vivant de ces images est dû à leur mode de production et à leur fonction initiale. Stand-ins est un produit accessoire du travail photographique que Markus Bertschi fait sur mandat. Avant l’arrivée du chef d’entreprise dont il s’agit de faire le portrait, le photographe teste la situation spatiale à l’aide de n’importe quelle personne ou à la rigueur aussi à l’aide d’un objet. Grâce à ces prises de vues préparatoires, il peut anticiper les proportions et les conditions d’éclairage qui prévalent et installer l’appareil photographique en conséquence. Alors que le travail de commande demande un maximum de mise en scène – une mise en scène dans le sens où ce qui figure sur la photographie doit être minutieusement réfléchi pour communiquer une image intéressante de l’entreprise, sans toutefois révéler la dimension artificielle de la situation – le Stand-in, lui, est l’image préparatoire spontanée. Dans ces photographies, le hasard est présent à travers les personnes-test, mais la future mise en scène est déjà perceptible dans l’espace qui les entoure. S’instaure alors un rapport de tension qui fascine l’observateur et confère à Stand-ins les qualités d’une série à part entière.
Nora Fiechter
 Markus Bertschi
Markus Bertschi


L’installation de Romain Roucoules nous plonge d’emblée dans la thématique «Flood». Aujourd’hui, les expositions génèrent elles aussi, de manière indirecte, une certaine quantité d’images «collatérales» diffusées sur les réseaux sociaux par les spectateur-trice-s et divers-e-s intervenant-e-s proches ou lointain-e-s. Ces images immatérielles sont vouées à faire partie d’un flux et n’existent pas en dehors des conditions imposées par le réseau social sur lequel elles sont postées. En utilisant un dispositif d’impression adapté à la nature inconsistante de ces images, Romain Roucoules tente de transposer ce flux immatériel en flux physique tangible. Au fil du temps, la masse de matière persistante augmente et devient une sculpture évolutive qui témoigne des usages des réseaux sociaux.
Partagez votre image sur Instagram avec le hashtag #floodedbiel pour alimenter l’installation Social Printer!
Année de production : 2019


La «Shoe Box» de Seba Kurtis ne fait pas référence à l’objet lui-même, mais à son contenu : des clichés de famille, laissés loin derrière elle, dans une boîte à chaussures, alors que, sous la pression de la crise économique et politique, la famille fuit Buenos Aires; ses membres deviendront des immigrés illégaux en Espagne. Récupérés des années plus tard, les instantanés sont abîmés, marqués par le temps et un dégât d’eau. L’attention à l’aspect esthétique de ces traces de destruction permet au photographe de créer un monde riche de sens dans lequel l’identité et la mémoire jouent un rôle important. Les rectos et les versos mettent en évidence l’apparence picturale de ces empreintes abstraites laissées par le temps. Le support brillant, rongé et décoloré, laisse apparaître des taches diffuses, comme des fumerolles s’échappant de l’émulsion. Le photographe met ainsi en évidence l’instabilité du procédé chimique qui semble fonctionner comme une métaphore de la mémoire s’érodant et changeant au fil du temps. Ceci évoque la nature éphémère de notre condition humaine que l’artiste a expérimentée de très près à travers les années passées comme clandestin. En réinterprétant son album de famille, Seba Kurtis participe à cette interrogation constante de l’art contemporain: un questionnement du sens et de la forme de l’archive, de la mémoire, de la représentation du passé. Le photographe joue sur la double dimension du langage de la photographie de famille: reflet commun de la mémoire familiale et source d’information historique. La «Shoe Box» fonctionne comme un marqueur de temps, symbolisant cette rupture biographique, l’«avant» et l’«après», marquée par l’expérience de la migration. La composition des images, les scènes de vie représentées apparaissent comme familières, à travers le souvenir de nos propres albums de famille. Seba Kurtis offre ainsi un témoignage de sa biographie dont la mise en mémoire nous renvoie ultimement à la nôtre. (Evelyne Pfeifer)
Année de production : 2008
 Seba Kurtis
Seba Kurtis


Inéluctablement et patiemment, la recherche scientifique étend notre connaissance, l’organise et la remet en question. Derrière cette gigantesque entreprise rationnelle se cache tout un univers peu connu du public. Il compte autant d’échecs que de succès, recèle des instants de beauté arrachés au hasard, et se construit à partir d’innombrables questionnements patients et têtus. Autant d’histoires racontées en images par les près de 450 œuvres soumises au Concours FNS d’images scientifiques organisé par le Fonds national suisse (FNS). Les Journées photographiques de Bienne exposent les œuvres primées sélectionnées par un jury international: des photographies et des vidéos qui dévoilent la face cachée de la science. (Daniel Saraga)
Une rencontre publique mettra en perspective la place de l’image dans les sciences. Elle réunira Luce Lebart (Archive of Modern Conflict, Londres), Joël Vacheron (ECAL) ainsi que Francesco Panese et Gianni Haver (Université de Lausanne) le samedi 18 mai de 9h à 12h30.
En collaboration avec le Fond national suisse la recherche scientifique (FNS).


Sur les murs blancs sont accrochées de grandes feuilles, elles aussi d’une blancheur immaculée. Des néons de lumière noire bourdonnent au plafond. Les heures passant et l’obscurité grandissant, la lumière des tubes dominent et laissent apparaître les sérigraphies. Les portraits de toxicomanes font alors face aux solanacées. Les images de «Schwarzes Licht» fluctuent entre présence et absence. Le cycle d’apparition et de disparition varie en fonction de la nature et de l’intensité de la source lumineuse. L’expérience visuelle du spectateur est donc soumise au temps, tant dans le sens de météorologie que de durée. Visibles dans la nuit, les corps humains et végétaux s’effacent à la clarté. Cette inversion entre visibilité/invisibilité et jour/nuit renvoie directement à la confrontation vie/mort. Ces images latentes se révèlent à qui patiente suffisament pour les voir ou peuvent surprendre celui qui ne les attend pas. Dans sa démarche artistique, Nicole Hametner cherche à révéler le caractère troublant de ses sujets. Il n’est pas étonnant que la nuit tienne une place centrale dans son travail, tant comme sujet que comme décor («L’Heure bleue», «Le Sapin»), que comme condition sine qua non («Schwarzes Licht»). Nicole Hametner ne cache pas son intérêt pour le romantisme et la psychanalyse. Lorsqu’elle parle de «Schwarzes Licht», elle fait appel à Freud et à la mythologie. La belladone (Atropa) renvoit directement à la figure d’Atropos. Les trois Moires fabriquent (Clotho), déroulent (Lachésis) et tranchent (Atropos) le fil de la vie. En psychanalyse, le long fil de la puissance vitale est structué par une suite de situations engendrées par des coupures. Telle Atropos, la nature de la source lumineuse vient structurer le cycle apparition/disparition, vie/mort des images de «Schwarzes Licht». (Noémie Richard)
Année de production : 2010
 Nicole Hametner
Nicole Hametner


Des entassements d’obus, des caisses empilées contenant de vieilles armes ; des armes en train d’être démontées ; des hommes qui exécutent ce travail. A côté, des personnes dans les transports publics, au café, au bar ; des quartiers de logements. Steeve Iuncker décrit par des diptyques une image de la ville de Sarajevo encore marquée par la guerre, treize ans après la fin du siège des paramilitaires serbes, qui a duré presque quatre ans et pendant lequel plus de 10’000 personnes ont été tuées. Dans le cadre d’un programme par lequel elle soutient financièrement la destruction des anciennes munitions, qui ne proviennent pas seulement du temps de la guerre, l’Union Européenne a chargé Steeve Iuncker de documenter ce désarmement. Eu égard aux traces de la guerre clairement visibles, il aurait semblé hypocrite au photographe de se limiter au sujet demandé sans décrire l’atmosphère et la tension actuellement présentes dans la société. Steeve Iuncker expose donc ses photos en diptyques : des photos statiques, prises dans l’usine d’armement, où les armes sont traitées, sontopposées à des photos de la société actuelle, dominées par l’histoire et la vie. Les photos en noir et blanc soulignent le lien évident avec l’histoire récente. Iuncker décrit la guerre avec un décalage temporel – les images connues de la guerre sont différentes. En liant son reportage sur la destruction des armes à une documentation sur la vie à Sarajevo, il montre le « collatéral » au sens littéral, dont l’importance pour lui dépasse de loin le travail commandé. Celui-ci, aussi bien que son origine, est par conséquent mis en question d’une manière critique. (Mariana Forberg)
Année de production : 2009
 Steeve Iuncker
Steeve Iuncker


«Reworks» est une collection d’images numériques rassemblée par Alexis Guillier. Elles ont toutes pour sujet des œuvres d’art touchées par une détérioration physique accidentelle ou volontaire. Sous la forme d’un diaporama, ces images sont diffusées aléatoirement sur un ou plusieurs moniteurs juxtaposés. «Reworks» présente un entrelacement complexe de temporalités que nous pouvons répartir en plusieurs strates. Il y a tout d’abord le temps de la création et de l’évolution de l’œuvre originale. Puis une agression violente vient tout interrompre, poser sa marque. Témoin de cet acte de vandalisme, la photographie le capte et le momifie en image. Dès lors, deux temporalités évoluent parallèlement: celle de l’oeuvre «physique» qui, au fil des années, continue à se dégrader ou peut être réparée; et celle de l’image photographique. Cette dernière est un objet complexe qui contient à la fois la temporalité de son sujet et sa propre temporalité. Si un cliché développé sur papier connaît lui aussi une dégradation concrète, quant est-il d’une image digitale? Les questions que soulève sa nature immatérielle sont nombreuses. La technologie numérique lui confère-t-elle un caractère intemporel? Finalement vient le temps de la projection (durée définie ou en boucle, défilement aléatoire des images) et de la réception de l’œuvre par le spectateur. Les images défilant aléatoirement sont autant de souvenirs qui créent la mémoire de l’homme. Comme les œuvres photographiées, ces souvenirs sont souvent altérés. «Reworks» peut être abordé comme une réinterprétation de l’histoire. Ce n’est pas tant le sujet que fixe la photographie, mais l’événement qui l’a marqué. Ainsi ces œuvres deviennent les symboles de faits passés ou actuels. Véritable musée imaginaire à l’ère du numérique, «Reworks» compose à la fois un récit historique et fictionnel. (Noémie Richard)
Année de production : 2009
 Alexis Guillier
Alexis Guillier


Comme le présage son titre, la série “RC 35MHz” – en référence à une fréquence de radiocommande qui permet de contrôler à distance un modèle réduit d’avion – se livre ouvertement à l’expérimentation technique et laisse le photographe sur le seuil du processus créatif. La démarche d’Alexander Jaquemet procède du voyage, ou plus exactement de l’égarement saisi par un mouvement de caméra aussi insolite qu’aléatoire, à savoir libre de toute intervention humaine. En écho aux campagnes de cartographie de la fin du XIXe siècle, l’artiste met en place un dispositif de capture d’image situé à l’orée du bricolage et des technologies les plus actuelles. Il se sert d’une caméra vidéo volante, d’un avion télécommandé à obturateur, un observateur mobile et autonome. Cependant, contrairement aux enquêtes scientifiques des temps modernes ou à leur pendant contemporain – les conquêtes du microscope électronique ou du satellite –, cette recherche s’inscrit résolument dans un registre poétique plutôt qu’objectif. Si traditionnellement l’imagerie aérienne s’efforce de rester au plus près du réel, bien que le renversement de la perspective conduise immanquablement à la déformation des volumes et à une forme d’abstraction ; ici la précision ne semble pas de mise, bien au contraire. Tel un flâneur, l’appareil dérive, libre comme l’air, et nous offre des vues aussi obliques que floues ; l’évocation d’un passage fugace. Cette chorégraphie aérienne dégage une fluidité de mouvements qui résonne dans d’autres séries réalisées par l’artiste : “L’heure bleue”, dont le point de vue frôle un sol boueux ou encore “Aqua”, qui immerge l’appareil en eaux troubles, dans une invitation à voyager au plus près des éléments. (Ariane Pollet)
Année de production : 2008-2010
 Alexandre Jaquement
Alexandre Jaquement


La série Première fois (2005) met en scène les événements que la mémoire retient comme des premières fois. Vivre les choses pour la première fois n’a en soi rien de singulier. Mais ces étapes de la vie revêtent une dimension toute particulière lorsqu’elles ont lieu durant l’adolescence qui – plus que tout autre âge – est sans doute celui où de nouveaux mondes s’ouvrent à soi. Ainsi, le premier baiser, la première beuverie, la première voiture constituent autant d’événements qui signifient – par leur déroulement parfois ritualisé, voire par leur caractère transgressif – le franchissement d’une étape. Dans la série Héros (2006), le ton est donné par la posture et le regard de ces individus qui se preséntent tels des champions. Bien que leurs performances restent invisibles, les médailles qu’ils portent et leur attitude sévère nous poussent à croire qu’ils ont indubitablement accompli quelque chose. Mais ils pourraient tout aussi bien être des imposteurs… La performance en tant que telle se limite ici à une construction visuelle, où accessoires et emblèmes suffisent. Qu’il s’agisse de véritables héros ou de simples modèles photographiques, ces représentations renvoient à des mises en scène codifiées d’un passé absent.
Fritz Franz Vogel
 Olivier Pasqual
Olivier Pasqual


Thomas Rousset met à profit ses origines rurales dans le développement de sa démarche artistique. Le village de Prabert (Isère, F), où il vécut une partie de son enfance, constitue depuis trois ans le théâtre de ses mises en scènes. L’artiste y est sensible à la dimension singulière que prennent le temps et l’espace : «Les choses et les gens paraissent anachroniques, tels des décors fictifs sortis de chroniques oubliées». Partant du monde réel, il imagine un univers qu’il nourrit d’archétypes et de souvenirs propres. Naissent alors des espaces fantasmés où la routine et l’étrange se côtoient pour dessiner des situations improbables renvoyant à une sorte de réalisme magique, voire de mysticisme.
La qualité du lieu et le besoin d’un certain chaos lui servent de point de départ. Les hommes y prennent des postures théâtrales mais les animaux, acteurs à part entière des rites campagnards, y occupent aussi une place essentielle. Comme dans cette image où l’artiste a habilement disposé un cadavre de martre près du foyer crépitant d’une cuisine baignée par une lumière savamment mélangée. Ou encore cette autre photographie qui montre quelques poules (les victimes de la martre !) suspendues au plafond par les pattes. Elles flottent au-dessus d’une table que quelqu’un semble avoir quittée précipitamment. Les objets jouent également un rôle central : la vieille deux CV prend des allures de char agricole, une éphémère construction devient un mammifère fantastique à partir du squelette d’un mouton. Exubérantes, subtiles et féeriques, ses photographies offrent une perspective inédite sur le monde rural. Alimentées de références picturales, elles flirtent avec la frontière poreuse entre réel et imaginaire et induisent un doute fondamental qui pousse l’observateur à remettre en cause ses convictions sur la vie à la campagne. (Daniel Mueller)
Année de production : 2009
 Thomas Rousset
Thomas Rousset
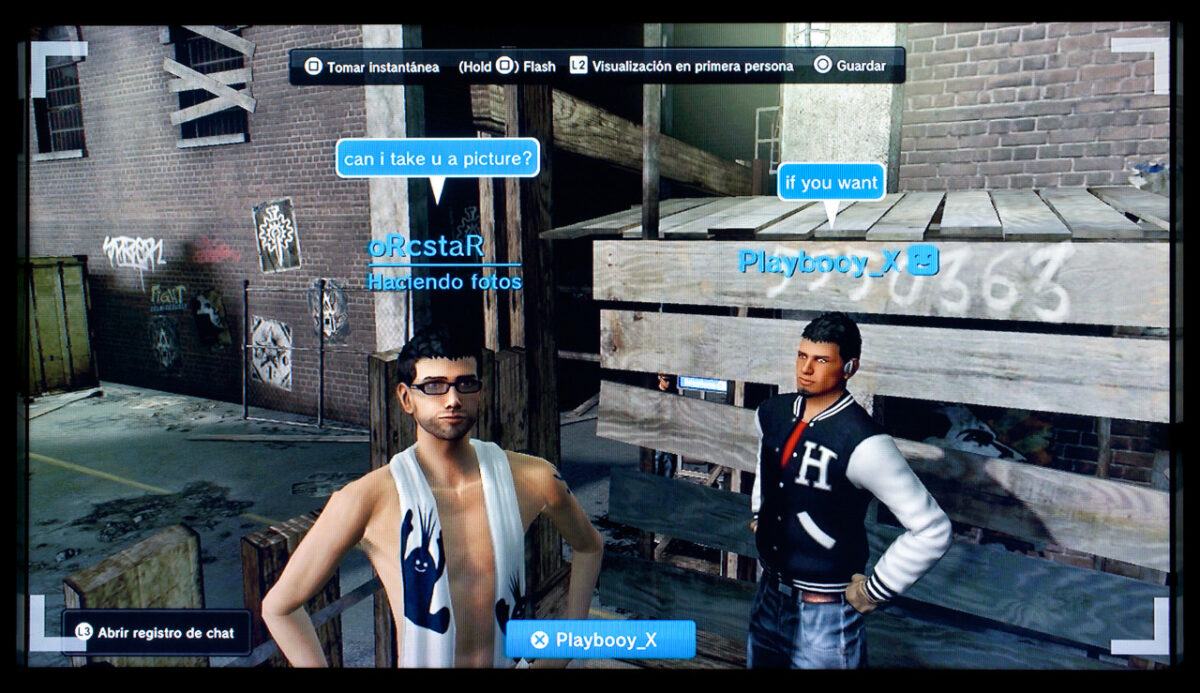
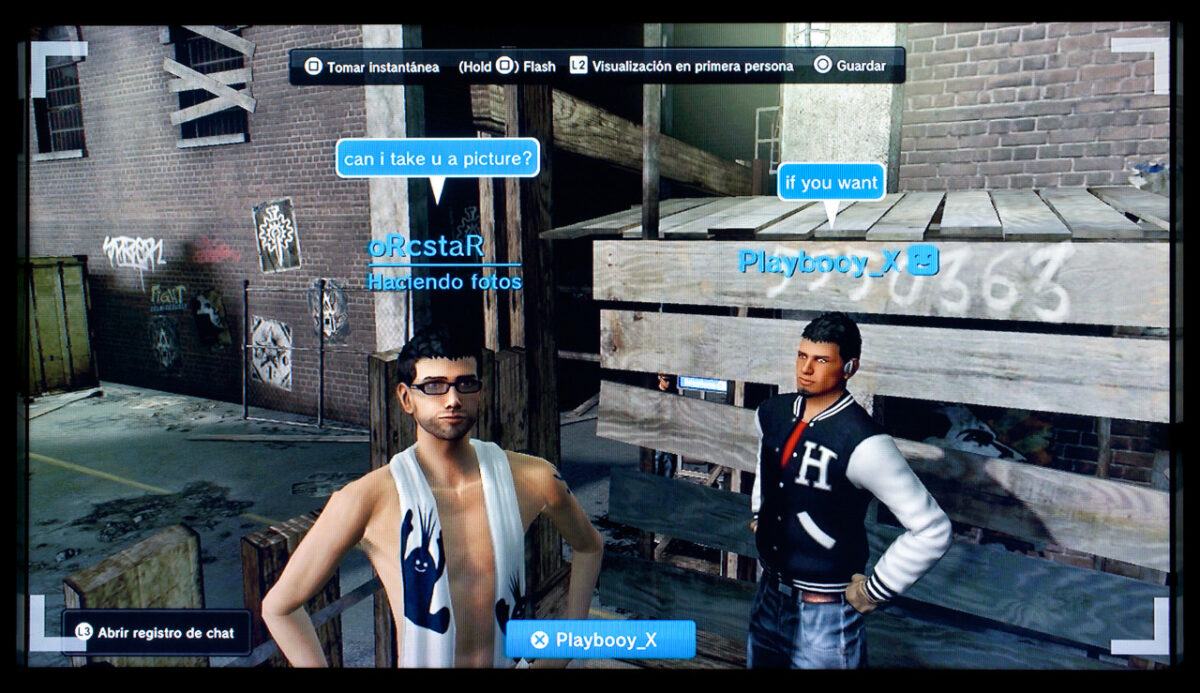
Aujourd’hui, les écrans jouent un rôle toujours plus important dans nos vies. Les interactions sociales se font en majeur partie sur les réseaux sociaux : on chat avec sa famille sur Whatsapp, on recherche l’amour sur Tinder et on tisse des liens d’amitiés sur les plateformes de jeux en ligne. Avatars photo-réalistes et algorithmes complexes, ces phénomènes sont à l’origine de la transformation radicale que vit aujourd’hui la pratique photographique contemporaine. Comment les photographes se définissent-ils dans ces espaces virtuels?
Simone Niquille, Roc Herms et Alan Butler mèneront parallèlement et pendant une journée entière trois workshops ouverts aux professionnels du monde de la photographie. Guidés par ces artistes, les participants exploreront le monde virtuel et interrogeront les notions de représentation et d’identité à travers la photographie.
Les résultats des workshops seront ensuite exposés dans le cadre du festival. Photographing Virtual Spaces est organisé en collaboration avec le programme SITUATIONS du Fotomuseum Winterthur. Le workshop sera également montré sur le site web du Fotomuseum Winterthur, sous la rubrique SITUATIONS/Follower.
Workshops
5 mai 2018, de 10h à 18h à l’Ecole d’Arts Visuels Bern et Bienne.
Les workshops auront lieu en anglais.
Inscription: https://goo.gl/forms/xdFEbmaF8LBykixf2
Les workshops sont gratuits. Inscription obligatoire jusqu’au 30.4.2018.
Pour toutes questions veuillez contacter: digitalintern@fotomuseum.ch
Exposition Photographing Virtual Spaces : 6 – 27 mai 2018
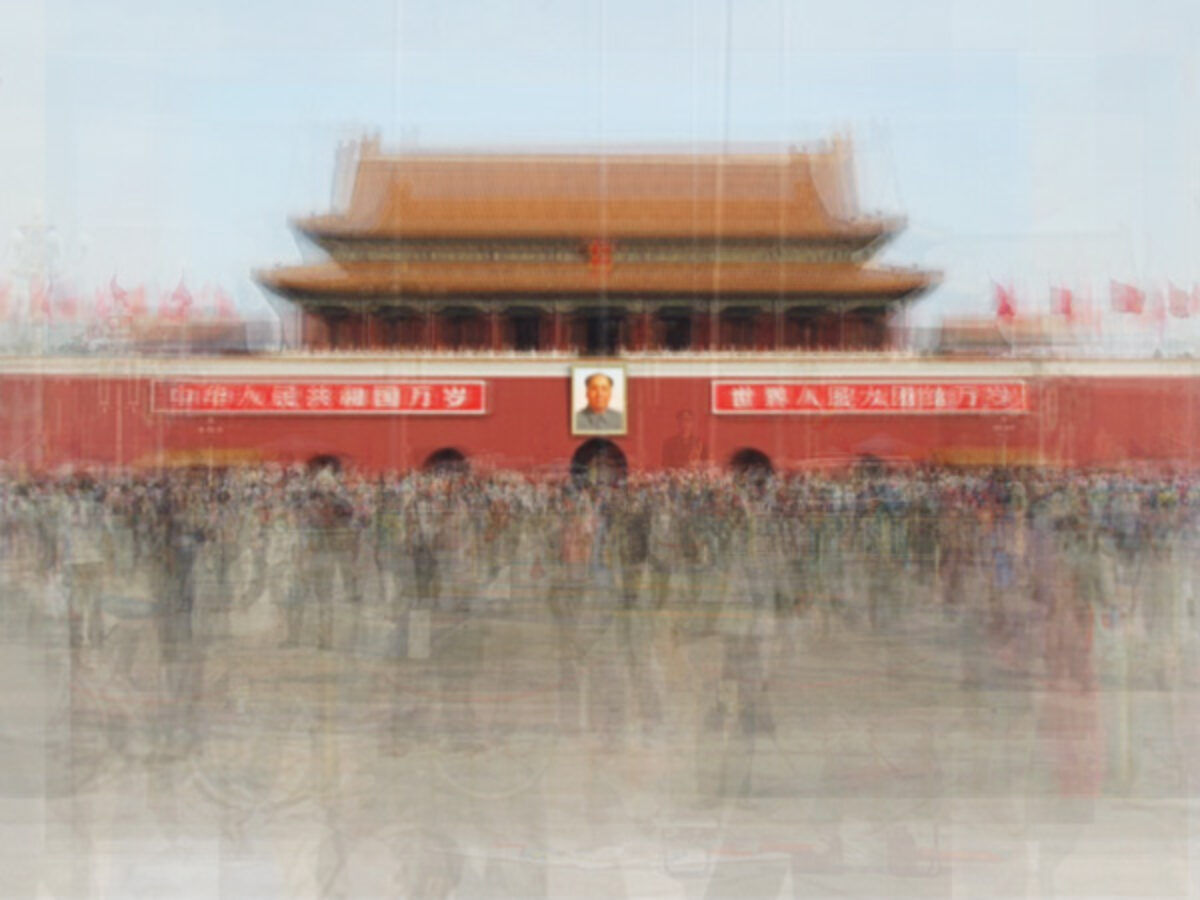
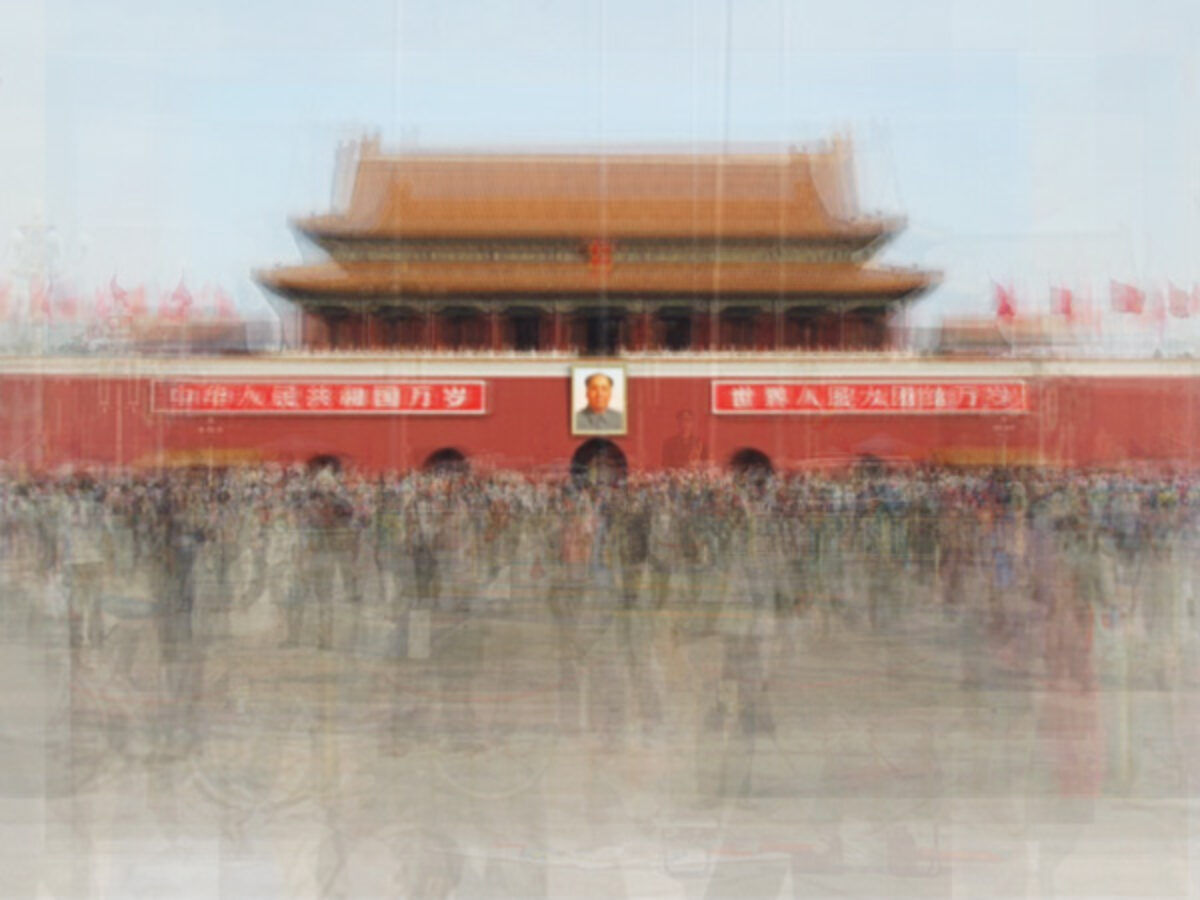
Dans sa série “Photo Opportunities”, Corinne Vionnet nous emmène à travers le monde à la re-découverte visuelle de différents monuments ou sites touristiques. En collectant sur le web des centaines de photos souvenirs prises par des anonymes, elle les superpose en couches successives rendant compte d’une vision inédite de ces différents landmarks ou points de repères qui dominent le paysage. Dès les premiers instants, on reconnaît l’image prise et reprise par un nombre incroyable de clichés, révélant que ces monuments s’imposent dans notre mémoire collective et deviennent les symboles de telle ville ou de tel pays; reflets de nos désirs d’ailleurs et de voyage. Ces montages photographiques déroutent nos regards. Ils bousculent nos stéréotypes construits au travers de nos souvenirs vécus ou imaginés en se détachant de la représentation fidèle de la carte postale. Surprenante, cette compilation de clichés permet une inversion inattendue des registres en faisant apparaître des traits qui hésitent entre le dessin et la peinture. La précision des traits qui se réduit sous l’effet de la multiplication permet paradoxalement de donner une impression de mouvement à cette matérialité immobile. Mais ces effets de croquis révèlent les innombrables variations des photos souvenirs qui composent ces images, dévoilant par touche l’importance de chaque regard. Exprimant la tension entre le particulier et l’identique, face à la représentation unique de ces sites touristiques que l’artiste rend alors possible. Au cœur d’une réflexion percutante sur le medium de la photographie, Corinne Vionnet nous incite à penser notre façon de donner sens aux lieux visités lors de notre expérience d’ “être un touriste”. (Julie Dorner)
Année de production : 2006-2010
 Corinne Vionnet
Corinne Vionnet


Les vues panoramiques des villes de Bienne, Berne, Genève et du Caire ne sont pas des clichés habituels. Elles ne donnent pas une simple vision d’ensemble, elles provoquent aussi un sentiment de vertige, car l’habituel devient étranger. Cette sensation résulte du fait que le regard ne peut suivre l’angle visuel présenté, car la perspective donnée aux différents lieux et quartiers par le photographe dépasse les 360 degrés. L’angle de vue que l’œil humain peut parcourir ne dépasse pas une envergure de 140 degrés. Pour créer cet effet, Arno Hassler a eu recours à une lentille panoramique, qu’il a lui-même créée, en forme de cylindre amovible avec un angle circulaire et continu. L’image est prise comme un cliché circulaire et panoramique, puis présentée en deux dimensions au visiteur.Ce qui est normalement saisi en tournant sur l’axe de l’appareil, se retrouve visible en fonction d’un point fixe. La composition dans l’image obéit à ses propres règles et repousse les limites de sa perception. Aucun point de fuite ne peut servir d’angle d’appui au regard, il faut discerner les différentes profondeurs de champs, les lignes d’horizon étant décalées. Le franchissement des 360 degrés a pour effet de créer un chevauchement entre le début et la fin. L’illusion d’un mouvement continu est renforcée par cette suite dans la séquence. Pendant le temps d’exposition, le point de départ s’est modifié: les objets ont bougé et se retrouvent à un autre endroit lorsque la prise de vue est finie.
Année de production : 2007-
 Arno Hassler
Arno Hassler


La série “OutWest” est née d’une rencontre entre Christian Lutz et la famille Davis. Missionné pour un repérage pour une maison de production de film suisse dans le désert de l’Alvord, dans l’Orégon aux Etats- Unis, Christian Lutz s’est pris d’intérêt pour la vie de la famille Davis, éleveuse de bétails. C’est une histoire à la rencontre de Paul, le patron du domaine, et de son intendant, le cow-boy Mike ; de leurs 3500 têtes de bétail disséminées sur 160’000 hectares de terrain ; de Tony, l’épouse du boss, et de leurs cinq enfants. L’artiste s’immerge, durant deux années, entre 2006 et 2008, à raison de quatre séjours dans le désert de l’Alvord, dans l’univers des cow-boys d’aujourd’hui. La série nous présente la famille Davis dans son activité de cow-boys de l’Ouest. Les bottes, chemises à carreaux et chapeau de cow-boys n’échappent pas aux clichés. Mais le regard de Christian Lutz va plus loin. Il nous présente cette famille qui vit isolée dans le désert, livrée à une terre hostile mais passionnée par son travail.Les clichés sont réalistes, parfois brutaux, montrant des scènes de son quotidien. Cette vie semble anachronique par rapport au reste des Etats-Unis. L’artiste met en exergue la coexistence de l’Amérique profonde et la société américaine. L’étendue, l’espace, la nature sont le cadre de vie de ces hommes qui pourraient sortir d’un western sans pour autant l’incarner. Leur rapport à cette dernière est indéniable et pourtant ils ne savent pas l’exploiter à son maximum faute d’éducation. Le monde animalier reste leur domaine de prédilection. De cette ambivalence entre une nature non maîtrisée et un savoir sur le monde animalier naît une énergie partagée, dans laquelle la vie des cow-boys perdure. À travers cette série de photographies, Christian Lutz explore l’Amérique profonde figée dans ses propres mythes. Elle se place entre le fantasme d’une Amérique de l’Ouest imaginée et sa propre réalité. Le sujet est étudié à huis clos autour de la famille Davis et de son activité. Il nous montre des moments simples, beaux, essentiels, ancestraux tout en évitant de tomber dans le cliché de cette Amérique où le temps semble s’être arrêté. (Fabienne Bideaud)
Année de production : 2006-2008
 Christian Lutz
Christian Lutz


Des montagnes. Remplissant presque toute l’image. D’un coloris discret. Entre 2000 et 4000 mètres d’altitude. Dans une atmosphère à la lumière tamisée. Imposantes. Esthétiques. Pittoresques. Roger Frei prend des photographies à des endroits de faible «pollution lumineuse». La lumière du soleil, reflétée par la lune, est la seule source lumineuse. Il recourt à la technique de la photographie argentique et expose la pellicule jusqu’à une durée de deux heures. Au moyen de cartes numériques en trois dimensions, il choisit au préalable des emplacements possibles pour poser son appareil. Il les cherche ensuite, de jour, dans le paysage et fixe ceux qui sont appropriés grâce à un logiciel GPS qui permet de les retrouver pendant la nuit. Le temps, et ses formes multiples, est inhérent aux images de Roger Frei. Formés il y a 135 millions d’années, les reliefs alpins sont aussi intemporels en qualité de sujet que la source de lumière utilisée: l’intensité de «la lumière de la lune» qui revient selon la loi naturelle. La longue période de la formation des Alpes, qui a créé une grande variété de formes et de strates, a défini leur caractère, ainsi que la simultanéité apparente de différentes saisons. Un jaune vert automnal côtoie un blanc hivernal. Les images montrent d’une manière directe l’extension du temps. Le long temps de pose qui ne permet qu’une à deux images par nuit s’interpose face à ces lents processus. Conçue comme une œuvre en cours, la série de Roger Frei est à la fois intemporelle et subordonnée au temps. Dépendantes de la lumière disponible (seules les nuits proches de la pleine lune sont suffisamment « claires ») et de conditions météorologiques optimales (ni nuage, ni vent), il n’y a que peu de nuits possibles par année pour ces prises de vue. Le résultat n’est visible qu’à retardement, après le développement du film. Roger Frei, dont cette série renvoie également à la peinture de paysage du XIXe siècle, crée des images d’une « lenteur bienfaisante », contrastant avec la vitesse de production des images actuelles.
Année de production : 2009-
 Roger Frei
Roger Frei


Le duo d’artistes chinois a travaillé pendant trois mois à Monthey, en Valais, dans le cadre de la résidence du programme SMArt. Durant leur séjour, ils ont testé les liens et les tensions qui existent entre l’individu et la nature. Leur travail artistique se décline à travers différentes interventions, réalisées directement dans la nature ou à l’aide d’éléments qu’ils ramènent à l’atelier
à la suite de leurs longues marches. Leur installation est composée d’une série de photographies de paysages, des images réalisées grâce à du papier sensible déposé dans la nature et exposé aux intempéries pendant plusieurs jours, ainsi que des pièces sonores et audiovisuelles. À travers leur recherche, le duo d’artistes explore la question de la représentation du paysage à travers différentes postures et techniques afin de créer un dialogue poétique avec les éléments naturels. Les travaux obtenus à travers leurs explorations évoquent l’impermanence des choses, la fragilité de la nature, mais aussi sa réactivité et sa force.
Grâce à une collaboration avec le programme SMArt, les artistes Wu Yumo & Zhang Zeyangping exposeront également à la Galerie du Théâtre du Crochetan, à Monthey (7.05-15.07.2022).
Affiche
Année de production : 2021-2022


Le travail de Ilir Kaso s’inscrit dans la désormais célèbre tendance de l’image animée. Aujourd’hui connues sous le nom de morphing ou de morphose, ces images sont le résultat d’une transition fluide et progressive d’une image initiale à une image finale. Depuis quelques années, ces images animées ont fait une arrivée massive au cinéma puis sur l’Internet avant d’être adoptées par les artistes. Pour cette morphose, l’artiste prend le parti de rester sobre et de ne pas intégrer de bande son ou de couleurs. Les changements perçus sur le portrait de la mère de l’artiste s’effectuent de manière lente et discrète. Mais bien que cette modification résulte du temps qui s’écoule, il reste difficile pour le spectateur d’en percevoir clairement le déroulement. La morphose ne peut être réellement saisie qu’après une deuxième visualisation. Alors que le temps reste l’acteur principal de ce travail, la figure de la mère joue également un rôle fondamental. Le temps est souvent un mal redouté lorsqu’il touche les personnes aimées, ici, c’est la mère qui est concernée. Mais si la morphose retrace de manière accélérée ce que le temps met un certain temps à marquer de manière visible, le visage de la mère reste souriant et serein. Qu’il s’agisse d’une manière d’accepter le temps qui passe ou d’une façon de le stigmatiser, l’artiste choisit de le capturer au travers de ces images le rendant ainsi immuable. (Victoria Mühlig)
Année de production : 2007
 Ilir Kaso
Ilir Kaso


Dans la brume matinale, une silhouette féminine se devine. À la manière d’une équilibriste, elle avance, pas à pas, sur les rebords d’un bassin de pierre. À quelques lieux de là, cette même silhouette apparaît, esquissant une ombre chinoise sur la paroi d’une architecture de béton brut ou contemplant son reflet dans les eaux calmes d’un lac… Réminiscences de jeux d’enfance, ces moments où, avec étonnement, l’on se découvre partie de ce monde. Discrète, la présence humaine infiltre le paysage, s’y glisse sans heurt. Une posture, un geste ténu… et une correspondance s’établit. Ombre portée, objet prélevé ou simple reflet : l’action de l’être sur son environnement est toujours minime. L’empreinte corporelle s’imprime alors parfois par procuration, par simple projection. Des points de contact s’esquissent, des liens se tissent et ces espaces minimalistes se font territoires d’introspection. Se mettant en scène, Loan Nguyen se fait l’actrice de scénarii où se jouent de probables réconciliations entre nature et culture. Au fil des tableaux pourtant, aucune narration ne se découvre, et d’elle, rien n’est dit. Nulle volonté de dresser un quelconque autoportrait, juste celle de se donner les moyens d’une interprétation sentie du paysage. Celui-ci pénètre alors la sphère de l’intime, se faisant paysage intérieur. Loin de tout anthropocentrisme, l’environnement et son habitant se voient accordés une même attention, nulle ascendance de l’un sur l’autre ne se dégage. L’être humain retrouve ici sa juste place, partie d’un tout, il constate sa propre existence en même temps que celle du monde. De subtiles propositions picturales, pour autant de visions poétiques.
Raphaëlle Stopin
 Loan Nguyen
Loan Nguyen


Les photos d’Andri Pol ont en commun qu’elles nous racontent toutes une histoire, l’humain y étant clairement au centre. Dans son ensemble, le travail du photographe ressemble à celui d’un anthropologue. Par petites touches, il nous fait découvrir “l’autre” qui est à la fois très proche et tellement lointain. Les images qu’il nous donne ne sont ni lisses ni quelconques. Qu’il nous emmène à la découverte de la face cachée d’une carte postale de la Suisse idyllique ou dans les coulisses de la vie des dieux vivants japonais que sont les sumos, Andri Pol sait nous surprendre. Grâce à des cadrages efficaces et une maîtrise parfaite de “l’instant décisif”, certaines de ses photographies sont si étonnantes qu’elles font croire à une mise en scène. L’artiste aime se jouer des clichés et des traditions en mettant en évidence un détail singulier, en attirant le regard sur l’envers du décor.En nous dévoilant le petit grain de sable qui vient gripper la machine du monde qui semblait pourtant en apparence bien huilée, il nous apporte un autre regard. Entre ombre et lumière, sa vision du réel est teintée d’humour et de dérision donnant ainsi à ses images un caractère ludique, mais ceci sans tomber dans l’insouciance et la légèreté. Entraîné dans un tourbillon narratif, le spectateur se surprend tout à coup à chercher dans ces séries de photos la petite fêlure, le côté décalé, le second degré. (Carine Steiner)
Année de production : 2006
 Adri Pol
Adri Pol


Des visages souriants dans des décors de couleurs vives et acidulées, ce sont les images que nous avons de l’enfance. Avec la série “Made of Stone”, Sophie Brasey prend à contre-pied ce stéréotype et pose un regard nouveau sur les enfants. Plus de sourires, ni d’yeux pétillants, mais des regards tantôt vides, pensifs, accusateurs, inquiets ou sérieux. Made of Stone alterne les portraits, les mises en scène et l’architecture. Les tonalités grises renforcent l’ambiance pesante créée par les regards et génératrice de malaise chez le spectateur. Seule touche de couleur vive, le ciel d’un bleu pur rappelle cette enfance idéalisée, à la fois omniprésente mais inatteignable. Loin de la tendre insouciance enfantine, ces enfants photographiés dans un espace qui est leur, l’école, et dans lequel ils devraient se sentir protégés, semblent porter sur leurs épaules les tourments de la vie d’adulte. Ironie de notre époque où les adultes fuient leurs responsabilités et courent après une insouciance enfantine idéalisée, tandis qu’ils demandent aux enfants de grandir et de mûrir de plus en plus vite. Ce phénomène de société intéresse Sophie Brasey qui choisit de se placer du point de vue de l’enfant, trop souvent laissé de côté ou modelé par l’œil adulte. En balayant les clichés de l’enfant « infantilisé » et insouciant, la photographe nous montre que, même à l’âge de cinq ans, il est possible d’être lucide sur les problèmes qui nous entourent et de se poser des questions sur la vie, l’avenir. (Noémie Richard)
Année de production : 2007
 Sophie Brasey
Sophie Brasey


Lisa Roehrich s’intéresse aux groupes sociaux minoritaires ou stigmatisés et à la manière dont les individus qui les composent s’auto-représentent. Ses premiers travaux prennent pour objet les skinheads, les manouches ou encore les mannequins qu’elle met à l’épreuve des stéréotypes qui les définissent généralement. Désireuse de renforcer son propos et de s’éloigner de l’approche documentaire subjective de ses débuts, l’artiste choisit dès 2008 d’utiliser la vidéo pour filmer ses sujets à la manière des «Screen Tests» d’Andy Warhol. Contrairement à son illustre prédécesseur qui manifestait à travers ces portraits filmés sa fascination pour la célébrité, elle utilise ce procédé avec des inconnus. Interloquée par l’image des jeunes gens et leur représentation dans notre société, elle dirige sa recherche sur les adolescents, en l’occurrence ceux qui ont pour habitude de se réunir devant une enseigne commerciale de sa ville. Les protagonistes reçoivent pour consigne de se mettre en scène selon l’image qu’ils souhaitent librement projeter. Sur le plan formel, la vidéo et le parti-pris du tournage nocturne contribuent à une théâtralisation du sujet, renforçant sa présence dans l’image, tandis que le recours au ralenti accentue l’ambiguïté avec l’image fixe. Par la suite, Lisa Roehrich poursuit sa démarche au Liban où elle analyse la posture des jeunes de ce pays placés dans un environnement politicoreligieux particulier peu propice à l’expression de l’identité. Pour sa contribution aux Journées photographiques de Bienne 2011, elle choisit cet été de visiter à nouveau les adolescents de sa ville en explorant de nouvelles pistes. Outre sa portée sociologique, ce travail intitulé «Look at me» aborde de manière pertinente la question de la durée dans le processus de perception et de son effet pour l’expression d’un contenu artistique. (Daniel Mueller)
Année de production : 2011
 Lisa Roehrich
Lisa Roehrich


Avec sa série nommée “Lieux d’énergie”, Luca Zanier s’est rendu dans des endroits peu accessibles au public : le monde caché des centrales nucléaires et hydrauliques, ainsi que des zones de stockage d’énergie. Ces bâtiments sont habituellement placés à l’extérieur des zones habitables, souvent souterrains et peu visibles. Pourtant notre société dépend fortement de cette énergie créée chaque jour pour nos besoins. Créations de l’homme, ces lieux ont pourtant un caractère inhumain et froid. Après une catastrophe comme Tchernobyl, nous ne pouvons plus voir ces centrales comme un accomplissement du progrès scientifique. Au contraire, nous les craignons et à la fois nous en somme dépendants. Ce double caractère intéresse Luca Zanier qui ne cherche pas à faire une documentation précise de ces endroits, mais plutôt à rendre compte de cette dualité par un travail photographique. L’artiste présente une série de clichés proches de la science-fiction. Les couleurs et les lumières de ces lieux donnent une impression d’artificialité. La grandeur des installations retranscrit une certaine mégalomanie de l’homme qui fascine et en même temps effraie. Sommes-nous dans la fiction ou le réel ? Telle pourrait être la question du spectateur devant “Lieux d’énergie”. (Antoine Tille)
Année de production : 2008-2010
 Luca Zanier
Luca Zanier


Elisa Larvego Lors d’un séjour à Mexico, Elisa Larvego a examiné de près les particularités culturelles de la société mexicaine d’aujourd’hui et a traduit ses observations dans le langage photographique. Les photographies de la série Les protagonistes montrent des fêtes d’enfants : anniversaire, baptême ou communion. Ces événements expriment clairement le mélange des traditions occidentales et indigènes qui caractérisent aujourd’hui la société mexicaine. Des super-héros, des princesses et des figures de l’iconographie catholique ainsi que de la mythologie mexicaine indigène se rencontrent par l’intermédiaire du jeu des enfants. En tant que personnages-clefs, ceux-ci incarnent un équilibre entre cultures et identités. De nombreux éléments rappellent ce mélange : costume d’Indien, sombreros, piñatas (figures en papier mâché remplies des sucreries), Spiderman, courge d’Halloween ou Sainte Vierge. Comme dans le jeu du dessin caché, ces détails attirent l’attention du spectateur et le font participer aux scènes. La perspective centrale renforce cet effet d’aspiration et souligne l’unité des ensembles. Les ouvertures vers l’extérieur font exception. Elisa Larvego utilise des éléments du théâtre tels que la scène, des acteurs qui suivent des indications de mise en scène, des accessoires. Lors de la fiesta, les logements et les jardins des enfants se transforment en des mondes particuliers qui ont leur logique propre. Le niveau de la mise en scène ne réside pas seulement dans la transposition artistique, mais déjà dans la nature des fêtes et des costumes eux-mêmes. La photographe crée ainsi des images à caractère documentaire qui se situent à l’interface entre imagination et réalité.
Mariana Forberg
 Elisa Larvego
Elisa Larvego


Les collages, constitués d’images qui se chevauchent, développent tout leur effet lorsqu’ils sont observés avec suffisamment de recul. Les différents objets du quotidien, dont des chaises, armoires ou vêtements, forment alors une composition esthétique étonnante, uniforme, rythmique et colorée. Tel un poisson dans un aquarium, les Dérangeuses, sans visage, anonymes et pataudes, semblent chercher leur équilibre en glougloutant dans ce désordre organisé. En s’approchant à nouveau de l’image, on réalise qu’il ne s’agit pas simplement d’une chambre mise sens dessus dessous : les différentes dimensions et les angles de perspective des épreuves superposées sont décalés et manipulés de façon à donner le vertige. Même la force de la raison ne parvient pas à amener le moindre ordre dans ce désordre.Après avoir tenté de capturer l’éloignement dans ses prises de vue de paysages désertiques, et consacré dix années au trop-plein des grandes villes comme Paris et New-York, Catherine Gfeller, nomade en quête constante de sens, continue son parcours en collectionnant des éléments qu’elle combine sous forme de symboles et de collages colorés. De manière intuitive ou aléatoire, l’artiste agence des objets trouvés, jusqu’à les rendre presque méconnaissables. C’est la vision d’ensemble qui révèle la mise en scène. Lorsque la photographe trouve le temps de se retirer chez elle, après désert et mégalopoles, son appartement lui sert de scène introspective où se jouent agitation et quête intérieures. Les images qui en résultent nous donnent le sentiment d’être assourdis par le tintamarre des grandes villes mais aussi, paradoxalement, par le silence des profondeurs sous-marines ou du désert. Le MAKE BELIEVE (faire croire) de Catherine Gfeller trouve en quelque sorte son aboutissement dans l’idée que le sens et l’ordre ne peuvent être conçus que dans le désordre total.
Pascal Kaegi
 Catherine Gfeller
Catherine Gfeller


Alf Kebbell est malvoyant. Depuis 24 ans, il suit régulièrement le même parcours dans les rues de Elephant & Castle, un quartier du sud de Londres. Normalement il se sert de sa canne pour se guider, mais il s’est tellement familiarisé avec cet espace, qu’il n’en a même plus besoin ; il s’oriente grâce aux points de repère (landmarks) qu’il a appris à déchiffrer au long des années. Dana Popa accompagne Alf Kebbell dans un de ses itinéraires journaliers et nous montre, dans la série “Landmarks”, une interprétation visuelle de ces points dans l’espace qui permettent à Alf, au travers du toucher ou de l’ouïe, de trouver son chemin dans la grande ville. Une lumière plus intense, un trou sur le trottoir ou une clôture sont des signes qui passent inaperçus à nos yeux, échappant souvent à nos sens, mais qui servent néanmoins de référence au promeneur attentif. Sans eux Alf serait perdu. Dana Popa nous présente ces endroits de passage au moment où Alf les parcourt. Sans jamais nous montrer le protagoniste de ce cheminement, elle capte ses points de repère, en les isolant de leur réalité quotidienne – la foule et le trafic – pour nous dévoiler leur magie et faire ressortir leur valeur. Face à un monde régi par la vue, elle nous invite à découvrir ce quartier londonien autrement, en suivant une sorte de parcours émotionnel où des détails, qui nous échappent normalement, deviennent des protagonistes. (Laura Sánchez Serrano)
Année de production : 2006
 Dana Popa
Dana Popa


Abstraites ou documentaires, foisonnantes ou épurées, les images produites lors de travaux scientifiques jettent un regard neuf sur le monde et la société, questionnent notre imagination, inspirent à la contemplation. Les quatre cents œuvres soumises au Concours FNS d’images scientifiques 2025 témoignent des approches variées et changeantes de la recherche ainsi que des perspectives multiples des gens qui la pratiquent. Elles nous font découvrir des visions inédites, spectaculaires ou troublantes, éclairent le familier sous un jour inattendu, et nous invitent à questionner, avec curiosité et modestie, ce qui s’offre à notre regard.
En collaboration avec le Fonds national suisse (FNS).
Les catégories du concours
1. L’objet d’étude
2. Les femmes et les hommes de la science
3. Les lieux et les outils de la recherche
4. Vidéos
Le jury 2025
Présidente
Tanja Gesell, biologiste et artiste, Université de Vienne (Autriche)
Membres
Emanuela Ascoli, directrice photos et expositions du National Geographic France (France)
Lizzy Brown, responsable photos, Nature (Royaume-Uni)
Patrick Gyger, directeur de Plateforme 10 (Suisse)
Andri Pol, photographe (Suisse)
Tess de Ruiter, curatrice art-science, Rotterdam (Pays-Bas)
© Matti Barthel, Guido Schreurs, Alain Amstutz, Concours FNS d’images scientifiques | SNF-Wettbewerb für wissenschaftliche Bilder
Des étudiant·e·s de l’Institut littéraire (HKB) ont produit des textes inspirés par les images exposées du Concours FNS d’images scientifiques, ils sont disponibles ici. Une collaboration avec Michel Layaz, écrivain et enseignant à la HKB.


Loin d’une pratique distanciée et froide, la science est affaire de femmes et d’hommes, de passions et de dévouement, de tâtonnements et d’heureux hasards. La pratique contemporaine de la recherche se dévoile au long des 680 œuvres soumises par les scientifiques de Suisse aux éditions 2020 et 2021 du Concours FNS d’images scientifiques.
Les Journées photographiques de Bienne en exposent une sélection, les œuvres primées par le jury et choisies lors d’un vote public, ainsi qu’une mise en musique électronique de vidéos scientifiques proposée par le producteur METEO.
Remise de prix et visite commentée de l’exposition en présence des auteurs des œuvres le jeudi 20 mai à 16h.
En collaboration avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).


Réservoir de matières et d’expressions créatives, les plateformes digitales peuvent aussi être associées à une menace faite à notre attention et à nos libertés individuelles. Peut-on encore parler d’expression personnelle quand tout est fait pour que nous soyons captifs, pour que nos émotions se conforment à des (émot)icônes ? L’artiste Aurore Valade a invité une classe du Gymnase français de Bienne à déconstruire l’imagerie générée sur les réseaux sociaux à travers des techniques analogiques et numériques. Les élèves ont travaillé à partir de captures d’écrans tirées de leurs propres préoccupations et interactions sur les réseaux sociaux. Ensemble, ils ont découpé, dessiné et retravaillé le langage 2.0 à travers des techniques analogiques et numériques. Ils ont créé des symboles avec lesquels ils se sont mis en scène puis photographiés. Les images qui résultent de cette collaboration redonnent une plasticité aux émotions et aux revendications des élèves à travers un geste pictural et théâtral, la photographie permettant de conserver une mémoire graphique d’interfaces numériques fragiles, souvent vouées à la disparition. L’installation proposée invite le public à se mettre lui-même en scène dans l’espace d’exposition.
Grâce à un partenariat avec la HEP-BEJUNE, les portraits collectifs réalisés on déjà été publiés dans la revue Enjeux pédagogiques N° 34 de la HEP-BEJUNE.
Année de production : 2020


«Quel est le premier politicien dont tu te souviens?». Cette question, soulevée par le photographe lui-même, résonne et se répète face à la série «Kings of Cyan». Evoquant les figures emblématiques des présidents Gerald Ford et Jimmy Carter qui fixèrent leur image dans la mémoire du peuple américain, cette série est une véritable réflexion sur les messages visuels politiques à travers le temps. Aujourd’hui, la rue est de plus en plus étouffée par la publicité et les affiches portraiturant les politiciens abondent en période de campagne électorale. Imprimés dans la mémoire du passant, que reste-t-il de ces portraits par la suite? Le temps passe, marque les affiches et laisse une trace vieillie sur les visages mêmes. Le magenta et le jaune disparaissent sous les effets météorologiques pour ne laisser que le cyan. Etonné par le faded blue – bleu terni – qui subsiste, Tim Davis y décèle un bleu propre à la perspective atmosphérique des peintures hollandaises. Du politicien communiste au néo-fasciste, leurs idées s’évanouissent plus vite que l’encre qui laisse parfaitement visible, sous la patine bleutée, leur expression ambitieuse. Sur les surfaces dégradées, déchirées et fades, leur essence intérieure se révèle tel un fantôme. (Myriam Valet)
Année de production : 2008
 Tim Davis
Tim Davis


Une fille célèbre, un héros grec et une ville élégante partagent le même nom et sont pareillement aimés. Rien de plus n’est dévoilé dans le titre de cette série. Les photos montrent des protagonistes femmes qui semblent sortir tout droit d’une image publicitaire, avec leurs longues jambes et leurs épaules dénudées, leurs vêtements glamours et leurs accessoires. Deux des quatre jeunes femmes portent des robes de soirée ; les deux autres sont en sous-vêtements. Le regard du spectateur est habilement dirigé entre les jambes des protagonistes. Corinne L. Rusch explore avec assurance le monde scintillant des célébrités. C’est un univers qu’elle connaît bien et dont elle parvient à imiter les atmosphères à s’y méprendre. L’intérêt de son travail réside cependant dans sa faculté à rendre compte précisément des dimensions obscures de cet univers d’apparence merveilleuse. Les attitudes des modèles photographiés sont ainsi bien loin de celles des mannequins défilant sur une estrade et des sourires forcés des magazines. Ces jeunes femmes paraissent s’être effondrées d’avoir trop fêté, semblent avoir succombé aux délires de l’anorexie ou aux rêves de la réussite. Leurs attentes et celles de leurs proches pesant sur leurs épaules, leur ambition et les artifices derrières lesquels elles cachent leur Moi déficient – au point de ne plus même le reconnaître – les ont vidées. La seule concession de Rusch est l’esthétique avec laquelle elle présente ces situations de détresse : une fois c’est la position du corps qui imite parfaitement le décor abstrait qui se trouve en arrière-fond, ailleurs, la symétrie du corps paraît si fragile qu’on en retient presque son souffle. Ailleurs encore, sur le seul cliché pris à l’extérieur, les sapins éclairés par le soleil matinal et les hauts talons que l’on prendrait pour des pommes de pin créent une atmosphère de conte de fées. En réalité, comme le suggère son titre, le travail de Corinne L. Rusch interroge l’injonction sociale de beauté et de succès sans pourtant la rejeter complètement.
Nora Fiechter
 Corinne L. Rusch
Corinne L. Rusch


On dit que les yeux sont le miroir de l’âme et qu’à travers un seul regard se révèle la nature profonde d’un être. Deux regards qui se croisent, un premier contact direct avec l’autre, un moment privilégié et intime. Voilà le point de départ de la série “Iris 732 “. Si l’oeil humain est donc ici appréhendé dans sa dimension profonde et révélatrice, Florian Zellweger s’intéresse aussi à ses qualités esthétiques : chaque iris présente une variété de couleurs extraordinaires qui est unique et naturelle.
Le photographe questionne aussi la perception humaine : l’oeil, partie du corps servant habituellement à voir le monde, se transforme ici en objet à contempler. Transposé en image photographique, il perd certaines de ses caractéristiques propres et épouse une sorte d’irréalité. Une sorte d’abstraction. Mais l’oeil est aussi abordé de manière quasiment clinique : le cadrage centré sur l’iris, le point de vue rapproché et le grand format nous montrent de manière spectaculaire les détails de cet organe. De plus, l’utilisation de la technique numérique contribue à rendre l’image froide, distante, donnant ainsi l’illusion de l’objectivité. En outre, le titre de la série, “Iris 732 “, rappelant celui d’un astéroïde, associe l’iris aux corps célestes. Un autre élément dont le photographe se sert pour jouer avec la perception afin de détourner le spectateur du sujet réel. Ces yeux deviennent donc des formes et des couleurs à l’origine secrète et mystérieuse. Des images à contempler où l’imagination se laisse vite emporter. (Valeria Donnarumma)
Année de production : 2007
 Florian Zellweger
Florian Zellweger


Récompensé par le Swiss Cups Arts Award (automne 2007) pour son ‘arbeitsdokumentation: die buchstaben, die worte, die blätter, die fragen (var. 4)’, Herbert Weber poursuit, toujours sur un ton ironique, ses recherches sur le rapport entre le documentaire et la mise en scène, à travers une oeuvre inédite, rythmée par des contrastes clairs/ obscurs et caractérisée par une grande netteté. À partir d’une photographie noir/ blanc d’un paysage de campagne, l’artiste crée une série d’images sous forme de fausse documentation, censée illustrer la mise en scène de l’oeuvre de départ. De cette série intitulée arbeitsdokumentation: interpretation von fakten (var. 2 und 3) découlent deux oeuvres finales, (var. 2 und 3). Jouant ainsi sur une double lecture – à partir de la photo de départ ou à partir des images finales – la mise en scène illustrée devient à la fois vrai et faux document. Les images se suivent, deviennent des séquences, racontent une histoire : celle du photographe simultanément auteur et modèle, construisant puis déconstruisant son décor. À travers cette mise en abyme, cette relation entre l’aspect documentaire et la mise en scène, Weber invite le spectateur à s’interroger sur l’art photographique et son rapport au réel. Quand parle-t-on de photographie documentaire ? Quelles sont les limites de la mise en scène dans une photographie documentaire ? Ces deux aspects doivent-ils, à tout prix, être dissociés l’un de l’autre, ou une mise en scène peut-elle également avoir une valeur documentaire ?, s’interroge le photographe. Il esquisse toutefois des éléments de réponse en montrant que ces deux dimensions sont solidement liées. Selon lui, un photographe ne peut se passer de mise en scène car, en tant qu’individu, il est incapable de rendre compte d’une réalité de manière objective, tandis que l’appareil photographique, objet mécanique dépourvu de sentiments, ne recourt à aucune mise en scène, restant ainsi toujours objectif.
Jasmina Slacanin
 Herbert Weber
Herbert Weber


Entre l’école et la famille se trouve toujours l’élève. Cette relation, imposée par le système, peut se révéler riche et simple, mais aussi tendue et complexe. Elle nécessite beaucoup d’énergie et d’attention, afin de favoriser un dialogue permettant d’atténuer les incompréhensions. La réalité des vies est toujours plus complexe que ce que l’image publique donne à voir. Il faut aller chercher la vérité dans les plis de la vie, de sorte que les fausses perceptions ne se transforment pas en une gangrène fatale à la relation. La compréhension de l’autre, dans sa complexité, permet d’éviter de le réduire à ce que l’on voudrait qu’il soit et est essentielle à l’épanouissement de chacun.
Dix photographies de la série In-between ont été publiées dans la revue Enjeux Pédagogiques. Télécharger la revue ici.
Année de production : 2018


Brûler de “l’argent des morts” en papier de bambou constitue une partie du culte des ancêtres et des fêtes des morts en Chine. Dans certaines régions, on fabrique également pour le défunt divers objets en papier – des voitures, des habits, des montres – qui lui garantissent une meilleure vie après la mort. Depuis quelque temps, l’influence de la société de consommation a conduit à produire des offrandes de papier de plus en plus extravagantes : des fours à micro-ondes, des avions ou des villas de luxe ! Officiellement interdites, ces pratiques ont pourtant longtemps été tolérées par les autorités. Mais lorsque du Viagra, des prostituées ou encore des accessoires de jeux de hasard en papier ont commencé à se multiplier, les contrôles se sont quelque peu renforcés. Ces objets lacunaires, imaginés, figurent une représentation tendre mais infidèle de la réalité : la vacuité de leur contenu importe peu en réalité, il s’agit de saisir leur essence.La photographie permet de reproduire ces objets une seconde fois et se concentre cette fois sur les plus petits détails de leur surface : traces du plioir, gouttes de colle figées, feuilles d’argent froissées. Mais les deux modes de copie demeurent à leur manière incomplètes ; chacun ne se compose que de relation et d’un souffle de matière. En Occident, on tend à chercher l’essence dans les choses et à crier au faussaire dès lors qu’elle en est absente. Pour Confucius, seuls les accords intersubjectifs permettent de déterminer la valeur d’un objet et indiquent s’il mérite l’attention. Du point de vue de l’univers, il n’existe pas de vrai ou de faux. Le vivre-ensemble humain tient sa forme du respect du “li” (les rites et les conventions), dans lequel les rites occupent une place cardinale, puisqu’ils constituent l’origine du sens et de la valeur. (Simon Stähli)
Année de production : 2010
 Kurt Tong
Kurt Tong


Aujourd’hui, la photographie peut prendre une très grande diversité de formes matérielles et immatérielles: du papier au pixel, de la page à l’écran, d’immobile à mobile. Quels sont les défis et les opportunités auxquels doivent faire face les créateurs d’images et les éditeurs souhaitant explorer de manière critique la nature hybride de la photographie? Quelles sont les pratiques contemporaines du travail et de la diffusion de l’image? Que signifie publier à l’ère du trop-plein d’information, et comment pouvons-nous penser des stratégies d’édition alternatives pour les nouvelles images? Quelles sont les nouvelles plateformes pour les “post-photographes”?
À travers une série d’ateliers offerts à de petits groupes de professionnels (photographes, éditeurs, curateurs…) quatre artistes ont été invités à discuter de ces thèmes et à créer des œuvres avec les participants. Les résultats des ateliers seront ensuite exposés dans le cadre du festival.
Curation: Marco de Mutiis et Hélène Joye-Cagnard
Image+ est organisé en collaboration avec le programme SITUATIONS du Fotomuseum Winterthur.
Artistes participants:
Sebastian Schmieg (1983, Allemagne) explore les manières dont les technologies modernes façonnent les réalités en ligne et hors ligne, y compris les logiques et les politiques occultées de l’image algorithmique et de la vision informatisée.
sebastianschmieg.com
Le travail de Kamilia Kard (1981, Hongrie/Italie) se concentre sur la construction de l’identité à l’ère de l’Internet, et se manifeste à travers différents médias allant de la peinture à la vidéo en passant par les gifs animés, les images imprimées et l’installation.
kamiliakard.org
Ola Lanko (1985, Ukraine) explore parallèlement les savoirs et les récits construits par les images, le big data et l’accès gratuit à l’information. Elle opère par métaphores et références qu’elle réaménage dans des narrations non linéaires.
olalanko.com
Emmanuel Crivelli (1985, Suisse) est un concepteur éditorial jouant avec la photographie, les illustrations et le texte. Ses publications visent un large spectre, de l’affiche d’opéra au magazine trimestriel sur le genre et la sexualité.
dualroom.ch
Workshop: 6 mai 2017, 10 h – 18 h
Les ateliers sont gratuits et auront lieu en anglais.
Inscription: demutiis@fotomuseum.ch
Exposition Image+ : 12 – 28 mai 2017
Vernissage de l’exposition : 11 mai, 18 h
Lieu : Chipot
Liste de participants
Emmanuel Crivelli
Natalia Mansano
Miriam Elias
Kamilia Kard
Dana Popescu
Jonas Kambli
Marie-Pierre Cravedi
Ola Lanko
Damien Sivier
Massimo Piovesan
Karina Munch Reyes
Marion Nitsch
Rosario Mazuela
Thomas Nie
Sebastian Schmieg
Simon Tanner
Patrick Pfeiffer
Rebecca Bowring


Réalisées dans le monde entier, ces images sont le résultat de performances conduisant à l’effacement de l’individu dans son environnement.
Le Festival Images de Vevey propose un parcours d’une dizaine d’oeuvres de cette même série présentée de manière monumentale sur les façades de la ville. www.images.ch
Année production : dès 2005


Les photographies du collectif péruvien LimaFotoLibre nous séduisent par leur fraîcheur et leur spontanéité. Fondé il y a cinq ans, le projet est né de l’initiative de quatre amis qui ont voulu documenter, à travers leur site Internet, les transformations d’une ville en mouvement : Lima. Comme s’il s’agissait d’un laboratoire visuel, ces photographes parcourent les rues de la métropole avec leur appareil numérique et capturent leurs visions de cette ville polymorphe. Prenant des photographies lors de leurs trajets quotidiens, ils nous dévoilent ce qui normalement échappe à nos sens : les changements imperceptibles, les petits détails anecdotiques cachés par la routine, l’agitation et le chaos qui règnent dans la grande ville. Faisant lui-même partie de cette culture populaire, le collectif LimaFoto-Libre utilise la ville non seulement comme source d’inspiration, mais aussi comme lieu d’exposition. Ainsi, il s’est fait connaître en collant des milliers d’autocollants et de photocopies de leurs photographies dans les transports publics, les galeries commerciales, les parcs et les rues de la capitale péruvienne. En s’immergeant dans la ville, ils revendiquent leur vocation de collectif populaire et se rapprochent d’un public qui devient actif et qui participe au débat provoqué par ces images. « Haciendo Hora » (en faisant passer le temps) fait référence à plusieurs notions de temps : le temps anecdotique qui témoigne des changements qui touchent une personne ou un endroit au niveau local, le temps d’attente des photographes lorsqu’ils réalisent une série, le temps construit de leur démarche visuelle et enfin le temps de perception du spectateur. (Laura Sánchez Serrano)
Année de production : 2011
 LimaFotoLibre
LimaFotoLibre


Les spécialités du duo sont tant les objets photographiques que les sculptures et les installations. Ils ont par exemple, pour Growhomes (2007), réalisé des bacs à fleurs dont les parois représentent des façades de maison. Ils les ont placés dans une cave sans fenêtre où, grâce à une lumière artificielle et un arrosage constants, la mauvaise herbe plantée dans ces bacs a proliféré très rapidement. Ce travail installatif caricature une communauté d’habitants fragile et éphémère, dans une rue bordée de maisons à la Potemkin où seule subsiste une vie intérieure sans âme. On retrouve ce jeu de contradiction, voire le caractère symbolique, dans la série Factoiden (2005/ 2006). Ici, des maquettes de routes en carton sont placées de façon à créer l’illusion d’une réelle route interminable, menant tantôt jusqu’à l’horizon, tantôt dessinant un cercle dans un paysage inhospitalier. La tromperie est immanente à la construction de l’image photographique et contraint ainsi forcément le regard. Que des frites dorées, selon l’emplacement ou l’angle de la prise de vue, fassent office de clôture au Grand Canyon ou de guirlande d’autoroute pour un voyage initiatique, n’est pas seulement un gag photographique, mais renvoie à la métaphore du voyage fastfood sans consistance et un peu indigeste. Ces Fata Morgana, ces mirages, ces cercles vicieux, ces pièges visuels, ces constructions emblématiques, entièrement fabriqués en numérique, amènent la preuve que nos représentations de la réalité, comme déjà au temps de la photographie d’esprits, dépendent d’effets qui stimulent notre imagination et font naître des croyances. La pespective est ici un moyen esthétique de renforcer ces croyances de manière stupéfiante : image est un anagramme de magie.
Fritz Franz Vogel
 Taiyo Onorato & Nico Krebs
Taiyo Onorato & Nico Krebs


Dans sa série “Greenland, Climate tourism and displaced communities” (Groenland, tourisme climatique et communautés déplacées), Alban Kakulya nous montre à travers son objectif la situation actuelle du “pays vert”, énorme île glacée qui, depuis sa récente – mais néanmoins par- tielle – autonomie du Danemark, cherche à forger son identité et son avenir. Face aux paysages de glace d’une beauté tellement parfaite qu’ils nous rappellent des maquettes idéalisées, le photographe nous dévoile la réalité sociale du pays. Des bâtiments préfabriqués de différentes couleurs, où les autochtones se sont vus parqués à partir des années 1960, faute de moyens de la part de l’Etat pour soutenir ces communautés sur place, contrastent avec la pureté et l’aspect massif du contexte naturel. Sont également visibles les changements occasionnés dans le paysage par la croissance du tourisme et de l’exploitation des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole qui pourraient devenir de nouvelles voies de développement économique.Mais ce besoin de développement économique ne risque-t-il pas de nuire au contexte naturel de l’île? Ne sommes-nous pas en train de sacrifier l’une des dernières zones vierges de la planète? La perte d’identité, l’isolement, le besoin d’adaptation économique aux nouvelles générations, ainsi que l’envie de défendre le droit au développement sont parmi les idées qui se dégagent de ces images, où le silence et la presque absence de présence humaine sont témoins de ces changements. (Laura Sánchez Serrano)
Année de production : 2009
 Alban Kakulya
Alban Kakulya


L’artiste Anthony Ayodele Obayomi est le premier lauréat du Prix Taurus pour les Arts Visuels. Son projet primé en cours est exposé dans le cadre du festival et son travail finalisé sera ensuite exposé au Photoforum Pasquart en automne 2021. Obayomi s’intéresse aux manières avec lesquelles les institutions religieuses et celles qui organisent des jeux d’argent opèrent dans les esprits des gens, en particulier chez les populations démunies. A travers son installation, il questionne la commercialisation de l’espoir face à des luttes quotidiennes auprès des populations de Lagos, au Nigéria, dans un contexte de manque de ressources et de faible pouvoir d’achat.
Année de production : 2019-


Gina est un essai photographique qui traite du rapport entre son auteur, Stefania Malorgio, et sa mère. Je l’ai réalisé suite à un questionnement sur l’ambiguïté qui nous lie, indique-t-elle. Durant trois ans, elle a pris régulièrement sa mère en photographie dans son environnement et ses activités quotidiennes, parallèlement à un travail d’écriture. Il en résulte un répertoire de situations significatives qui paraissent tirées d’un storyboard. On y voit Gina manoeuvrant la tondeuse à gazon, saisie dans ses pensées au volant de sa voiture, arrosant au soleil couchant les plantes dans son jardin d’une banlieue résidentielle, coiffant sa fille dans la salle de bain, observant les membres de sa famille avec bienveillance, etc. Ces scènes construisent une forme de journal intime paradoxal, dans la mesure où le sujet est soumis à une observation distanciée, parfois presque artificielle. L’artiste y joue avec la limite floue qui sépare l’approche documentaire de la fiction, comme pour mieux traduire la nature contrastée de ses sentiments envers sa mère. Dans certaines images, la mise en scène est explicite alors que d’autres présentent les caractéristiques de l’instantané, bien qu’elles soient parfaitement maîtrisées. Parfois, l’auteur s’introduit dans le cliché et prend ainsi le statut d’acteur, dans une situation qu’elle peut manipuler de l’intérieur.
Pour tenter d’explorer le lien à sa mère, Stefania Malorgio a choisi une forme élaborée qui fait référence à la culture des séries télé (Desperate housewives n’en est qu’un exemple). Elle dit retrouver en sa mère l’histoire dramatique d’une femme actuelle. Les clichés que je fais d’elle me rappellent les héroïnes de film et de série télé auxquelles je m’identifie, des personnages incarnant des stéréotypes gênant par leur banalité, précise-t-elle encore. Loin d’être superficielle, la posture artistique de Stefania Malorgio révèle une personnalité engagée et sincère. Elle parvient, en effet, à rendre universelle une histoire complexe et individuelle, sous une forme visuellement et intellectuellement convaincante. (Daniel Müller)
Daniel Müller
 Stefania Malorgio
Stefania Malorgio


Dans les mois qui ont précédé le sommet du G8 à Evian, en 2003, les médias de Suisse romande ont manifesté une grande crainte à l’égard des violences dont risquaient de faire preuve les adversaires de la mondialisation. La presse se préoccupait principalement du coût de la sécurité publique et des questions de responsabilité dans les actes de vandalisme attendus. Le sentiment d’insécurité prit alors une telle ampleur que de nombreux magasins dans les centre-villes de Genève et de Lausanne décidèrent de barricader leurs vitrines et leurs accès pour la durée de la rencontre du G8. Nicolas Savary photographia cette situation inhabituelle et insolite. Des vitrines aveugles – ce qui était normalement fait pour séduire devenait à présent invisible et se refusait à tout regard. Au lieu d’une atmosphère éclairée et rayonnante : des panneaux de coffrage bruts. Au cadre du spectacle de la consommation se substituait ainsi celui des barricades. Les détails des façades sautèrent alors aux yeux : les corniches des vitrines, amoureusement sculptées autrefois, furent remises en valeur. Le noir des semelles sur le bitume montrèrent l’usure des millions de chaussures qui avaient passé par là. Des graffitis. Des architectures fonctionnelles bon marché mal dissimulées sous un mince revêtement de marbre. La confrontation d’une photo de Nicolas Savary avec le visage réel des lieux est ainsi immédiatement parlante ; il s’agit là de lieux dans lesquels nous nous déplaçons chaque jour, mais sans savoir vraiment qu’ils existent. Les centaines de mètres carrés de bois aggloméré, de contreplaqué, de panneaux de coffrage jaune miel qui nous évoquent des réalisations d’art contemporain (Christo, Wolfgang Laib) ont ici une origine tout à fait pratique. Enfin, les images de Nicolas Savary documentent les manifestations tangibles de la cupidité et de la peur. Des paysages mélancoliques s’offrent à nous. Et pourtant la réalité, libérée de l’illusion, nous réconcilie avec elle-même. (Simon Stähli)
Année de production : 2003
 Nicolas Savary
Nicolas Savary


Observant le temps sous une perspective inhabituelle, l’installation d’Ola Lanko invite à explorer la nature manufacturée du temps. Elle scrute le procédé technique peu familier caché derrière le chronométrage pour donner un rôle différent à la machinerie utilisée dans la fabrication des montres. Lanko considère le métier de l’horlogerie comme l’incarnation de l’alliance du matériel et de l’immatériel. Au travers d’images d’archive du patrimoine industriel – une capsule temporelle d’histoire en soi -, Lanko examine le temps en tant que phénomène physique, mental, socio-économique et historique, et réunit différentes perspectives dans un collage spatial en trois dimensions.
Cette exposition est organisée dans le cadre de Archive Salvation Force, un projet initié par l’artiste dans un but de revitalisation d’archives existantes et d’exploration de leur utilisation potentielle dans un contexte contemporain.
En collaboration avec le CEJARE (Centre jurassien d’archives et de recherches économiques), basé à St-Imier.
Fonds Aubry Frères SA, Fonds Schäublin SA
Année de production : 2017


Comme des moments suspendus, les images de Fabian Hugo ont toutes une ambiance particulière, un léger déséquilibre, quelque chose d’intriguant. Dans les situations quotidiennes ou banales qu’il photographie, l’imprévu semble être un paramètre auquel l’artiste aime se frotter. Pour la série photographique Formed Waters, Fabian Hugo a collaboré avec deux classes d’élèves du Gymnase français de Bienne pour laquelle les étudiant-e-s ont fait figure d’acteur-trice-s et de sujets des photographies. Pour les prises de vues, l’artiste a choisi de jouer avec des éléments aquatiques afin de parler de l’adolescence, un moment ou les choses éclaboussent et souvent, débordent. Les images de Fabian Hugo sont également publiées dans la prochaine revue Enjeux pédagogiques de la HEP-BEJUNE.
Année de production : 2019


L’exposition “Fast neu – nur einmal getragen” (presque neuf – porté une fois seulement) rassemble des images que la photographe Judith Stadler a collectionnées sur Internet durant trois ans. Ces photographies montrent des robes de mariée et des accessoires de mariage qui, ayant rempli leur office au jour du grand jour, sont ensuite vendus au plus offrant sur le Net. Il est à noter que Judith Stadler n’a retravaillé aucune des photographies trouvées. Dans l’exposition, les images sont exposées telles que publiées sur Internet, seul le format change. Les cadrages également sont originaux. Ces images semblent impossibles, parce que la plupart racontent une tout autre histoire que celle du jour du mariage : une histoire valide et mise en scène comme telle. Au lieu du mariage romantique sorti d’un conte de fées et de sa perspective de bonheur éternel, nous nous retrouvons malgré nous dans le bric-à-brac tant comique que tragique de ebay.com et de Ricardo.ch. En vue de se rendre méconnaissables, anonymes – pourquoi en fait ? – les mariées fraîches du jour griffent leur visage ou s’envoient, êtres sans tête, dans l’ether. L’anhistorique robe à froufrous de Cendrillon glisse sur les plaques d’Eternit grises du Garden Center. Le buste avenant et artistiquement souligné pourrait figurer sur une page de revue pornographique. On rit, sans se débarrasser malgré tout d’un frissonnement d’horreur, comme dans le conte de Barbe-Bleue, car l’on pressent déjà que de nombreux couples ne passeront pas le fossé existant entre le concept de l’amour romantique et la réalité d’un quotidien à deux. En Suisse, le taux de divorces est de 51%, et la capitale du divorce est Opfikon dans le canton de Zurich. (Nicole Müller)
Année de production : 2008-2010
 Judith Stadler
Judith Stadler


La série Extractions se compose de quatre photographies qui, d’après l’artiste, sont extraites d’un certain contexte pour se référer à un autre. Les deux Prototypes posent un décor ; comme leur nom l’indique, ils se prêtent à la nuance et à l’évolution vers des états proches ou antagonistes, comme ici ceux de l’abandon et/ ou d’un prochain aménagement. Le grand angle de Prototype (N.E.01) ouvre sur un terrain vague, avec en arrière-plan une rangée d’immeubles, à l’intérieur desquels Prototype (N.E.02) semble nous projeter. Dans un mouvement d’approche, le spectateur entre d’abord dans un espace fonctionnel, dont les teintes grisâtres et froides rappellent l’atmosphère extérieure ; puis, dans Sequence (#01), il plonge dans la lumière verdâtre d’un couloir sombre, où un homme s’apprête à pénétrer dans une chambre illuminée. Dès lors, l’action commence, le spectateur n’est plus seul, les lieux s’animent par la présence de figurants. À peine le temps de se familiariser avec l’obscurité que Sequence (#02) nous conduit à l’extérieur, en plein milieu des terres ensablées, celles de Prototype (N.E.01) ? Annaïk Lou Pitteloud brouille les pistes et ne laisse aucun indice pour affirmer ou infirmer une telle fiction. L’ambiguïté narrative permanente de ces images oscille entre réalité et fiction, entre fixité et mouvement, entre instantané et séquençage. Je n’utilise pas la photographie pour documenter la réalité mais pour étirer le temps, cristalliser des instants et les sédimenter pour leur donner une épaisseur. Ses oeuvres se caractérisent par un jeu perpétuel de va-et-vient. Au niveau spatio-temporel, les lieux semblent se télescoper, alors que rien ne les lie véritablement. Au niveau formel, le même mouvement imprègne la réalisation de ces images. En effet, la création de ces photographies passe par un long processus de montage numérique. La photographe accumule des séries d’images du lieu ou de la scène qu’elle veut représenter. Puis, parmi celles-ci, elle choisit tel fragment de telle image et tel extrait de telle autre, qu’elle s’atèle ensuite à réunir en un tout cohérent, afin d’aboutir à un résultat recomposé mais unifié.
Ariane Pollet
 Annaïk Lou Pitteloud
Annaïk Lou Pitteloud


Aussi sauvages et hostiles que le ciel peut paraître menaçant, les paysages sans présence humaine de la série «Espaces nomades» semblent presque surnaturels tant la colonisation de ces derniers territoires vierges semble inévitable. Ils n’ont cependant pas encore été domestiqués pour donner des parcs ordonnés mais seront sans aucun doute la cible de futures transformations puisque même la dense forêt tropicale porte désormais les marques de l’homme qui n’hésite pas à balafrer sa chair verdoyante pour mieux y marquer son emprise. En prenant ici la forme de routes et de chemins qui permettent de s’approprier le paysage qui fut il n’y a pas si longtemps inapprivoisé, la civilisation semble avoir remporté la bataille. Loin de la ville et de l’espace public urbain qui occupent une place importante dans son travail (comme par exemple dans «Surfaces»), la série «Espaces nomades» de Matthieu Gafsou questionne de manière subtile le rapport de l’homme à la nature et met en scène l’inéluctable domestication des derniers espaces vierges. En définissant la nature comme une construction, voire comme une simple réalité fantasmée, elle réfléchit subtilement aux difficultés de sa représentation et de son authenticité présumée. Les tentatives d’appropriation et d’assujettissement des étendues sauvages par l’homme qui y plante sa tente, sa caravane ou son mobile-home pour y créer un ordre rassurant illustrent ce qui pourrait être simplement considéré comme des pratiques culturelles qui tendent finalement à fabriquer le paysage. Pratiquement ubiquiste, la marque de l’homme sur son entourage (naturel ou urbain) est questionnée dans l’ensemble du travail de Matthieu Gafsou qui joue subtilement à la mettre en avant ou à l’occulter par un fin travail de cadrage et un intéressant jeu sur la lumière. L’alternance entre les espaces vierges et la nature en voie de colonisation ou totalement domestiquée permet ainsi de repenser l’évolution de l’homme dans la nature et sa quête obstinée du paysage inexploré. (Yan Schubert)
Année de production : 2008
 Matthieu Gafsou
Matthieu Gafsou


Capturer le temps ou retenir la lenteur, et faire que le mouvement paraisse comme un souffle. Andrea Good ou le temps rendu visible. Pour cela, aucun appareil conventionnel, elle construit son appareil photographique in situ, une camera obscura. Une église, des bureaux administratifs ou d’une banque, des containers, des chambres d’hôtel, des bâtiments industriels, Andrea Good transforme ces espaces en chambre noire trouée et fait ressurgir l’essence originelle de la photographie. Les lieux sont tapissés de manière à être opaques. Le faisceau lumineux entre dans la pièce par un côté et projette une image inversée et renversée sur le mur d’en face, sur lequel est accroché un papier photosensible. Les éléments fixes seront saisis tandis que ceux en mouvement ne pourront être distingués. La netteté de l’image va dépendre du mouvement, de la distance par rapport à l’ouverture de la camera obscura et du diamètre donné à son orifice. Le facteur temps n’est pas le seul à être essentiel dans le processus de création des photographies d’Andrea Good. Dans son travail sur les Tréfileries Réunies de Bienne, spécialement réalisé pour les Journées photographiques de Bienne, elle s’intéresse aux bouleversements économiques et urbains. La ville allant procéder à la démolition de certains bâtiments de l’ancienne industrie, c’est une ère qui s’achève. Andrea Good va documenter cette destruction en transformant des bureaux vides et laissés à l’abandon en chambre noire surdimensionnée. Andrea Good compose ses photographies à l’aide de lumière, de temps et d’espace. Même si son travail se base sur des calculs physiques très précis, la photographe doit faire preuve d’adaptation aux conditions sur place. Ainsi les variations de lumière conditionnent le temps d’exposition, et les variations du vent, les différents effets produits dans les feuillages et la fréquence du mouvement sur le chantier déterminent l’apparence finale de l’image: ce qui se meut trop rapidement sera fixé comme une trace fuyante, ou pas du tout.
Année de production : 2011
 Andrea Good
Andrea Good


Souvent frontaux, en pied ou en buste, les portraits de Charles Fréger figent les corps et imposent la neutralité de l’expression. Attentif à la qualité du grain de la peau et des textures, il privilégie la transparence de l’éclairage. Ses portraits en uniformes renvoient à ces profils médiévaux et autres figures frontales de la Renaissance. C’est bien une questionde rang et d’attribut que soulèvent les prises de vue de Charles Fréger : plutôt qu’interroger la société, il se penche sur les individualités juxtaposées qui la composent, toujours dans des allures dictées par le port de la tenue et de l’uniforme. Si le regard est d’abord attiré par la dimension stéréotypée des attributs (couvre-chef, costume, arme, bottes, etc.), la posture (gravité des visages, port de la tête, façon de bomber le torse ou de porter le regard au loin) contribue tout autant à plonger le spectateur dans l’univers de la représentation. L’artificialité de ces figures en devient presque naturelle : rien ne paraît joué, parce que tout semble s’inscrire dans la tradition, la répétition et la reproduction qui leur confèrent du même coup un caractère atemporel. Dans les trois séries présentées ici (« Empire », « Orange Order » et « Hereros »), les personnages portraiturés par Fréger déploient ostensiblement des insignes, dont le rôle premier en société est de marquer ou de rappeler l’appartenance identitaire. Ces parades sont l’expression de l’unité, voire du groupe conçu comme entité politique. Elles génèrent, de ce fait, une impression de puissance qui va de pair avec celle d’appartenance au groupe. Si les séries « Empire » et « Orange Order » nous plongent dans des univers étonnamment réalistes – pour ne pas dire communs – dans « Hereros » les cartes sont brouillées et les genres mêlés. Dans quel registre nous trouvons-nous ? Entre jeu, mise en scène et représentation, les frontières se confondent. Or c’est précisément cela que Fréger interroge par son travail. Comment s’imbriquent ces relations d’identité, entre individu, catégorie sociale et groupe, dont il se plaît à mettre en scène les dimensions emblématiques ? (Géraldine Delley)
Année de production : 2004-2007 / 2007 / 2008
 Charles Fréger
Charles Fréger


Une série de bâtiments en démolition constitue le «leitmotiv» des neufs clichés de «Downtown Corrida» (2010). Ces subtils photomontages parviennent à figer les impératifs manifestes du temps sur l’environnement architecturé en perpétuelle restructuration. Notamment inspiré de visuels amateurs de destructions d’immeubles, le photographe teste les frontières poreuses entre la ville et sa périphérie: un jeu de regard inversé interroge la perception à la fois commune et catégorique posée sur l’urbanisme périurbain. Ici, l’habitat marginal précaire a cédé sa place au bâtiment citadin jusqu’ici invulnérable; la disparition fugitive subite de l’édifice, doté d’un pedigree et d’une épaisseur historique, se situe anormalement au coeur d’un paysage fictif agencé d’HLM. Le titre métaphorique de la série emprunte à la corrida l’idée de la mort soudaine; dès lors, la montée du suspens dans l’attente de l’estocade finale renvoie expressément aux implosions mises en scène dans les ingénieuses compositions d’Alban Lécuyer. Une architecture fragile se dérobe sous l’impact brutal d’une destruction instantanée. Le spectateur impuissant contemple le spectacle de l’habitat collectif qui bascule dans un univers clos. Sans un temps d’adaptation possible, seuls la poussière et les gravats remémorent l’existence passée du bâtiment; un sentiment de déracinement laisse place peu à peu à la standardisation d’édifices émergents érigés en nouveaux modèles éphémères. La transposition qu’opère l’artiste souligne ainsi le conditionnement de la posture de l’individu face aux mutations territoriales. (Pamella Guerdat)
Année de production : 2009-2010
 Alban Lécuyer
Alban Lécuyer


Le collectif_fact se compose des artistes Annelore Schneider et Claude Piguet (et de Swann Thommen jusqu’à fin 2009) qui décortiquent l’espace urbain, le découpent et le reconstruisent dans des mondes virtuels, en vidéos et en photographies numériques. Leurs travaux questionnent l’espace urbain, sa signalétique et son architecture en partant de stimuli visuels qui envahissent notre quotidien. Une fois décryptés les codes sont redistribués à plusieurs niveaux, entre réalité et virtualité. Dans la série DOWNtown qui se compose de sept photographies réalisées en 2008, c’est le centre-ville de Genève qui fait l’objet d’une déconstruction: des bâtiments sélectionnés ne subsiste que le dernier étage. Une fois tronquées, ces constructions sont replacées dans leur espace où elles révèlent des rapports inattendus avec leur environnement. La spatialité change: les volumes s’étalent, l’horizontalité remplace la verticalité et donne à la zone un nouveau statut qui rappelle les périphéries des villes américaines. La composition ainsi obtenue donne à voir un étalement d’immeubles à fonction unique, séparés par des artères goudronnées surdimensionnées – une logique architecturale qui ne laisse aucune place au piéton, dont l’absence se fait presque oppressante. (Géraldine Delley )
Année de production : 2008
 Le collectif_fact
Le collectif_fact


Les prises de vues architecturales de la vidéo « Doppelt und dreifach umrundet » nous confrontent à une certaine réalité industrielle. Une fois mises à plat, ces images se transforment en sculpture dont la tridimensionnalité peut être omise. Y répond « Ohne Titel », un carrousel fait de bois, verre et miroirs, qui reflète et déconstruit l’environnement qui l’entoure. Ainsi, l’installation de Livia Di Giovanna joue avec le mouvement, la place du spectateur et « le regard devient moteur de cette machine à distiller les images »[1]. (cv)
[1] Communiqué de presse de l’espace d’art contemporain (les halles), Porrentruy : http://www.eac-leshalles.ch/eac/index.php?page=livia-di-givanna (consulté le 11.6.2014)
Année de production : 2013 | 2014


Sur une large colline de l’Etat d’Andra Pradesh, au sud de l’Inde, se trouve le temple de Tirumala. C’est un lieu de pèlerinage, et pas n’importe quel pèlerinage : des dizaines de milliers de personnes s’y rendent chaque jour pour remercier le dieu hindou Venkateswara. Il s’agit le plus souvent de gens modestes, de la campagne qui, pour leur santé, un bonheur ou un travail, pour un mariage, pour un cancer guéri, pour la naissance d’un fils ou pour une riche moisson font des heures de queue, puis jettent l’argent ou l’or qu’ils ont amené dans les récipients pour les offrandes placés devant le tombeau de Venkateswara. Et qui n’en a pas assez, peut jeter ses cheveux. Dans le Kalyanakatta-Center, sur le terrain du temple, travaillent 800 barbiers qui, vingtquatre heures sur vingt-quatre, rasent les têtes des pèlerins. Un barbier expérimenté débarrasse femme, homme ou enfant de ses cheveux en quatre minutes, et cela gratuitement. Plusieurs tonnes de cheveux coupés viennent ainsi s’entasser tous les jours à l’étage supérieur de ce plus grand salon de coiffure du monde. “ La montagne de cheveux représente l’amour pur que les pèlerins portent à Venkateswara “, déclare le directeur du Kalyanakatta-Center. “ Nous gagnons ainsi de l’argent pour le temple, beaucoup d’argent. “ D’ici, cet “ or noir “ initie son chemin commercial à travers le monde, utilisé à des fins médicales après une opération, ou encore pour fabriquer des perruques en cheveux naturels pour les chauves, pour la tête des juives orthodoxes. Ou enfin – et c’est là la plus fructueuse des affaires – pour des extensions pour embellir les femmes d’Europe et d’Amérique. Rien que pour la Suisse, on peut estimer à douze mille Indiennes qui chaque année donnent leurs cheveux. Le commerce du gérant du temple perturbe à peine les pèlerins ; pour eux aussi abandonner leurs cheveux est un commerce : ils donnent leurs cheveux en remerciement, et espèrent en secret de la part de Venkateswara des bénédictions futures. “ Il y a peu de commerces qui satisfassent tous les maillons de la chaîne de production “ dit Kishore Gupta, le plus grand marchand de cheveux indien : “ les pèlerins dévoués au dieu, les commerçants qui en vivent, et ceux qui profitent de leurs nouveaux cheveux “. (Daniel Puntas Bernet)
Cette exposition est une contribution de la Neue Zürcher Zeitung, Zeitbilder.
Année de production : 2009
 Meinrad Schade & Daniel Puntas Bernet
Meinrad Schade & Daniel Puntas Bernet


Fabian Biasio a eu l’occasion d’accompagner des partisans de l’UDC (Union Démocratique du Centre, parti conservateur très à droite de l’échiquier politique suisse) durant toute la législature 2003–2007. C’est durant cette période que Christoph Blocher, le grand tribun de l’UDC, a été propulsé au Conseil fédéral. Ce travail personnel a débouché sur une mise en perspective presque ethnologique: «Je me sentais comme un chercheur qui découvrait un monde jusqu’ici inaccessible – des personnes avec lesquelles il est normalement si difficile d’échanger». Photographiés dans l’intimité familiale, les portraits de Biasio offrent un angle de vue unique sur la base du parti et se détachent des électeurs de l’UDC dans leur clan retranché: un pot-pourri fait d’armoires campagnardes, de vieux carrelages, de murs sombres, d’appareils d’entraînement, d’art champêtre, de vieilles poupées et de rideaux plastifiés. Chaque portrait est placé à côté d’une photographie d’un paysage : le paysage préféré de la personne photographiée. Les sujets se montrent délibérément sûrs d’eux, presque entêtés. De manière sous-jacente, on ressent toutefois le malaise qui s’exprime. Les jambes sont croisées, les bras maladroitement portés. Biasio va capter le langage corporel à de nombreuses occasions, par exemple au travers de cette image d’Ueli Maurer surpris par une sommelière, son fusil à la main, mais avec l’expression maladroite et tellement humaine d’un enfant taquin. Les photographies de Biasio sont soigneusement composées, les moments choisis ne sont pas laissés au hasard. L’observateur sera peut-être conforté dans ses préjugés et aura l’impression d’observer un monde un peu grotesque. Ce point de vue dépend toutefois du spectateur. Biasio n’a pas le regard cynique d’un Martin Parr. Il n’impose pas sa perception et garde volontiers une certaine distance avec son sujet. Jusqu’à un certain point, il le laisse même se mettre en scène, faisant ainsi un pas vers l’autoportrait : «Durant ma sélection d’images, il me tenait à coeur de ne pas représenter une réunion d’allumés». Biasio cite volontiers le photographe Alec Soth qui pense que dans le portrait on ne «capture» jamais complètement la personne en face de soi : «Si une photographie devait vraiment documenter quelque chose, ce serait avant tout la distance qui me sépare du sujet». (Simon Stähli)
Année de production : 2003-2007
 Fabian Biasio
Fabian Biasio


Pour Chantal Michel, les sujets et les objets ne sont pas des catégories définies, l’un peut être pris pour l’autre et inversement. L’humain peut être une marchandise, comme les choses peuvent prendre des traits anthropomorphes. La photographe fait office de médium dans une sorte de royaume intermédiaire, où elle incarne un ange (protecteur), un esprit (frappeur), voire même un (non-)être. Elle a un flair prononcé pour ces détails qui évoquent le passé comme les moquettes, les lampes ou les tapisseries qui, malgré leur caractère ordinaire, laissent un goût d’étrangeté. Lorsque l’artiste investit, dans un déguisement approprié, ces intérieurs décalés où seuls restent des meubles oubliés, et y pose comme si elle en faisait partie, la scène se charge alors d’une touche de grotesque et de folie. Le processus de réduction qui consiste à limiter l’action du sujet à son immobilité et à sa raideur, et donc à son état de chose, agit à chaque fois comme une contradictio in adiecto photographique ; elle est une poupée vivante, une chose anthropomorphe sans identité. Faire le mort – attitude qui cite une forme de jeu théâtral – est aussi une performance qui consiste à se replier sur sa propre personne et s’en tenir aux faits, voire à les nier. Dans le cas de Chantal Michel, il ne s’agit pas d’un défaut psychique, mais elle incarne plutôt son propre grotesque avec un humour enfantin ; lorsqu’elle ferme les yeux ou n’en regarde pas d’autres, elle est sûre que les autres ne la voient pas.
Fritz Franz Vogel
 Chantal Michel
Chantal Michel


Yann Mingard s’intéresse ici aux centres de conservation du patrimoine phytogénétique de l’homme, plus particulièrement des graines. Dans ces photographies, regard analytique et regard esthétique s’interpénètrent et contribuent à leur donner un caractère particulier, à mi-chemin entre le document et l’œuvre d’art. Le photographe s’attache dans cette série à mettre en exergue le caractère paradoxal de ces lieux qui, pour préserver la vie, l’enferment dans des contenants, eux-mêmes enterrés dans de véritables bunkers, imposants et impénétrables. Les échantillons de graines présents par milliers, qui prennent place dans ces dépôts froids et austères, sont au centre de l’intérêt du photographe. Mais les autres éléments qui constituent ces lieux uniques n’en sont pas pour autant négligés: l’enveloppe extérieure des bâtiments et leur environnement, mais aussi leur intérieur, avec l’agitation humaine qui peut y régner, sont captés par Yann Mingard dans une volonté de retraduire un tout, livré ensuite à la libre appréciation du spectateur. Cette première série de photographies – qui s’intègre dans le projet plus large “DEPOSIT” visant d’ici 2012 à créer un corpus photographique autour des différents lieux de conservation du patrimoine humain, génétique, ou encore informatique de la société du XXIe siècle – invite à réfléchir sur le temps qui passe, sur l’avenir de la société et sur les peurs qui la motivent à préserver compulsivement toutes les sortes de patrimoines existants. (Camille Prenez)
Année de production : 2010
 Yann Mingard
Yann Mingard


Dans la série «Days have Numbers», Michael Fent s’intéresse aux thèmes de l’éphémère, de la mort. Le photographe fait le portrait de trois personnes. Des objets personnels sont aussi présentés de manière à donner un aperçu de leur vie intime, sans trop la dévoiler. Peter est un homme marqué par la vie. Le seul document qui lui reste de son passé est une photographie de son père, laissant supposer qu’il est sans famille. Esseulé, il attend la mort. Jonas est un jeune étudiant en théologie, suivant un séminaire de prêtrise; dans un essai, il s’interroge sur la mort. Pour lui, la question fondamentale est celle de l’au-delà. Y a-t-il une vie après la mort? Enfin Matthias. Son père mourut d’un cancer quand il avait 15 ans. Quatre ans plus tard, c’est autour de sa mère de décéder dans un accident. Dans un carnet de notes, Matthias inscrit les dates de naissance et de mort de ses deux parents. La mort est présente dans notre quotidien sous plusieurs formes, le processus de vieillissement, la dimension métaphysique de la vie ou comme tragédie personnelle. Des photos de paysages viennent compléter les portraits et les clichés d’objets personnels de chacun. Ces prises de vues mélancoliques, certaines représentant des arbres morts dans la grisaille matinale, renforcent l’essence dramatique cachée derrière le thème abordé. En suggérant une atmosphère mélancolique et post-apocalyptique, ces photographies reflètent la complexité des sentiments humains liés au thème de la mort. Dans son questionnement, Michael Fent oscille entre poésie, abstraction et documentation. Il dépeint tout d’abord des êtres qui ont, de différentes façons, accepté l’idée de la mort et de leur propre mort, des êtres qui y aspirent et la considèrent soit comme une libération, comme un passage vers l’élévation de l’âme, ou comme un partenaire dans la vie d’un mortel. Parallèlement, ses visions de la nature permettent la transfiguration de l’idée de la finitude de la vie en lyrisme poétique.
Année de production : 2009
 Michael Fent
Michael Fent


Pour ce travail, David Willen a recours à un processus sériel et répétitif. Tous les matins pendant un an – à l’exception des dimanches et jours de congés – la première tasse de café terminée est photographiée de façon systématique. L’installation et l’éclairage restent fixes alors que la prise de vue se fait au travers d’une chambre grand format 4×5 inches et de film polaroïd. Une fois la photo révélée, elle est collée au-dessus du titre principal de la Neue Zürcher Zeitung. Les 303 feuillets qui composent la série sont alors soigneusement archivés dans des boîtes de manière chronologique. Non loin du travail conceptuel de l’artiste On Kawara et de sa série de tableaux «Today Series» inaugurée le 4 janvier 1966 (toiles monochromes comportant uniquement la date à laquelle le tableau à été exécuté), David Willen inscrit sa série dans une tradition artistique moins courante dans la photographie que dans les arts plastiques. Mais alors que le travail de son homologue japonais relate principalement sa propre existence, la série «Das Ende der Sorglosigkeit» se révèle être moins personnelle et plus universelle. Cette pratique méticuleuse entreprise par le photographe relève d’une réflexion sur les différentes temporalités que présente sa série. Le rapprochement du texte et des photographies matérialise des données temporelles abstraites et en initie de nouvelles. Alors que les titres de la Neue Zürcher Zeitung se réfèrent à l’histoire médiatique de 2008–2009 et mettent en avant certains évènements comme la crise économique, le polaroïd évoque, quant à lui, l’instant unique de la prise de vue. Les traces de café sur les tasses ne peuvent alors échapper à la tradition séculaire et divinatoire de la lecture du marc de café. Car après tout, cette série ne serait-elle pas aussi une question d’interprétation? (Victoria Mühlig)
Année de production : 2008-2009
 David Willen
David Willen


Durant son séjour au Mexique en 2008, Emmanuelle Bayart appréhende le pays comme un objet complexe, encore tiraillé entre ses origines indigènes et celles des conquistadors espagnols. Elle cherche à mieux comprendre le caractère du Mexicain, sa culture, son histoire. La révélation s’impose à elle dans le métro de Mexico City, à la station Tacubaya, où se dresse une peinture murale représentant la culture précolombienne. Cette rencontre sous terre est le point de départ des séries “Dans le labyrinthe du métro, Mexico” et “Ode au métro de Mexico”.Photographier les peintures murales qui ornent les parois des arrêts de métro est une manière tout à fait inédite de traiter des questions d’histoire et de culture d’un pays. Pour approfondir ses connaissances sur l’identité mexicaine, personnelle et culturelle, Emmanuelle Bayart remonte le temps jusqu’aux origines précolombiennes en même temps qu’elle s’enfonce et erre dans les souterrains. Lieux de passage surpeuplés, les méandres des couloirs ne sont pas propices à la contemplation ; Emmanuelle Bayart a donc attendu que le flot des voyageurs s’amenuise et laisse place au décor. Avec la série “Ode au métro de Mexico”, Emmanuelle Bayart se rapproche plus de l’individu et atteint les espaces intimes de ce monde sous-terrain. Partie à la rencontre des employés du métro, elle nous livre leurs portraits et nous fait découvrir par l’image leurs lieux de travail et de repos. Le calme et l’intimité qui règnent dans ces lieux cachés contrastent fortement avec le flux des passagers arpentant les dédales des couloirs. Par enfilade, l’artiste nous propose un nouveau regard sur l’histoire, la société, le métro pour enfin arriver à l’individu. (Noémie Richard)
Année de production : 2008
 Emmanuelle Bayart
Emmanuelle Bayart


-Ah ! mon fils ! Te voilà.
Lucia se lève, étreint un bel homme, la trentaine, barbe et cheveux longs. L’intense affection qu’a cette adolescente de 16 ans – tout au plus – pour ce fils presque deux fois plus âgé qu’elle nous rend perplexes.
-Comment vas-tu mon enfant ?
Fernando, en baskets et jeans délavés, que Lucia appelle “ mon enfant “ a été Christ trois fois, connaît le rôle sur le bout des doigts, est employé par Teflon Mexico comme ingénieur. Il doit remplacer au pied levé, deux jours avant la fête, le Jésus qu’avait élu le comité mais qui, sous la trop forte pression du rôle, s’est désisté au dernier moment. La vie de Fernando a changé après sa première mise en croix. Au village, il arrive qu’on lui demande conseil sur les sujets les plus divers, certains, même, se signent quand ils le voient passer. Plaisir des retrouvailles, Fernando veut se voir en Jésus sur les images faites de lui l’an passé, elles seront (pour la cinquième fois !) le visa pour être accepté au sein de la célébration et faire partie du cortège… Lucia alias Marie, Ponce Pilate, les bourreaux et bien d’autres se précipitent sur les images de la Passion précédente – je dois, avec une douce fermeté, intervenir et distribuer à chacun le souvenir de son effigie.
Des trois Jésus photographiés, Fernando reste le plus charismatique, le plus habité par son rôle. Le nouveau comité me semble manifester toujours plus de fermeté avec les photographes, d’ailleurs à chaque fois plus nombreux, qui pourraient tirer profit de ce festin d’images, s’en aller vendre leur moisson aux journaux. Nous n’en sommes heureusement pas encore à signer des décharges. Cette année nous travaillerons à deux : deux regards pour une seule passion, tout excités de courir après le Christ qui, lui, court vers sa fin certaine, et de capter un peu de l’intense émotion provoquée par cette catharsis collective. (Francis Traunig)
Année de production : 2005
 Francis Traunig & Nicolas Righetti
Francis Traunig & Nicolas Righetti


Dans Cromofobia (2007) Tagliavini décolore ses scènes soignées, non pas de manière numérique mais analogique, ce qui demande beaucoup plus de travail. L’intrigue fictive d’une femme qui craint les couleurs, comme l’indique le titre, nous fait philosopher sur la variété de couleurs de notre monde actuel. La décoloration d’un monde intact, la réduction des contrastes colorés et la variation des tons gris rappellent un temps où la poussière et la salissure encombraient l’air bien plus qu’aujourd’hui. La discrétion des couleurs en association avec un objet criard qui insuffle la peur est juste un élément formel qui rend particulièrement reconnaissable l’objet causant la phobie. D’un style anglo-saxon du début des années 1950, la série se réfère à la peur de faire entrer une nouveauté chez soi. La pâleur est aussi une métaphore de l’esprit du temps, sans énergie, dans l’expectation, qu’on ne remarque pas mais qui disparaît modestement dans les coulisses. Un autre indice révèle que cette peur maladive devrait être guérie, ce sont les lèvres rouges. Elles ne parlent pas encore de manière ostensible, pourtant une communication intérieure est établie avec le corpus delicti.
Fritz Franz Vogel
 Christian Tagliavini
Christian Tagliavini


Poursuivant sa démarche de présenter ses chansons sous des formes novatrices et inattendues, et se jouant des codes de la pop culture, My name is Fuzzy aka Bastien Bron présente avec COLLECTOR un projet qui allie images du passé et nouvelles technologies. De la carte postale des Beatles en passant par un poster des Spice Girls, les dispositifs interactifs de l’artiste détournent des objets photographiques fétiches, de collection ou démodés. A l’aide de la réalité augmentée et autres technologies, il redonne vie à des vedettes d’un autre temps en usurpant leur identité et en leur faisant interpréter ses propres chansons.
Ses tentatives de superposer son image à celles des stars du passé, lui permettent de traiter avec humour un thème qui lui est cher : la poursuite de la célébrité et les fantasmes qu’elle véhicule. Une réflexion à la fois critique, drôle et nostalgique sur la condition humaine.
Présentée en collaboration avec Nebia, l’installation a été imaginée lors d’une résidence artistique à Bruxelles en 2023.
Le samedi 11.05 à 19h, Bastien Bron, sous le nom My name is Fuzzy, proposera un concert-performance à Nebia avec Léopoldine HH. Plus d’informations : www.nebia.ch
Année de production : 2024


Avec le projet “Box” (2008), travail de diplôme de l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne, la jeune photographe Anja Schori illustre le monde méconnu et peu médiatisé de la boxe féminine. Un univers qui, contrairement à celui dominé par des noms tels ceux de Primo Carnera, Rocky Marciano ou encore Mike Tyson, ne connaît pas la même histoire légendaire ni le même succès médiatique. Dans le souci de révéler les différents aspects et facettes qui caractérisent la boxe déclinée au féminin, Anja Schori se munit d’un regard tantôt intime et direct, tantôt glamour et sensuel. Qu’il s’agisse du portrait d’un visage encore transpirant après une éprouvante séance d’entraînement illuminé par d’éclatants yeux verts, d’un poing prêt à décocher un coup décisif, d’une silhouette prête à bondir au début du premier round, les nombreux clichés montrent parfois une énergie débordante, parfois une détermination sans faille et souvent une indéniable sensualité. Suivant la nécessité, l’intention ou la recherche d’un rendu particulier des clichés, Anja Schori s’arme d’un reflex argentique, d’un appareil numérique, empoigne sa M6 ou immortalise son sujet avec un simple appareil analogique compact. Ainsi, un tirage couleur aux contrastes sophistiqués d’un portrait en gros plan, une séquence en noir et blanc d’un entraînement ou encore l’image d’un regard déterminé se mélangent sans cesse tels des enchaînements ou un coup droite gauche esquivé par un habile décalage latéral.Comme le remarquait Barthes dans ses “Mythologies “, tout combat de boxe partage avec le catch une dimension grandiloquente et hautement spectaculaire. Il suffit de mentionner le cirque médiatique généré par l’historique combat entre Ali et Foreman à Kinshasa ou les spectaculaires combats au MGM de Las Vegas. Cependant, contrairement à un combat de catch qui impose au public une lecture immédiate et emphatique de chaque geste, un match de boxe est une histoire qui se construit en permanence sous les yeux des spectateurs. Tout mouvement s’inscrit ainsi dans la durée de l’événement, s’étendant toujours vers le couronnement d’une issue, dans l’”avenir rationnel du combat” dans lequel le résultat reste inintelligible jusqu’au son de la cloche qui annonce la fin du dernier round. Le ring est de fait le lieu de l’affrontement, synonyme du combat corps à corps et du défi sans merci ; confrontation physique qui implique autant d’érotisme que d’héroïsme, dans laquelle les pugilistes s’esquivent et se rapprochent sans cesse dans le but ultime de terrasser définitivement l’adversaire. À l’origine, des jeux funèbres organisés en l’honneur des victimes de guerre, décrits par Homère dans l’”Iliade” (XXIII) et discipline olympique à partir de 668 avant J.-C. le pugilat s’est depuis ses débuts chargé d’une dimension mythique qui perdure dans les arènes contemporaines. Dans cette mythologie uniquement masculine, les femmes n’ont longtemps occupé qu’une place accessoire en tant que femmes / images, objets en exhibition entre les rounds à regarder par un public enthousiaste et excité. Dans cet univers où la testostérone s’érige en maître incontesté, Anja Schori donne la parole à des boxeuses qui, dans ce monde, ont sûrement leur mot à dire. Des cadrages serrés sur un vieux gant de cuir ou des punching-balls déposés dans un coin de la salle ; des images représentant des séances d’entraînement intense alternent aves des images plus intimistes dans lesquelles les sous-vêtements abandonnés dans les vestiaires apparaissent tels des vestiges d’une victoire consommée dans un ring désormais déserté.Anja Schori se plaît à jouer avec les symboles hérités d’un monde de guerriers et à détourner avec subtilité et une certaine ambiguïté les clichés qui peuplent d’une manière ou d’une autre l’imaginaire masculin : des portraits en noir et blanc qui rappellent ces magnifiques pin up des magazines des années 1950, des femmes en tenues sexy et minimales qui offrent à l’objectif leurs corps toniques et sensuels telles des mannequins pendant un “shooting” de mode, mais surtout des sportives qui s’imposent avec une détermination exemplaire dans un monde nostalgique et fortement patriarcal. Par ailleurs, les quelques hommes photographiés apparaissent dans des rôles paradoxalement marginaux et souvent relégués à des fonctions simplement auxiliaires. Les images de différents formats et hétéroclites se succèdent le long des nombreuses pages d’une édition volontairement précieuse qui renvoie sans détours à ces magazines de papier glacé dans lesquels des images publicitaires impeccablement élaborées côtoient des clichés documentaires aux couleurs luisantes. L’attention portée par la photographe à la mise en page raffinée et au “layout” qui invite le lecteur / spectateur à une lecture rythmée et dynamique, confère au travail une dimension intermédiaire entre le documentaire et le reportage de mode. D’autant plus qu’une attention particulière est donnée à la typographie des citations agencées d’après une logique qui s’apparente de manière certaine à celle qui caractérise les reportages des magazines glamour. L’aspect social et celui clairement plus esthétisant de la photographie de mode se suivent, se mêlent et se confrontent grâce à une habile variation des formats et des cadrages ainsi qu’à une variation formelle avisée des tirages. Dans le souci de ne pas s’astreindre aux codes qui imposent traditionnellement le noir et blanc au style documentaire et les couleurs saturées à la photographie de mode, Anja Schori brouille les frontières, survole les genres et redéfinit des limites clairement plus labiles. (Patrick Gosatti)
Année de production : 2008
 Anja Schori
Anja Schori


En mettant en scène d’absurdes astronautes faits de légumes ou des loups sculptés dans de la viande hachée, Jojakim Cortis et Adrian Sonderegger ont rejoint le courant lancé par Fischli/ Weiss. Leur travail intitulé Blitztiere (2007) présente une série dans laquelle la maîtrise technique permet de mettre en place des impressions de vie sauvage là ou il n’y en a pas, comme si l’image avait été prise dans un piège tendu dans la nuit. De quoi induire de beaux cauchemars dans l’esprit du spectateur. Ces éléments rappelant des chambres d’essais, des laboratoires, des engins de simulation ou encore des installations de crash-test démontrent que les photographes ont également été aux prises avec les côtés plus sombres et irrationnels de la vie. Les prises de vue vacillent entre fiction et documentaire. Il devient difficile de faire la différence entre l’absurdité de la réalité et la crédibilité de la fiction. Dans leurs images Angst (2007), les photographes jouent sur la sensation de vertige, au point de conduire le spectateur dans un laboratoire de conditionnement des comportements psychiques. L’observation elle-même trouble le sens de l’équilibre et laisse le champ libre à un désagréable sentiment de panique, à la peur irrationnelle de choir dans un abysse infini. Un transfert s’opère entre l’image et le spectateur qui se retrouve contaminé par la peur mise en scène. Cette transmission fonctionne grâce à la clarté et l’évidence des photographies proposées.
Fritz Franz Vogel
 Jojakim Cortis & Adrian Sonderegger
Jojakim Cortis & Adrian Sonderegger


Les travaux de Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset sont d’ingénieuses et authentiques mises en scènes photographiées. En s’inspirant de situations, de collaborations, de décalages, voire de non-sens, le duo s’invente des récits qu’il matérialise ensuite dans des constructions savamment assemblées. Dans certains cas, nous serions tentés d’y voir des taxidermies inachevées. Chaises, tables, matelas, draps, couvertures, coussins, sacs poubelle, tréteaux, planches, cartons et parfois les photographes eux-mêmes, en sont les matériaux de base. Ainsi, l’éléphant recomposé semble être sur le point de s’animer, la structure du Cervin empaillé est apparente, mais la montagne semble déjà réellement vivante. Ailleurs, des habits de créateurs servent à mettre en selle un bédouin, à faire poser un montagnard excentrique en héros à la fois génial et complètement ridicule, à présenter un bien nommé Bernhardo sur sa monture flamboyante, à sculpter les portraits d’Igor et de Jeannette ou encore de luxueux Molux. Plus loin, un Don Quichotte blessé (alias Bill) chevauche son éléphant. D’autres s’imagineront plutôt D’Artagnan de retour d’Inde. Dans la série La Bénichon (2006) qui illustre le menu pantagruélique de la fête traditionnelle fribourgeoise, un drôle de convive se retrouve goinfré (de coussins) et une étrange tablée à mille pattes intrigue le regard. Coccinelle ubuesque ou meringue revisitée ? Peu importe, ces photographies racontent bien plus d’une histoire et invitent autant à la divagation saugrenue qu’à la dissertation académique.
Manuela Lienhard
 Geoffrey Cottenceau & Romain Rousset
Geoffrey Cottenceau & Romain Rousset


Robert Huber nous montre dans cette série des portraits présentés sous une forme simple: prises de vues horizontales, cadrages en buste, la plupart des visages étant de face. Pas de mise en scène ni de superflu; un fond noir, la nuit, pour seul décor. Si la construction des images se veut simple c’est peut-être pour mettre en évidence un sujet qui ne l’est pas. Les photographies de ces transsexuels déroutent. Elles nous bousculent car elles nous renvoient évidemment à notre identité sexuelle. Comment serais-je physiquement et psychologiquement si j’étais un homme/une femme? Quelle est ma part de masculinité et de féminité? Il est intéressant d’aller au-delà du premier coup d’oeil qui, comme dans toute série, nous pousse à comparer les traits du visage qui sont plus harmonieux chez l’une que chez l’autre, les yeux, la forme des bouches ou l’habillement. Pour cela, il faut les replonger dans leur contexte. Ces photographies ont été réalisées à Beyoglu, le quartier bouillonnant d’Istanbul qui n’a rien à envier aux capitales branchées occidentales. Dans cette ville, le voile côtoie la mini-jupe, le souk est à deux pas des magasins fashion et les nuits animées de Beyoglu tranchent avec la rigueur des prières du muezzin. Mais même si la culture occidentale prend une place importante dans la vie stambouliote, la mentalité reste encore généralement traditionnelle. Durant les années 1980–1990, les transsexuels ont été victimes de persécutions policières. Bien qu’aujourd’hui la société soit devenue plus tolérante à leur égard, les transsexuels restent en marge. Ne trouvant pas de travail stable et régulier, la plupart d’entre eux sont des travailleurs du sexe. Qu’y a-t-il donc derrière ces visages? Quel est le quotidien de ces femmes? Quelles sont leurs souffrances? Quel avenir ont-elles au sein de cette société? (Carine Steiner)
Année de production : 2005
 Robert Huber
Robert Huber


La série “Autour” a valu à Olivier Culmann le prix Roger Pic de la Société civile des auteurs multimédia en 2003. Elle est issue de quatre voyages à New York entre 2001 et 2002 et propose un regard décalé sur le 11 septembre. En plus d’être un événement historique, le 11 septembre 2001 a fait franchir une nouvelle frontière à l’image : déployant à l’extrême la capacité d’immédiateté des réseaux de communication du XXIe siècle, il a surtout poussé le réel vers la fiction comme jamais auparavant. Cette image est tellement incroyable, au sens strict du terme, qu’elle tient plus du scénario catastrophe que du réel. Elle a beau passer en boucle sur tous les écrans, elle reste inconcevable. C’est peut-être cette manière de dépasser la réalité ou d’incarner avec une telle justesse la fiction qui l’a désincarnée. Pour tenter de saisir ce qui se joue dans cet événement, et la manière dont il nous affecte, Culmann choisit justement de s’en détourner. Près de Ground Zero, le photographe tourne le dos aux décombres pour photographier ceux qui les regardent, les spectateurs, et déplace ainsi le centre de l’attention. Absorbés par ce qu’ils ont sous les yeux, ceux-ci en deviennent le reflet, l’incarnation. Plus encore, devant le vide laissé par les tours du World Trade Center, ils deviennent porteurs du sens de l’événement. On lit dans ces regards la terreur et une fascination muette, ainsi que les doutes qui ont saisi les Américains à la suite du 11 septembre. (Anne Froidevaux)
Année de production : 2001-2002
 Olivier Culmann
Olivier Culmann


Voir la page en allemand ou en anglais.
Année de production : 2013-2014


A la fois à l’aise dans des oeuvres de commande publicitaires ou pour des magazines que dans la photographie artistique, Julian Salinas se concentre dans la série «Am Tag davor» (le jour d’avant) sur le visage humain. Le portrait constitue une importante partie de son travail puisque l’artiste photographie aussi bien des célébrités, telles que Iggy Pop, Pipilotti Rist ou le chanteur Moby, que des quidams. Alors que dans «Ordinary World» (2004–2005), ceux-ci espèrent s’évader du quotidien, gagner en particularité en s’intégrant à des groupes, dans «Am Tag davor» ils sortent de l’ordinaire par ce qu’ils expriment. Chacune des onze personnes photographiées l’est selon le même cadrage au niveau des épaules et sur un fond neutre, mais se distingue des autres par son expression spécifique. Pourtant, toutes se trouvent dans la même situation: à la veille (am Tag davor) d’une décision importante ou d’un départ vers l’inconnu. La fixité de l’image photographique permet à l’artiste de figer le moment précis où l’émotion se lit sur le visage. Toutefois, l’intensité émotionnelle est si forte qu’elle transcende l’instant pour atteindre la durée. Julian Salinas parvient à concilier les deux opposés bergsoniens que sont le temps scientifique, mesurable et la durée, temporalité de la conscience 1. Les individus photographiés sont à la fois présents dans l’instant de la prise de vue et à la fois absents puisque pris dans le flux continu de leurs pensées et de leurs sentiments. A la rencontre entre un point donné sur la ligne du temps et la durée s’inscrivant à l’intérieur de celui-ci s’ajoute une troisième strate temporelle, le futur. L’objectif de Julian Salinas capte en effet avec subtilité l’incertitude inhérente à l’avenir. (Melissa Rérat)
Année de production : 2006-
 Julian Salinas
Julian Salinas


Le collectif Das doppelte Lottchen tient son nom du célèbre livre pour enfants de l’écrivain allemand Erich Kästner. Il se compose de deux artistes biennoises qui visitent, au travers de leur série « 47° 14′ 20″ N, 7° 2′ 48″ 0 », différentes temporalités notamment grâce à d’importantes œuvres de l’histoire de l’art. La série porte le nom des coordonnées géographiques de l’emplacement des prises de vue dans le Jura. Les douze images de la série sont issues de la superposition entre une œuvre célèbre et une photographie. L’assemblage de ces images permet alors aux artistes la construction d’une nouvelle fiction à partir d’une image connue. Le tableau du Maître de Fontainebleau « Dame à sa toilette » (fin du XVIe siècle) ou encore « La Vierge et l’enfant » du Diptyque de Melun de Jean Fouquet (1450– 1455) sont ainsi réemployés au profit d’un nouveau travail artistique mêlant dès lors photographie et peinture. Si la superposition de ces images trouble certains éléments et en laisse apparaître d’autres, le sujet féminin reste quant à lui central. La série confronte ainsi des figures d’œuvres plus anciennes et des figures féminines contemporaines mises en scène dans les photographies. Cet assemblage rapproche aussi les différents décors et surtout leurs différentes temporalités, le tout dans des tons pâles créant une atmosphère vaporeuse et onirique. Entre photographie et peinture, entre passé et présent mais aussi entre fiction historique et réalité géographique, la série donne lieu à un véritable voyage dans le temps et dans l’art. (Victoria Mühlig)
Année de production : 2011
 Das doppelte Lottchen
Das doppelte Lottchen
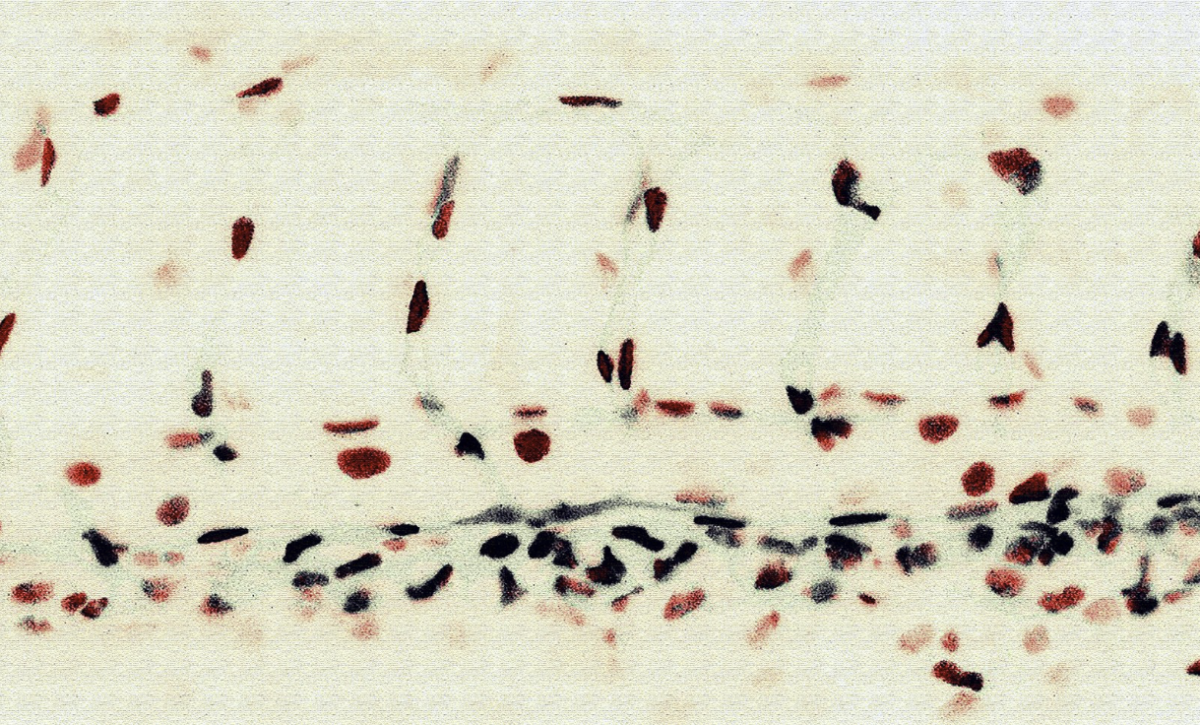
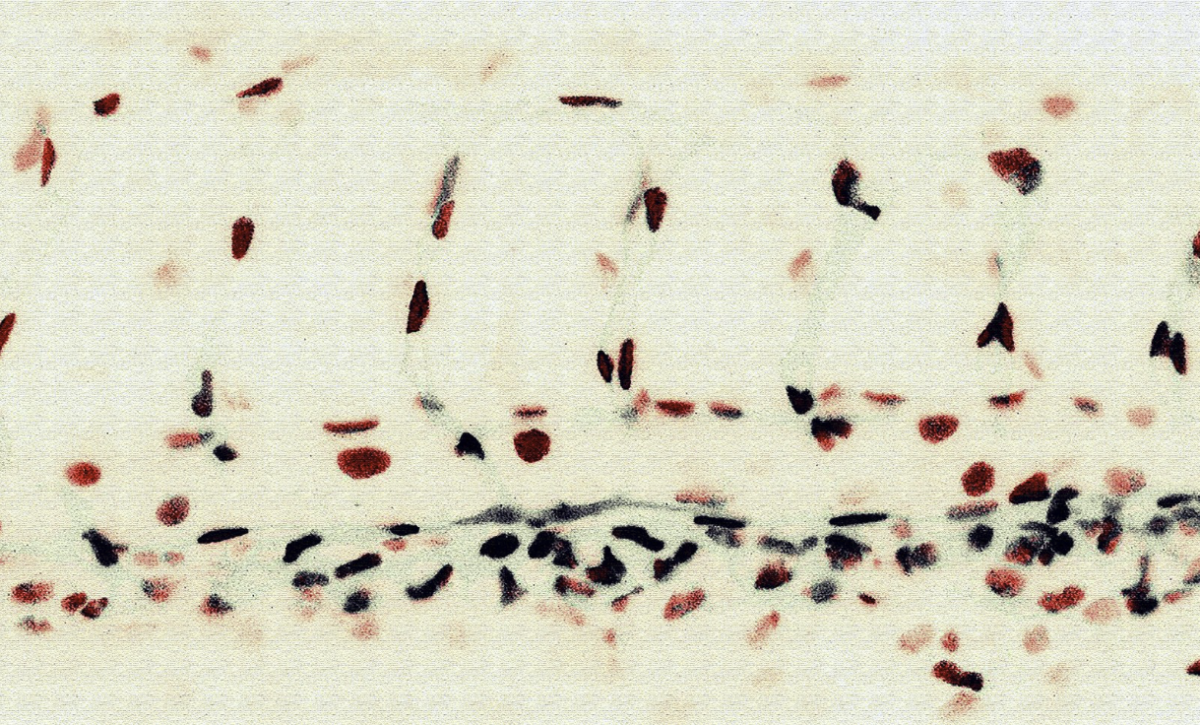
Chaque jour les laboratoires scientifiques suisses produisent des milliers d’images d’un monde macroscopiquement petit. Elles sont le résultat d’expériences ou un élément de preuve venant confirmer une théorie. Ce sont aussi des images qui témoignent de la beauté des sciences et fascinent par leur esthétique.
Pour la deuxième fois, le Fonds national suisse (FNS) organise le Concours FNS d’images scientifiques et invite les chercheurs actifs en Suisse à soumettre leurs images les plus passionnantes des douze derniers mois. Parmi plus de 350 photos, un jury international a sélectionné les meilleures. Les photos et vidéos primées seront présentées aux Journées photographiques de Bienne.
En collaboration avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).


Se donner des airs, mettre en scène quelque chose, laisser surgir des réalités fantastiques, surréelles : un corps se métamorphose en fragment esthétique formel, les contenus déversés de sacs à main féminins simulent un lieu de crime, la nature se mue en salon, des animaux trop humains nous montre ce que nous sommes vraiment, des maquettes de paysages déconcertent, des beautés rendues visibles époustouflent, des mondes apparents se rencontrent, des personnages louches se laissent surprendre, des scènes de fête montées posent des questions de sens, l’éphémère est immortalisé, le passé est remémoré, des habits installent des espaces, des codes barres signalent des routes, des carrefours – des espaces vitaux, des identités sont camouflées, des femmes sont sanctifiées, des images sont mises en scène, des faons de chambres d’enfant sont poussés sous le feu des projecteurs, de nouveaux espaces voient le jour dans un échange entre photographie et crayon, des paysages en plastique questionnent les échelles, la fantaisie n’a pas de limites. Les sujets et les techniques de prises de vue deviennent des champs d’expérimentation pour Rhea, Kaspar, Ueli, Aline, Selina, Gina, Marc, Litta, Banu, Mischa, Niklaus, Remo, Cornel, Remo, Daniel, Eve, Baptiste et Miro. Les travaux des élèves de deuxième année de la classe professionelle de graphisme de l’Ecole d’arts visuels Berne et Bienne à Bienne offrent une interprétation à facettes multiples de la photographie mise en scène, thème générique des Journées photographiques 2008. Dix-huit travaux uniques et autonomes témoignent d’une grande créativité et démontrent l’ampleur et la possible profondeur de la thématique. Les mondes analogue et digital se rencontrent. Les symbioses, les croisements de la technique moderne et de l’artisanat traditionnel produisent des effets que le contenu des travaux rappelle. Ce qui semble fortuit est planifié minutieusement. Par la mise en scène et la transposition technique, les idées dégagent une forte présence. Elles reprennent différents phénomènes de société, déconcertent, provoquent, donnent à penser. Les objets sont humanisés. Des mondes parfaits sont remis en question, de multiples espaces d’associations s’ouvrent aux spectateurs.
Alfred Samuel Maurer
 Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne


Depuis plus de trente ans, Heini Stucki travaille dans la lignée de la tradition de la “ photographie du quotidien “. Il se consacre aux hommes et aux paysages, comme par exemple, ceux du Seeland bernois qu’il parcourt muni de son Leica à la recherche de ses sujets. Que Heini Stucki portraiture des chats, des personnes en chaise roulante, les motards bernois “ Broncos “, des sans-papiers ou encore l’écrivain Gerhard Meier, ses images sont toujours très élaborées et fortement engagées : elles traitent au fond des exclus, des menacés ou des faibles. La plupart du temps, Heini Stucki photographie encore en noir et blanc et il suspend lui-même ses tirages sur la corde à linge de sa chambre noire. Photographier est pour lui une façon de dialoguer avec des inconnus. Malgré la mélancolie qui émerge régulièrement de ses travaux, il aime relever les aspects cocasses du quotidien. (Christian Fürholz)